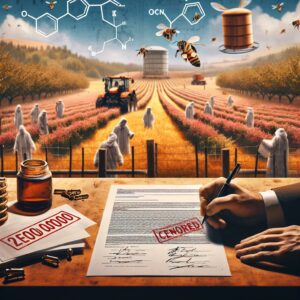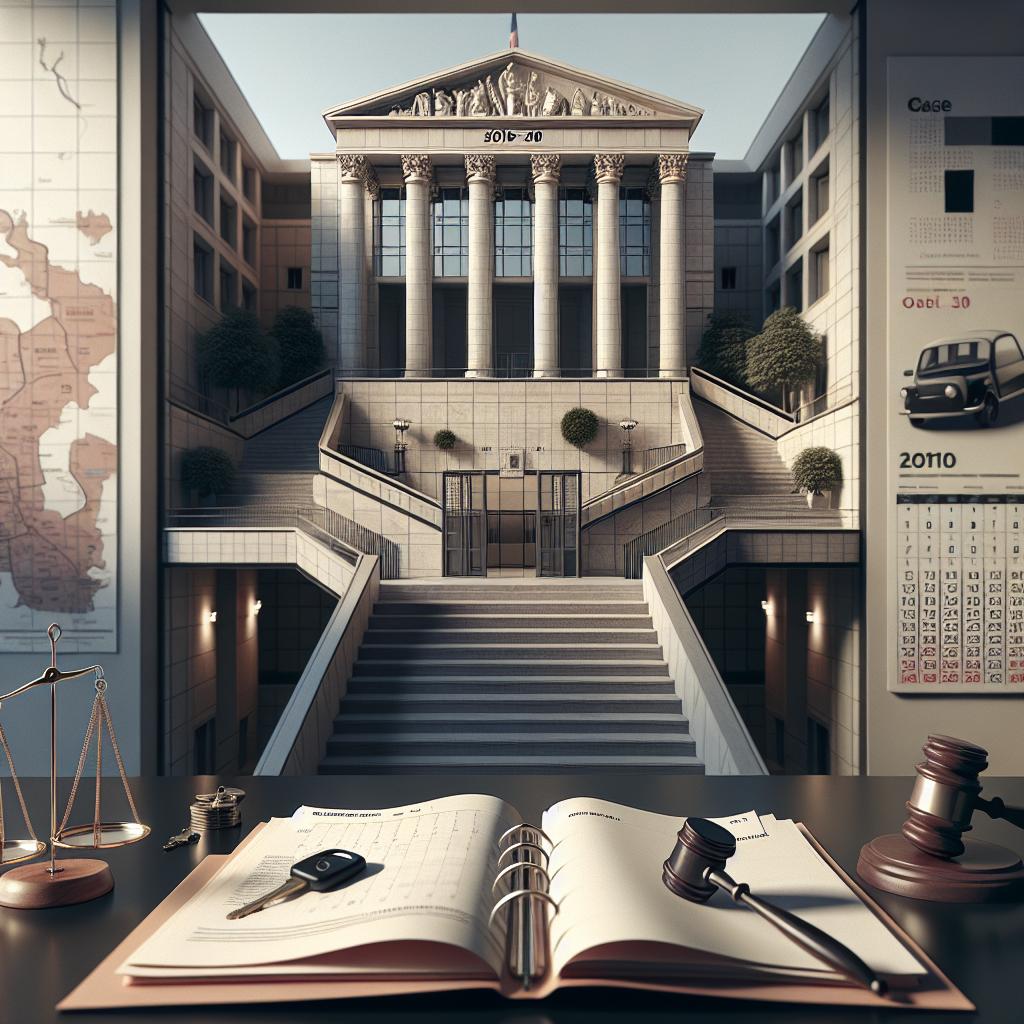Emmanuel Macron a promulgué le mardi 12 août la loi dite « Duplomb » sans pour autant réintroduire l’acétamipride, une substance dont la remise en circulation avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Parallèlement, un règlement publié au Journal officiel de l’Union européenne le 31 juillet modifie les limites maximales de résidus (LMR) d’acétamipride pour certains produits, ouvrant la porte à l’entrée sur le marché européen d’aliments contenant des concentrations plus élevées de cet insecticide néonicotinoïde qu’auparavant.
Quelles modifications de limites maximales de résidus ?
Le règlement européen revoit à la hausse des LMR pour des denrées précises, à la demande de plusieurs États membres. Sont concernées notamment les prunes, certaines graines (lin, pavot, moutarde, cameline) et les « miels et autres produits de l’apiculture », selon le texte publié. Les nouvelles valeurs citées sont de 0,04 milligramme par kilogramme pour les prunes et de 0,3 milligramme par kilogramme pour le miel.
Les LMR déterminent le seuil au‑delà duquel un produit ne peut plus être légalement vendu sur le marché de l’Union européenne. Elles s’appliquent aussi bien aux denrées produites dans l’Union qu’aux produits étrangers souhaitant y entrer.
La Commission européenne a indiqué avoir transmis au préalable les demandes, les rapports d’évaluation et les dossiers à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Cette dernière a conclu que les LMR demandées pour ces produits étaient acceptables, selon la communication de la Commission.
Procédure européenne d’autorisation des substances actives
L’autorisation d’une substance active au niveau européen suit une procédure stricte. Après une première évaluation scientifique par un État membre rapporteur, celui‑ci adresse son rapport à l’EFSA, qui publie ensuite un avis scientifique. Sur cette base, la Commission propose d’autoriser ou non la substance. La proposition est alors soumise au vote d’un comité composé de représentants des 27 États membres, selon la règle de la majorité qualifiée.
En cas de désaccord du comité, la Commission peut réviser sa proposition ou, si aucune majorité n’est obtenue, prendre seule la décision finale. La procédure a déjà abouti à une décision prise unilatéralement par la Commission dans un autre dossier récent, celui du glyphosate en 2023, rappelle le texte.
Contexte français et réactions
En France, l’usage de l’acétamipride à titre dérogatoire est interdit depuis 2018. La réautorisation de cette substance reste toutefois possible ailleurs en Europe, ce qui a alimenté des demandes de producteurs français — betteraves, noisettes — souhaitant disposer de cet outil pour lutter contre certains ravageurs et rétablir une concurrence jugée équitable avec des producteurs d’autres États membres qui l’utilisent.
La perspective d’une nouvelle autorisation a cristallisé l’opposition. Une pétition citoyenne déposée auprès de l’Assemblée nationale demandant l’abrogation de la loi Duplomb a réuni plus de 2,1 millions de signatures, selon les chiffres cités.
Le 7 août, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il y avait une « faute d’encadrement suffisant » et que la mesure contestée était contraire au « cadre défini par sa jurisprudence, découlant de la Charte de l’environnement », ce qui a conduit à la censure d’une réintroduction directe de l’acétamipride au sein de la loi.
La réautorisation effective de l’acétamipride au plan européen a, en revanche, renforcé la contestation publique et au sein de la communauté scientifique, selon le compte rendu des événements.
Annie Genevard, ministre française de l’Agriculture, a annoncé le 8 août son intention de poursuivre le travail auprès de la Commission européenne pour harmoniser les règles relatives aux produits phytosanitaires en Europe. Elle a indiqué que la France avait obtenu récemment le soutien d’une dizaine d’États membres sur cette proposition et déclaré : « Je poursuivrai le combat en inscrivant ce point à l’ordre du jour des prochains Conseils européens pour obtenir des avancées substantielles ».
La situation illustre la difficulté d’articuler politique nationale de protection de l’environnement et décisions réglementaires à l’échelle de l’Union, où l’homogénéisation des règles peut conduire à des tensions entre pays aux approches différentes en matière de gestion des pesticides.