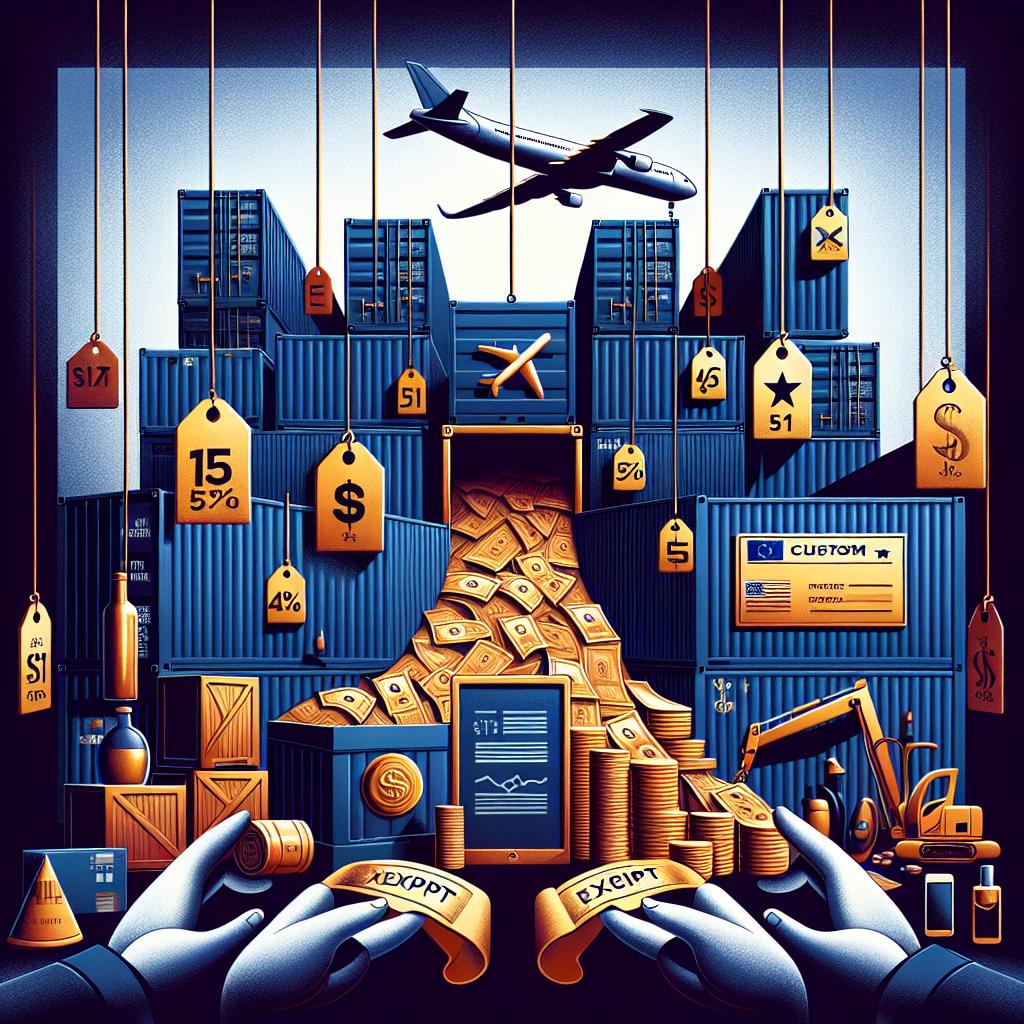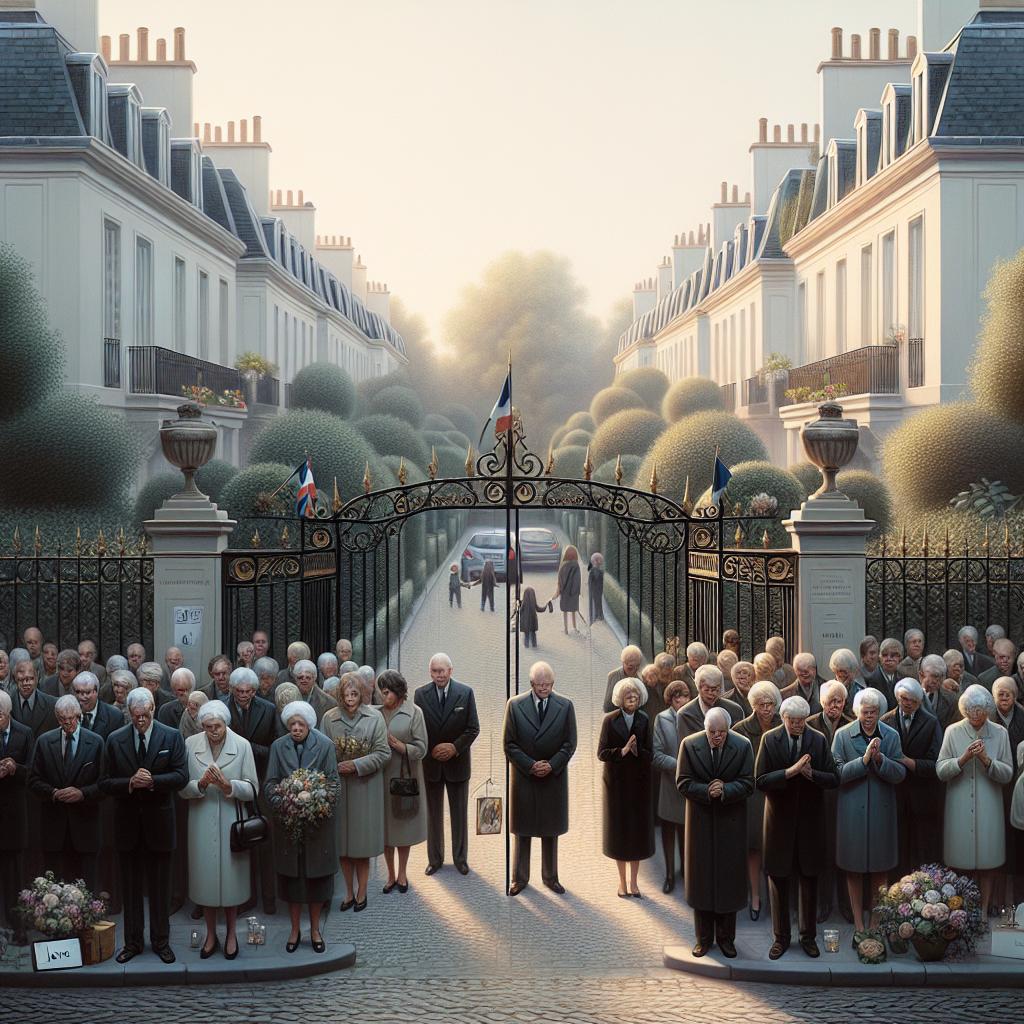Les nouveaux droits de douane annoncés par l’administration américaine de Donald Trump sont entrés en vigueur jeudi 7 août à 6 heures (heure de Washington), après avoir été repoussés à de nombreuses reprises. Le président américain a salué la mesure quelques minutes après l’échéance sur son réseau Truth Social, écrivant : « Il est minuit !!! Des milliards de dollars de droits de douane affluent maintenant vers les États‑Unis d’Amérique ».
Un dispositif généralisé, mais des exceptions sectorielles
Depuis avril, l’administration américaine a procédé à de nombreux ajustements des droits de douane appliqués aux pays du globe, qui se situent désormais entre 10 % et 41 %, voire 50 % dans « des conditions particulières » pour le Brésil, selon le texte initial. Une majorité de pays se voient appliquer un droit de 15 % par défaut, taux qui s’applique notamment aux échanges avec l’Union européenne.
Le poids de ces taxes varie fortement selon les secteurs. L’aéronautique figure parmi les mieux protégées : avions et pièces détachées sont « totalement exemptés », ajoute le document de l’administration américaine, et certains équipements technologiques sont eux aussi épargnés. À l’inverse, d’autres filières, déjà fragilisées par des droits antérieurs, voient leur situation se détériorer. L’industrie automobile, qui avait été affectée par un tarif de 27 % lors du retour de M. Trump aux affaires, voit sa « casse » limitée par le retour à un taux de 15 %. La mesure reste cependant lourde pour des filières qui n’étaient auparavant taxées qu’à hauteur de 2,5 % sous l’ancienne administration américaine.
Des secteurs français particulièrement concernés
Parmi les principaux secteurs exportateurs français touchés, le dossier des cosmétiques apparaît en première ligne : 2,8 milliards d’euros d’exportations vers les États‑Unis en 2024, soit 12,6 % des exportations françaises, figurent parmi les activités citées comme perdantes. Le luxe et l’industrie pharmaceutique sont également concernés. Jusqu’à présent exonérés, certains médicaments vont subir le taux de 15 %. Le texte précise toutefois que certains médicaments génériques pourraient faire l’objet d’exemptions ; la liste des produits concernés n’est pas encore arrêtée.
Le vin et les spiritueux forment un autre secteur fortement atteint : l’équivalent de 4 milliards d’euros d’exportations vers les États‑Unis est exposé au même taux de 15 %. Le ministère des Finances français (Bercy) considérait qu’il s’agissait d’un échec, ayant plaidé activement pour une exemption totale de ces marchandises.
Au total, plusieurs exportateurs européens se disent perdants ou inquiets, même si des exemptions ciblées limitent l’impact pour certaines industries.
Un accord « feuille de route » entre UE et États‑Unis, mais des zones d’ombre
Le 27 juillet dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a indiqué être parvenue à négocier un accord avec le président américain pour éviter que l’addition ne soit encore plus salée. Cet accord, signé le 27 juillet, est décrit par l’institution européenne comme une « sorte de feuille de route » précisant la trajectoire souhaitée, mais il n’est pas « juridiquement contraignant », a souligné un porte‑parole de la Commission en conférence de presse.
Le deal prévoit, selon les éléments rendus publics, des achats européens de produits énergétiques (gaz naturel, combustibles nucléaires et pétrole) aux États‑Unis d’un montant estimé à 750 milliards de dollars sur les trois prochaines années et des investissements européens outre‑Atlantique de l’ordre de 600 milliards de dollars. Reste que le flou demeure sur les mécanismes de compensation et sur la capacité de l’Union à engager des dépenses liées aux investissements réalisés par des entreprises européennes : « La Commission ne peut pas dicter ce qui sera fait, mais elle parle avec les entreprises et industries pour savoir quelles sont leurs intentions », a précisé le porte‑parole.
Ces « zones d’ombre » autour de l’accord laissent présager de nouvelles discussions bilatérales et internes à l’Union européenne pour définir les modalités concrètes des échanges et des compensations.
Réaction française et perspectives
La France a exprimé son mécontentement. Le président de la République, Emmanuel Macron, aurait déclaré lors du Conseil des ministres du mercredi 30 juillet : « Ce n’est pas la fin de l’histoire, nous n’en resterons pas là ». Selon plusieurs membres du gouvernement, la teneur de l’accord négocié par la Commission ne satisfait pas Paris. Le chef de l’État a été cité avec une phrase plus polémique, « Pour être libre, il faut être craint. Nous n’avons pas été assez craints », au sujet des relations avec les États‑Unis ; la phrase a été reprise dans le compte rendu des échanges publics.
Sur le plan politique et économique, l’application des nouveaux droits de douane ouvre une période d’incertitudes pour les entreprises européennes et françaises. Si certaines branches obtiennent des exemptions, d’autres devront intégrer un renchérissement des coûts d’accès au marché américain. Les discussions engagées entre Bruxelles et Washington, et les consultations avec les entreprises, détermineront l’ampleur effective des impacts dans les mois à venir.