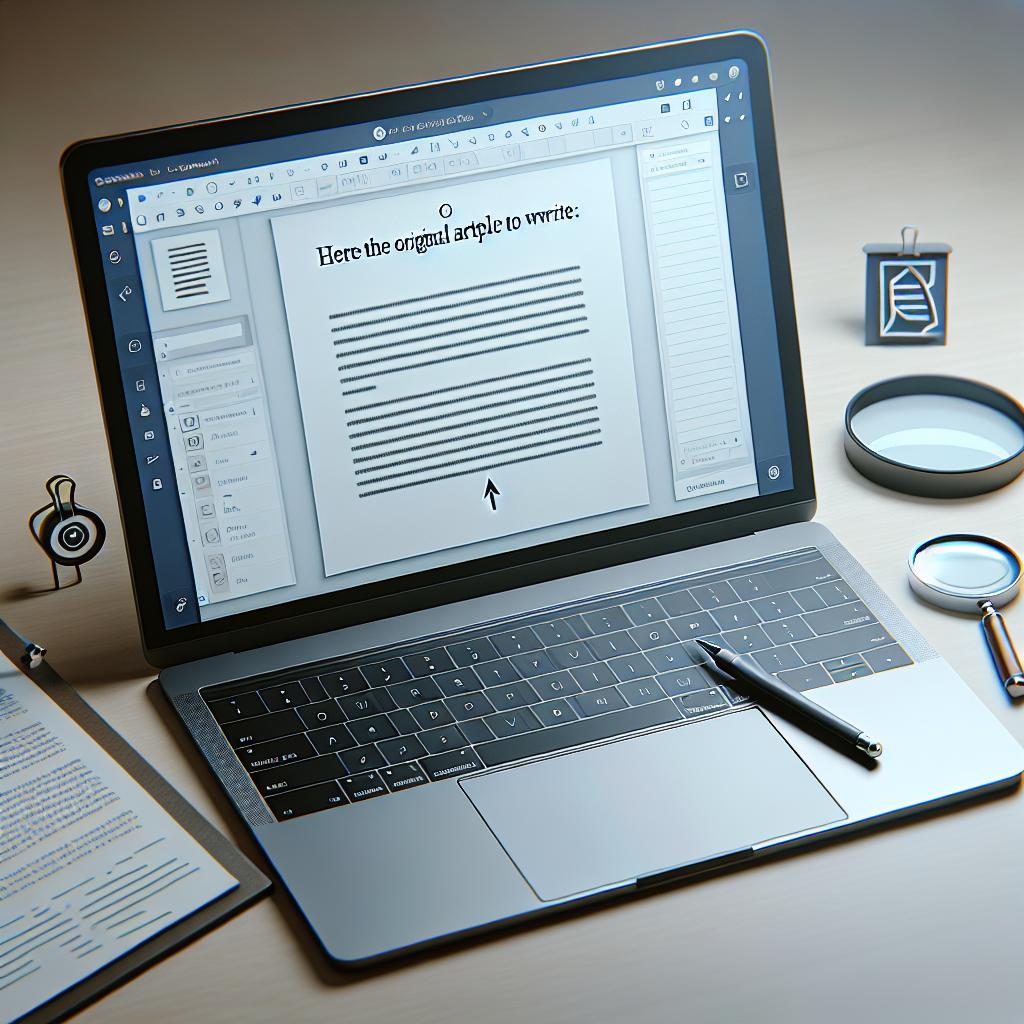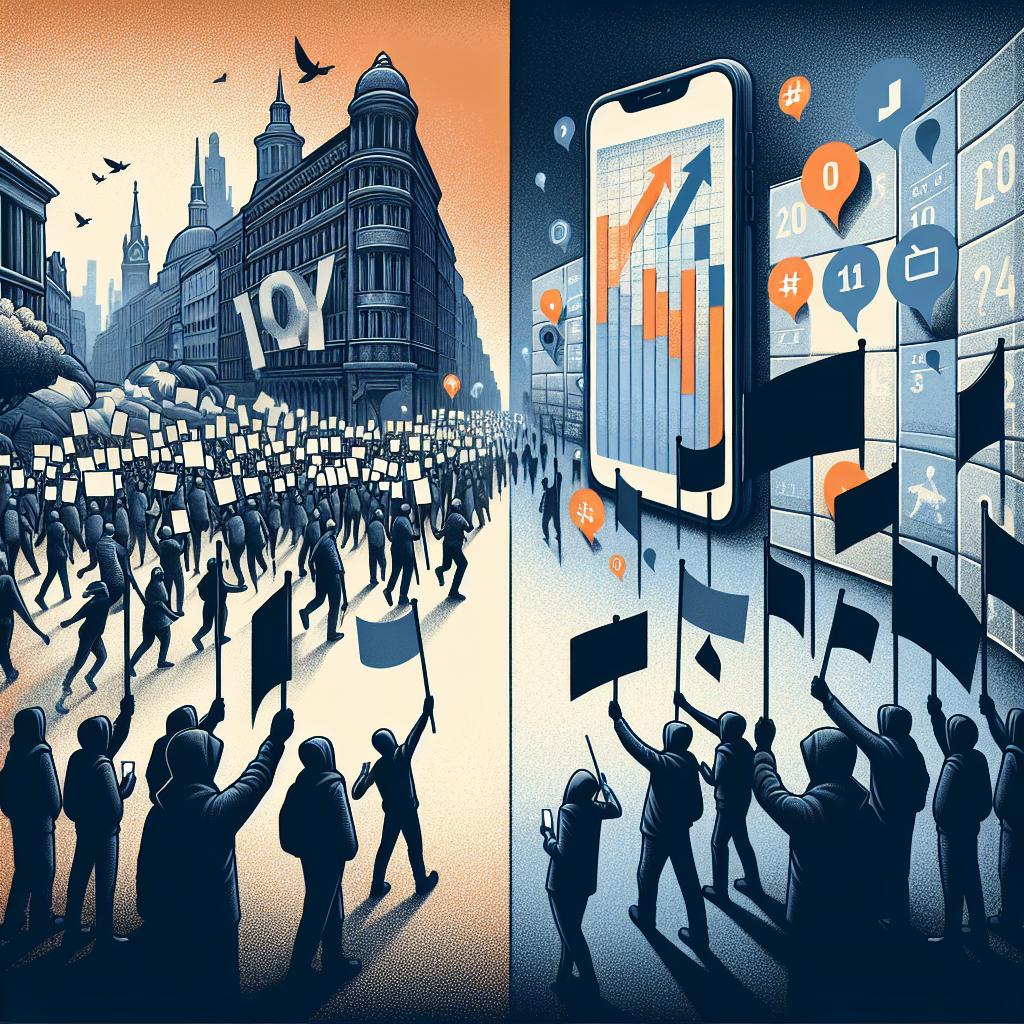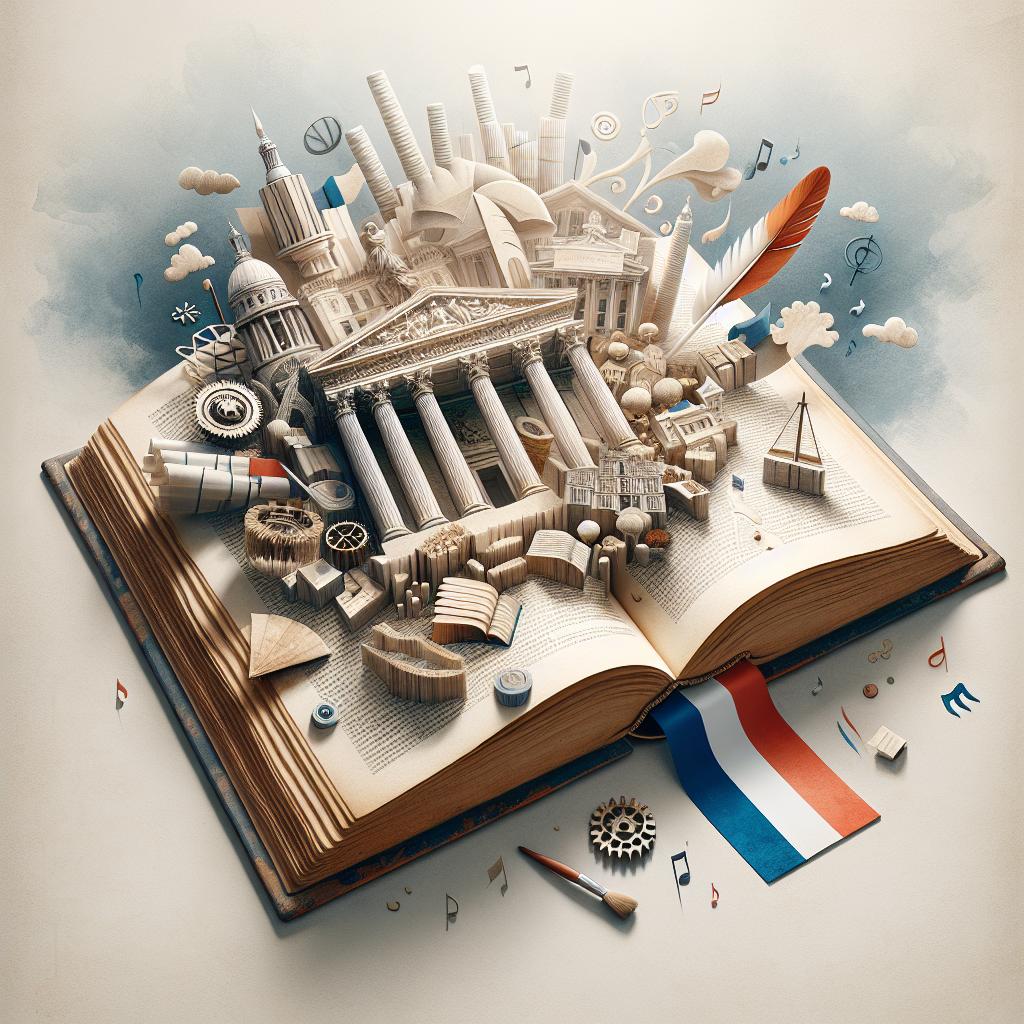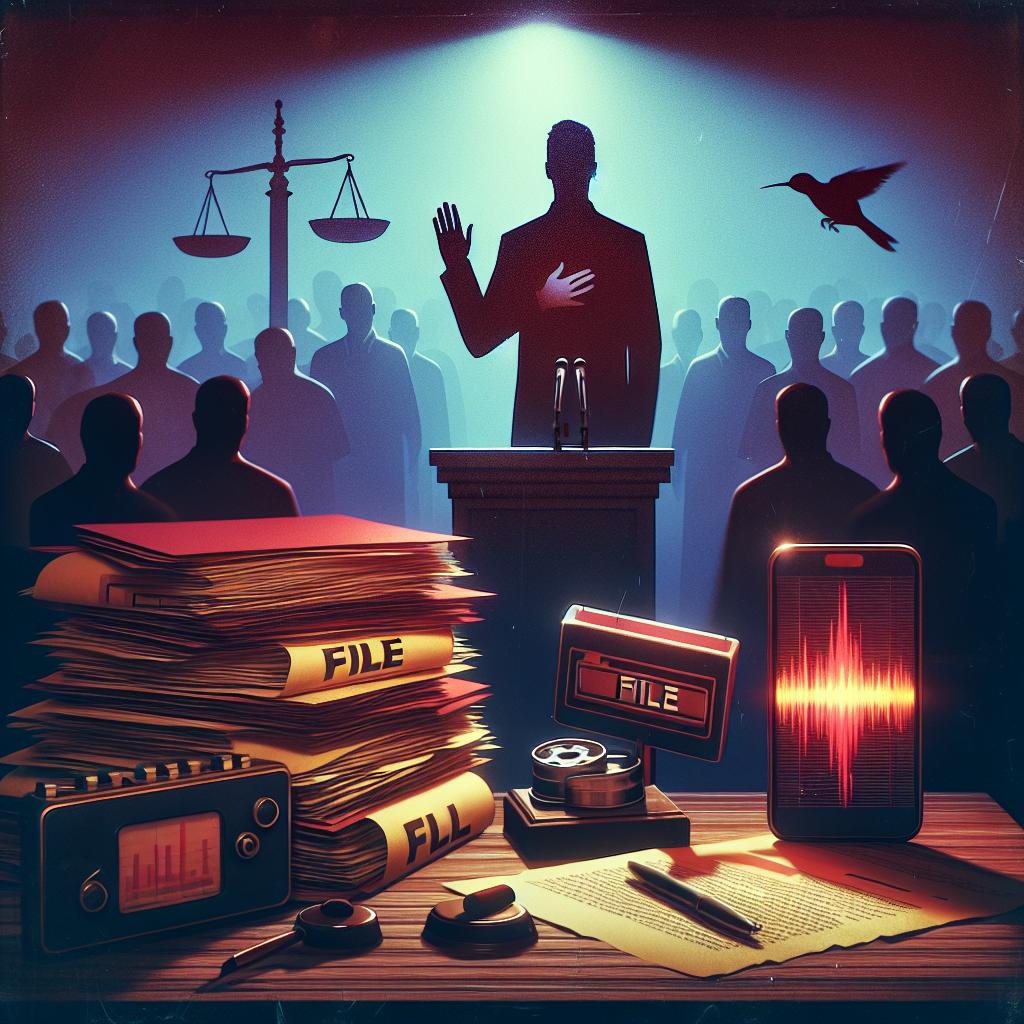Le 25e conseil des ministres franco-allemand, qui s’est tenu vendredi 29 août à Toulon, a confirmé un constat déjà observable depuis l’arrivée de Friedrich Merz à la Chancellerie : Emmanuel Macron a trouvé un interlocuteur partageant des ambitions réformatrices et un volontarisme européen similaires. Cette relation chaleureuse, établie entre les deux chefs d’État, tranche nettement avec la cordialité plutôt contrainte qui avait marqué les relations entre la France et l’Allemagne sous Olaf Scholz.
Un rapprochement politique aux airs de nécessité
Face aux bouleversements géopolitiques et aux tensions commerciales conduites par la politique américaine, la convergence entre Paris et Berlin apparaît comme un élément stratégique pour l’Union européenne. À Toulon, les deux dirigeants ont affiché une volonté commune de dépasser des désaccords récents sur des dossiers sensibles : l’énergie, le commerce, l’espace, le numérique et la défense.
Ils ont également réaffirmé leur engagement à soutenir l’Ukraine et à se positionner « aux avant-postes » pour garantir la sécurité du continent. Ces déclarations soulignent l’importance symbolique et politique d’un tandem franco-allemand resserré, mais n’apportent pas de détails nouveaux sur les moyens concrets destinés à traduire ces objectifs.
Feuille de route : intentions sans détails opérationnels
La « feuille de route » présentée à l’issue de la réunion vise à surmonter les points de friction des dernières années. Pourtant, plusieurs dossiers demeurent flous ou non résolus. Le futur système de combat aérien, par exemple, reste au point mort, et le contentieux autour de l’accord de libre-échange négocié avec les pays du Mercosur n’a pas été réglé.
Autrement dit, l’accord politique existe ; les étapes concrètes pour le mettre en œuvre, elles, sont encore largement à écrire. Les déclarations publiques, même répétées, ne suffiront pas si elles ne s’accompagnent pas de calendriers, de budgets et d’engagements opérationnels précis.
Stable sur le papier, précaire sur le terrain
Les intentions affichées coïncident avec une réalité politique fragile pour chacun des dirigeants. Cent jours après son arrivée au pouvoir, Friedrich Merz bénéficiait de 32 % d’opinions favorables, contre 56 % pour Olaf Scholz et 74 % pour Angela Merkel au même stade de leur mandat, selon les chiffres rapportés lors des discussions. L’Allemagne a franchi la barre des 3 millions de chômeurs pour la première fois depuis 2015, et la coalition de M. Merz souffre de dissensions internes.
En parallèle, l’extrême droite approche les 25 % d’intentions de vote, un niveau sans précédent en Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En France, la situation politique d’Emmanuel Macron est décrite comme encore plus précaire : la chute annoncée du gouvernement de François Bayrou, prévue le 8 septembre, menace d’instaurer une nouvelle crise politique qui viendrait s’ajouter à des difficultés économiques et budgétaires déjà présentes.
Ces éléments illustrent une réalité : souhaits et déclarations d’intention ne pèsent que si les exécutifs disposent d’une assise politique suffisante pour transformer les mots en actes.
Discours et réalité : le défi de la mise en œuvre
À Toulon, Emmanuel Macron a tenté de rassurer. Il a promis d’« exercer jusqu’à son terme » le « mandat qui [lui] a été confié par les Français » et a écarté l’hypothèse d’une nouvelle dissolution de l’Assemblée nationale, qualifiant de « politique-fiction » cette éventualité. Il a aussi affirmé que la feuille de route signée avec l’Allemagne « engageait la France dans sa continuité ».
Friedrich Merz a salué un redémarrage : « Le moteur franco-allemand a redémarré », a-t-il déclaré. Reste que pour fonctionner durablement, ce « moteur » exige non seulement la volonté politique mais aussi la stabilité institutionnelle et des marges de manœuvre budgétaires et stratégiques, conditions dont la France, tournée vers une rentrée politique incertaine, semble moins assurée pour l’instant.
En définitive, la rencontre de Toulon a confirmé une étape diplomatique importante entre Paris et Berlin. Elle a toutefois laissé subsister des inconnues majeures sur la traduction concrète de la coopération annoncée, au moment où les deux pays affrontent des défis économiques et un contexte politique interne fragilisé.