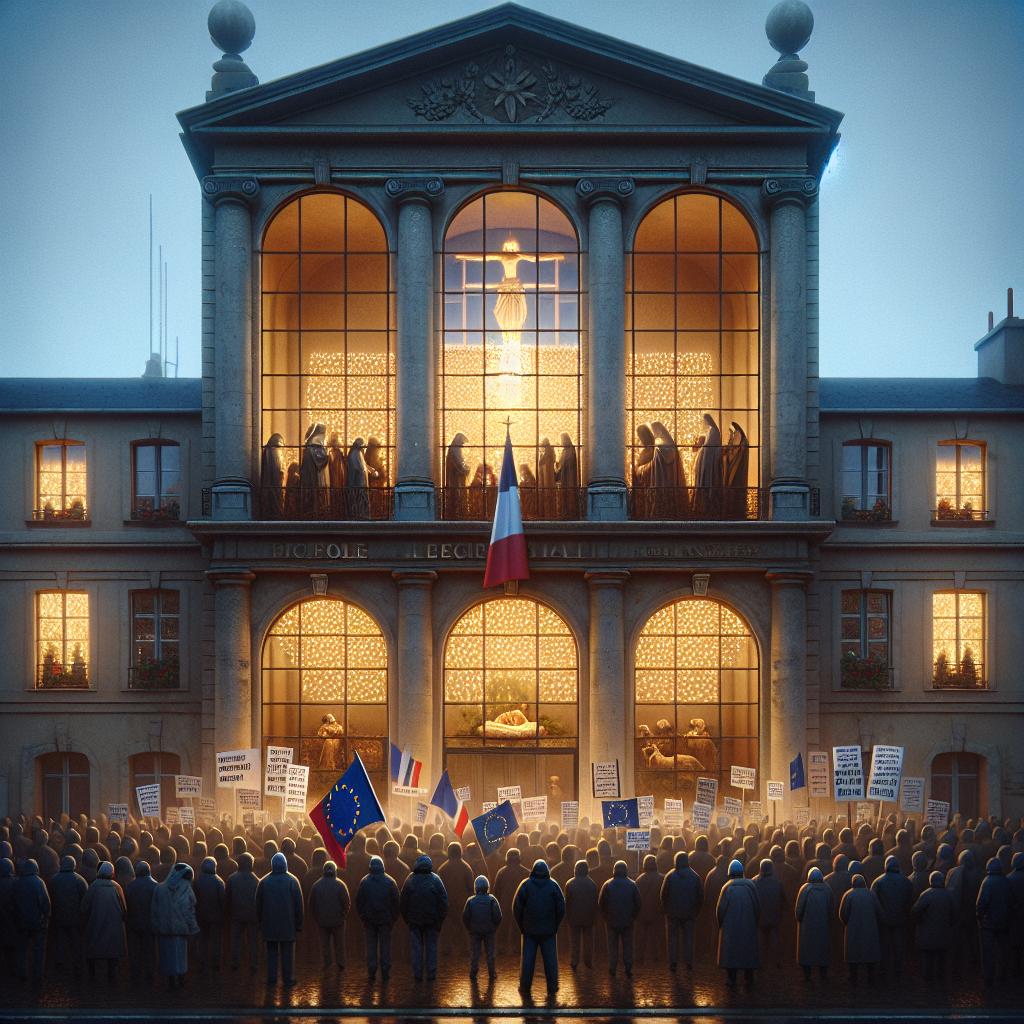« Au cash citoyen. » Le 10 septembre, plusieurs groupes contestataires se réclamant de l’héritage des « gilets jaunes » ont lancé un mot d’ordre nouveau : la grève de la carte bancaire. Selon le texte de l’appel, il s’agit d’éviter l’usage de la carte pour privilégier le paiement en espèces, action présentée comme une forme de désobéissance économique ciblée.
Un mot d’ordre simple et revendiqué
Pour l’un des collectifs les plus impliqués dans l’organisation du mouvement, baptisé « Opérations spéciales », la grève de la carte est décrite comme « simple, pacifique, radicale ». Cette formulation traduit la volonté de proposer un mode d’action accessible au plus grand nombre, sans recourir à la violence ni à des perturbations matérielles massives.
Dans le message des organisateurs, l’idée d’une forme d’action individuelle mais concertée revient plusieurs fois : chaque participant private son usage de la carte, sans qu’il soit nécessaire de se rassembler physiquement pour bloquer un point précis. Le slogan « Au cash citoyen » synthétise cette approche, en opposant l’usage des espèces à celui des systèmes de paiement dématérialisés.
De l’unité estivale à la diversité des modes opératoires
Selon les informations disponibles, la grève de la carte bancaire est la première action concrète sur laquelle ces groupes sont parvenus à se rassembler pendant l’été. L’appel mentionne ensuite un élargissement du répertoire d’actions : à mesure que de nouveaux collectifs ou sympathisants se sont ralliés, d’autres modes opératoires ont été ajoutés au mot d’ordre initial « Bloquons tout ».
Cette évolution, telle qu’elle est présentée, illustre une stratégie double : proposer d’abord une action simple et immédiatement mobilisable, puis multiplier les leviers de pression en fonction des soutiens et des circonstances. Le texte ne précise ni l’ampleur attendue de la mobilisation, ni les modalités pratiques de suivi ou d’évaluation de l’action.
Pourquoi cette tactique est qualifiée d’atypique
En France, les formes classiques de mobilisation sociale – manifestations, grèves sectorielles, occupations – obéissent souvent à des codes et à des calendriers connus. Appeler à une « grève des paiements par carte » rompt avec ces cadres, en agissant sur une routine économique individuelle plutôt que sur une infrastructure collective visible.
Le sociologue Federico Tarragoni, spécialiste des populismes, commente ce choix tactique en observant : « Il y a l’idée que pour qu’un mouvement social réussisse, il faut sortir des chemins attendus et faire peur au pouvoir, car le macronisme a inventé une sorte d’indifférence programmée vis-à-vis des mouvements sociaux “routiniers” ». Sa remarque souligne la recherche d’effet politique par la disruption des habitudes, plus que par la confrontation directe.
Le qualificatif d’« atypique », suggéré dans le message initial, renvoie à cette discontinuité par rapport aux modes d’action traditionnels. Il met aussi en lumière la difficulté des mouvements à capter l’attention dans un paysage social où certains types de manifestations sont devenus routiniers et, selon leurs détracteurs, moins efficaces.
Limites et incertitudes
Le matériel fourni ne donne pas de chiffres sur le nombre de participants attendus ni d’éléments précis sur l’impact économique visé. Il reste également flou sur les modalités de coordination entre les différents collectifs et sur la durée de l’appel à la grève de la carte bancaire.
Ces zones d’ombre rendent difficile une évaluation fine de la portée réelle de l’action. Elles invitent à distinguer, dans le discours des organisateurs, l’intention stratégique — proposer une action simple, pacifique et disruptive — et l’efficacité potentielle, qui dépendra du niveau d’adhésion et de la capacité à maintenir le geste sur la durée.
Au final, la grève de la carte bancaire proclamée le 10 septembre apparaît comme une tentative de diversification des modes d’action des héritiers des « gilets jaunes ». Elle illustre la recherche de formes de mobilisation plus diffusives et moins codifiées, tout en soulevant des questions sur son ampleur et son impact effectifs.