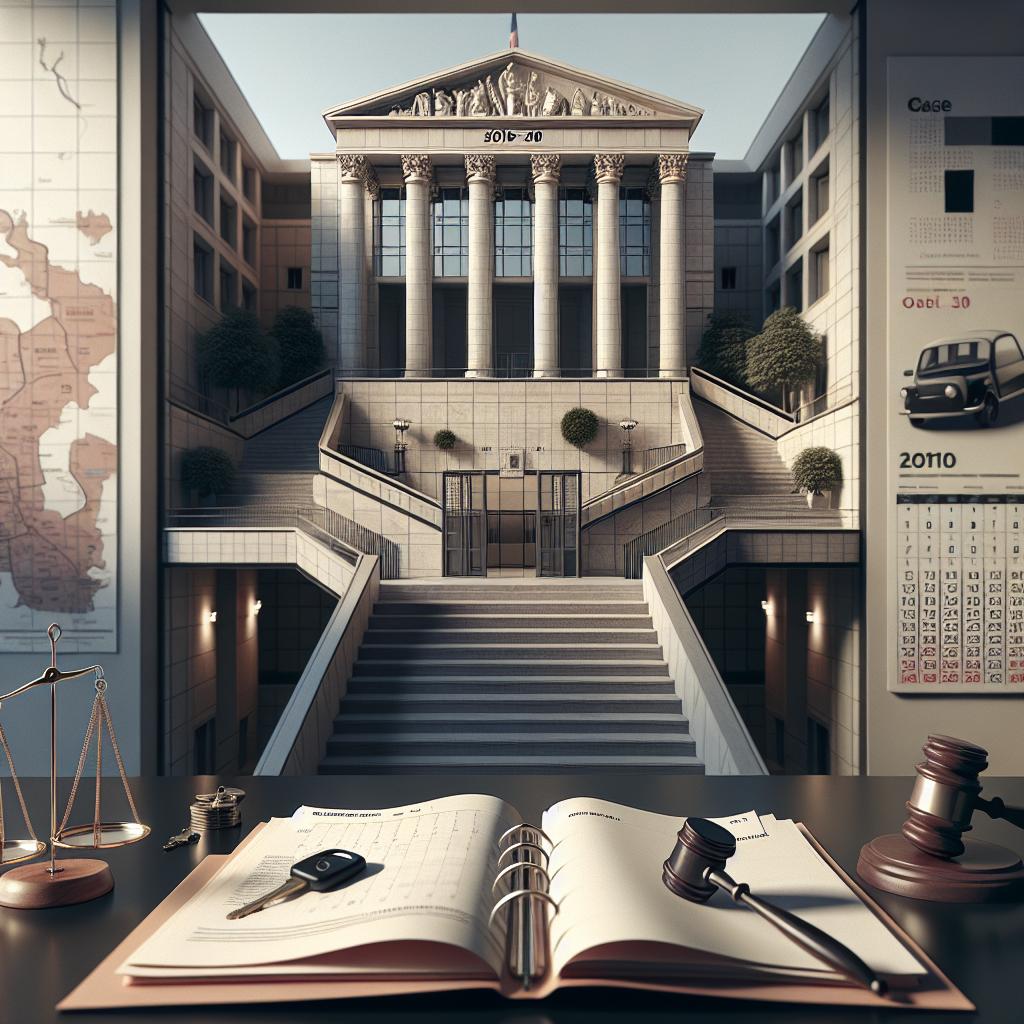La France se trouve aujourd’hui dans une configuration politique peu coutumière : depuis les législatives de 2022, aucun camp politique ne dispose d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale. La fragmentation de l’hémicycle s’est encore accentuée après le nouveau scrutin de 2024, rendant la formation d’une coalition gouvernementale à la fois plus nécessaire et plus complexe pour rassembler un soutien parlementaire suffisant.
Une recomposition inédite en France
Arrivé en tête le 7 juillet 2024, le Nouveau Front populaire (NFP) — alliance électorale de partis de gauche — compte environ un tiers des sièges à l’Assemblée nationale : 190 députés sur 577. L’ancienne majorité présidentielle (Renaissance, MoDem et Horizons) réunit quant à elle 161 élus, contre 138 pour le Rassemblement national (RN) et ses alliés de l’Union des droites pour la République (UDR).
Historiquement, les gouvernements de coalition sous la Ve République ont plutôt réuni des partis proches idéologiquement, ce qui a limité les divisions majeures au sein de la majorité. Parmi les précédents cités figurent les gouvernements socialistes de Pierre Mauroy dans les années 1980, la « gauche plurielle » dirigée par Lionel Jospin (1997-2002) et diverses grandes majorités rassemblant la droite modérée sous Jacques Chirac ou des alliances contemporaines autour d’Emmanuel Macron.
Pourtant, la vie politique française n’a pas l’habitude de voir des adversaires traditionnels s’unir pour gouverner. Le système majoritaire à deux tours tend, en théorie, à favoriser l’émergence d’un bloc capable de gouverner seul, appuyé par une majorité absolue de députés. La donne change cependant dès lors que l’hémicycle est fragmenté : la nécessité de compromis entre forces aux positions éloignées devient alors centrale.
Le recours aux coalitions en Europe : diversité de modèles
À l’échelle européenne, la coalition est la règle dans la quasi-totalité des États membres de l’Union. Seules la Grèce et Malte sont, selon le contexte présenté ici, gouvernées par un seul parti. Dans la plupart des autres pays, des forces politiques plus ou moins divergentes se sont accordées pour exercer le pouvoir.
Plusieurs exemples récents illustrent la diversité des arrangements. En Espagne, à la suite des élections anticipées de juillet 2023, Pedro Sánchez a constitué une coalition de centre-gauche dirigée par le PSOE et associant le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), le Parti des socialistes de Catalogne (PSC) et l’alliance Sumar, avec le soutien sans participation de partis nationalistes régionaux.
En Italie, l’exécutif formé en 2022 regroupe des partis de droite et d’extrême droite — Frères d’Italie (FdI), la Ligue (Lega) et Forza Italia (FI) — sous la présidence du Conseil Giorgia Meloni. Cette coalition détient une majorité confortable, évaluée ici à environ 59 % des sièges de la Chambre des députés.
Plus au nord, la Suède illustre un autre modèle : le gouvernement formé en octobre 2022 par les modérés, les chrétiens-démocrates et les libéraux fonctionne en minorité, avec un soutien parlementaire externe mais sans participation des principaux partis d’extrême droite. Ce type d’arrangement oblige à des compromis réguliers et suscite des tensions internes sur des dossiers sociaux et politiques.
Conséquences institutionnelles et pratiques
Dans les démocraties proportionnelles, la fragmentation oblige les gouvernements à négocier en continu. En Allemagne, par exemple, la grande coalition (« GrosKo ») entre partis chrétiens et sociaux-démocrates est devenue un mode de gouvernement fréquent, associant des forces parfois éloignées sur certains sujets mais capables d’assurer une majorité parlementaire.
Au Parlement européen, l’hémicycle n’a jamais vu un groupe parlementaire obtenir seul la majorité absolue des sièges. Depuis les élections européennes de 2019, et plus encore après celles de 2024, le paysage est devenu plus fragmenté : l’adoption de textes nécessite désormais l’appui d’au moins trois groupes politiques — le plus souvent les conservateurs (PPE), les sociaux-démocrates (S&D) et les libéraux (Renew) — ce qui complique la procédure législative et impose davantage de compromis.
Quand un exécutif est minoritaire au Parlement, il doit souvent obtenir le soutien de partis extérieurs à l’exécutif pour ne pas tomber. Ces soutiens sont généralement conditionnés à des engagements (réformes, postes, concessions), ce qui complexifie la mise en œuvre d’une ligne gouvernementale cohérente et stable.
Au final, la situation française, marquée par une Assemblée fragmentée, rapproche le pays de la réalité politique observée dans de nombreux États européens : gouverner exige aujourd’hui davantage d’alliances, de négociations et de compromis — quels que soient les risques d’instabilité ou les tensions internes qui en résultent.