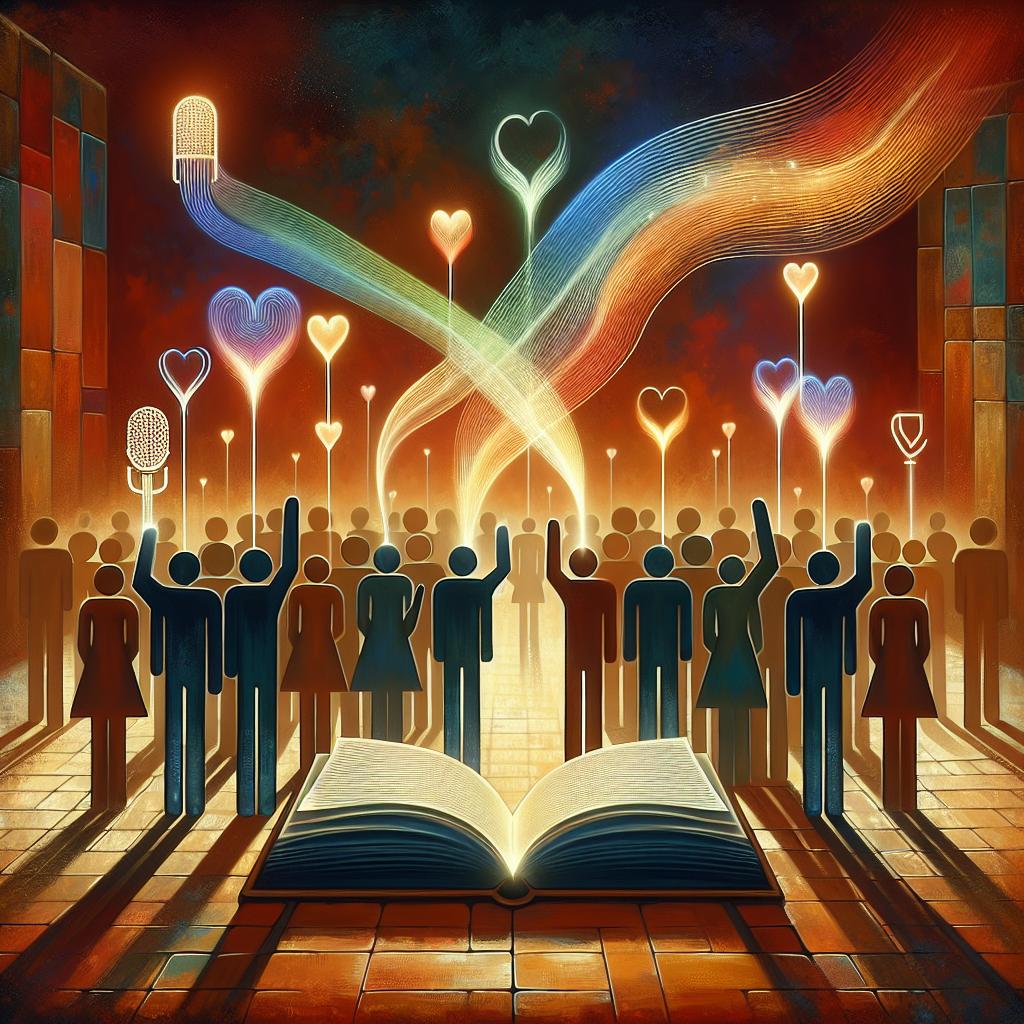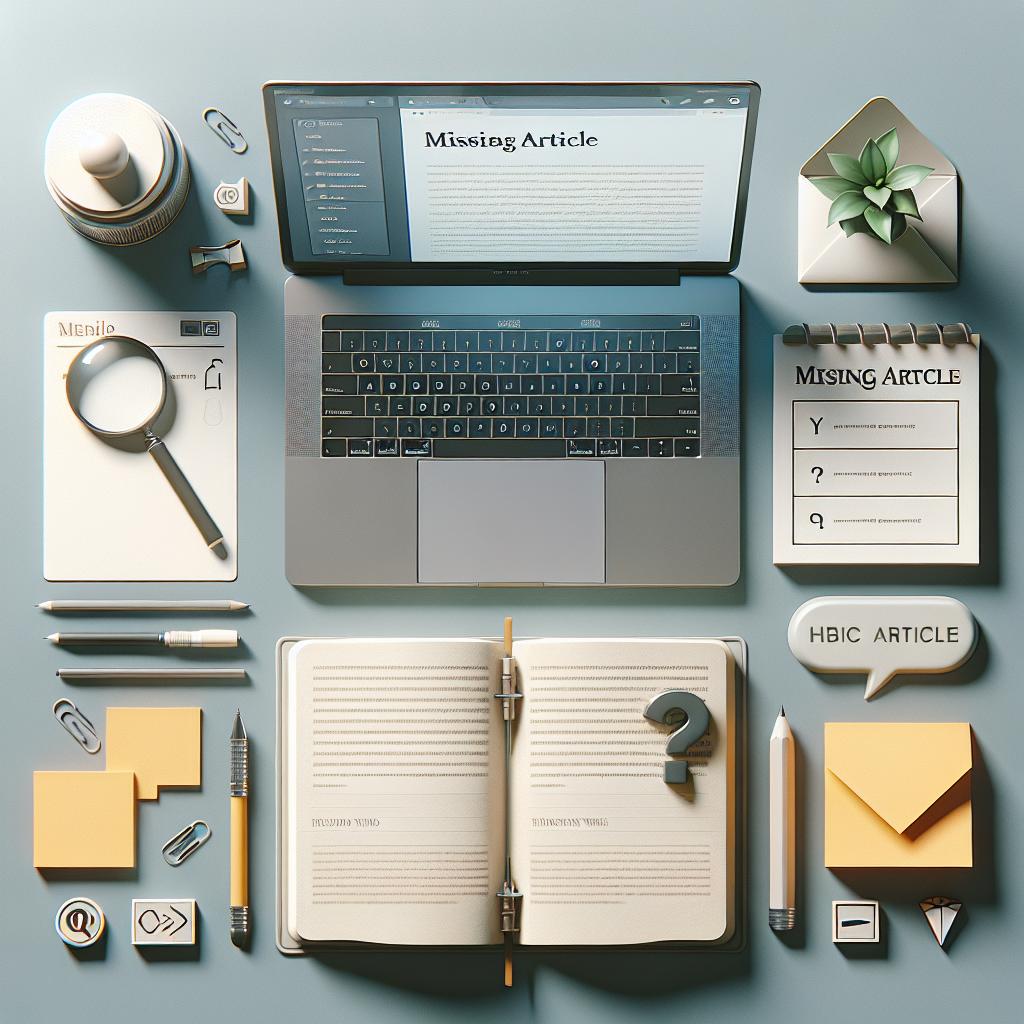Nos luttes ne se réduisent pas à des positions idéologiques : elles sont traversées par des émotions qui structurent les manières d’agir et de résister. C’est le constat central de Résistances affectives (La Découverte, 248 pages, 19,50 €), où l’anthropologue Chowra Makaremi examine « les façons d’agir, de tenir, de se recomposer, fondées sur nos mémoires émotionnelles et les savoirs issus de nos vies affectives ». L’ouvrage prolonge et élargit la réflexion entamée dans son essai précédent consacré au soulèvement iranien contre le port du voile.
Redéfinir le lien entre raison et émotion
Makaremi interroge la séparation classique entre raison et émotion héritée de la tradition européenne. Pour elle, le rejet des affects au profit d’un rationalisme froid a des conséquences politiques : il produit « un dehors que le politique a délimité pour se légitimer », une frontière qui exclut des groupes considérés comme inaptes à la délibération publique — femmes, enfants, étrangers.
L’auteure ne s’oppose pas à la raison mais critique l’idée selon laquelle la décision publique doit être indépendante des passions. À ses yeux, l’émotion n’est pas une menace pour la raison « comme le chaos menace l’ordre » : elle constitue « une autre forme de vérité qui passe par le corps et la voix ». Ce déplacement conceptuel vise à reconnaître la valeur cognitive et politique des expériences affectives, jusqu’à les remettre au centre des stratégies collectives.
Comprendre l’émergence des révoltes
Une interrogation traverse l’essai : pourquoi l’injustice tolérée hier provoque-t-elle l’insurrection aujourd’hui ? Makaremi invite à penser l’indignation comme un « mouvement politique plus compliqué qu’il n’y paraît », dont la force dépend à la fois de mémoire, de transmission et d’une capacité à transformer les affects en pratiques collectives. Le livre s’inscrit ainsi dans un sillon qui mobilise des travaux en sciences sociales, en éthique et en écologie du vivant pour récuser le dualisme raison/émotion et en mesurer les effets politiques.
L’auteure montre comment des mobilisations contemporaines — en particulier celles portées par des femmes — ont redonné visibilité au rôle du corps et de la voix dans l’espace public. Ces formes d’expression ont servi de leviers pour passer d’un sentiment d’injustice à des actions coordonnées, en transformant des vécus intimes en revendications partagées.
Une trajectoire personnelle qui éclaire l’analyse
Chowra Makaremi, rattachée à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), ne sépare pas son travail scientifique de son histoire personnelle. Ses travaux prolongent l’enquête qu’elle a menée dans Femme ! Vie ! Liberté ! Echos d’un soulèvement révolutionnaire en Iran (La Découverte, 2023), où elle analysait le mouvement de révolte contre le voile et l’interprétait comme l’amorce d’un possible basculement révolutionnaire.
Son engagement est aussi marqué par un passé familial douloureux : la mère et la tante de la chercheuse, opposantes au régime de l’ayatollah Khomeyni, ont été incarcérées et assassinées dans les années 1980, un épisode qu’elle a évoqué dans son film documentaire Hitch, une histoire iranienne (2019). Ces éléments biographiques, cités par l’auteure, participent à la manière dont elle conçoit la relation entre mémoire, émancipation et action politique.
Enjeux et portée de l’ouvrage
Par son angle d’analyse, Résistances affectives invite à repenser les normes de la délibération publique et les critères de légitimité du politique. En faisant place aux savoirs issus des vies affectives, l’essai propose une lecture des mouvements contemporains qui ne réduit pas l’émotion à un simple moteur irrationnel, mais la considère comme une ressource conceptuelle et pratique.
L’ouvrage se situe à la confluence de plusieurs disciplines et s’adresse autant aux lecteurs intéressés par les sciences sociales qu’à ceux qui cherchent à comprendre les dynamiques des révoltes récentes. Sans chercher à trancher définitivement des débats théoriques anciens, Makaremi apporte des clés pour restituer la part sensible des luttes politiques et mieux saisir comment les affects contribuent à recomposer l’espace public.