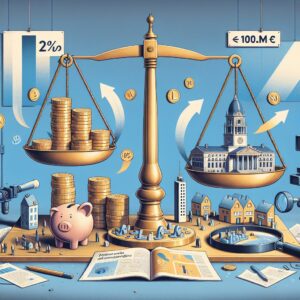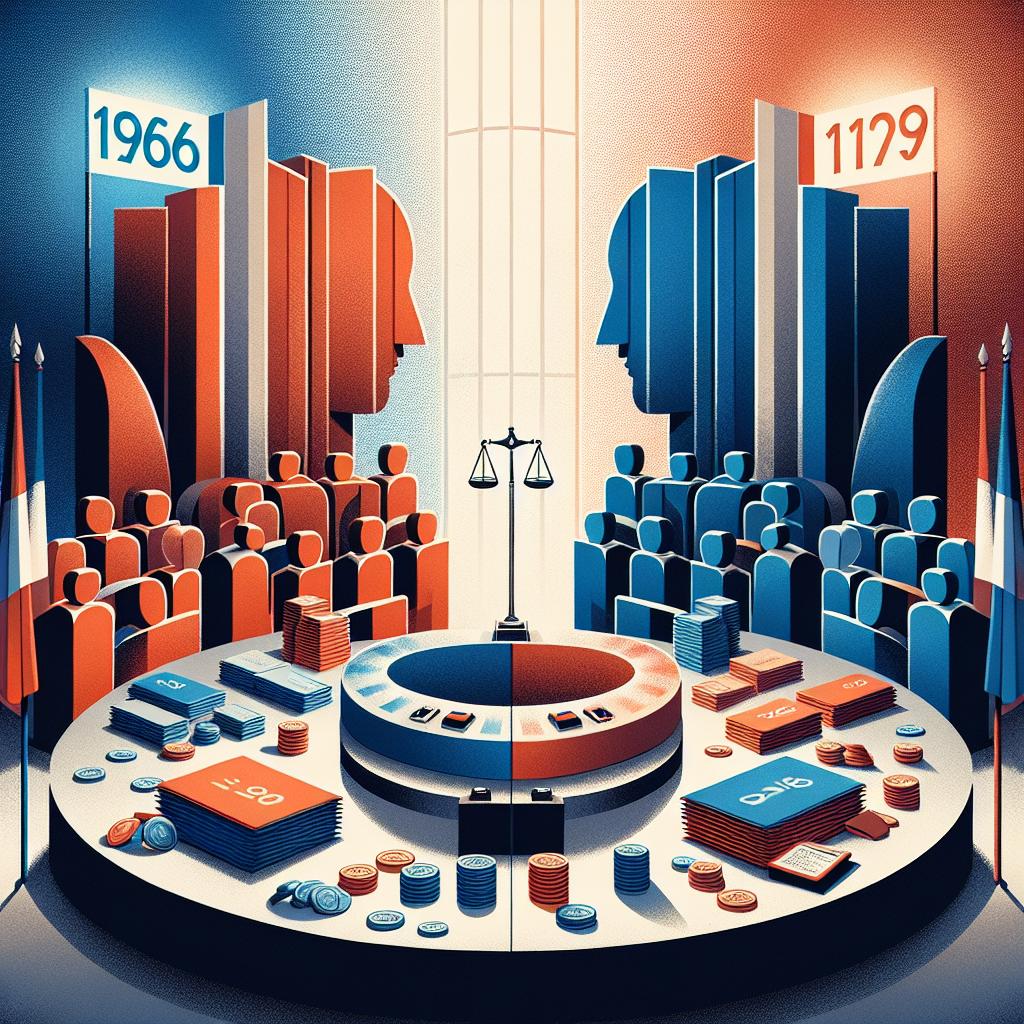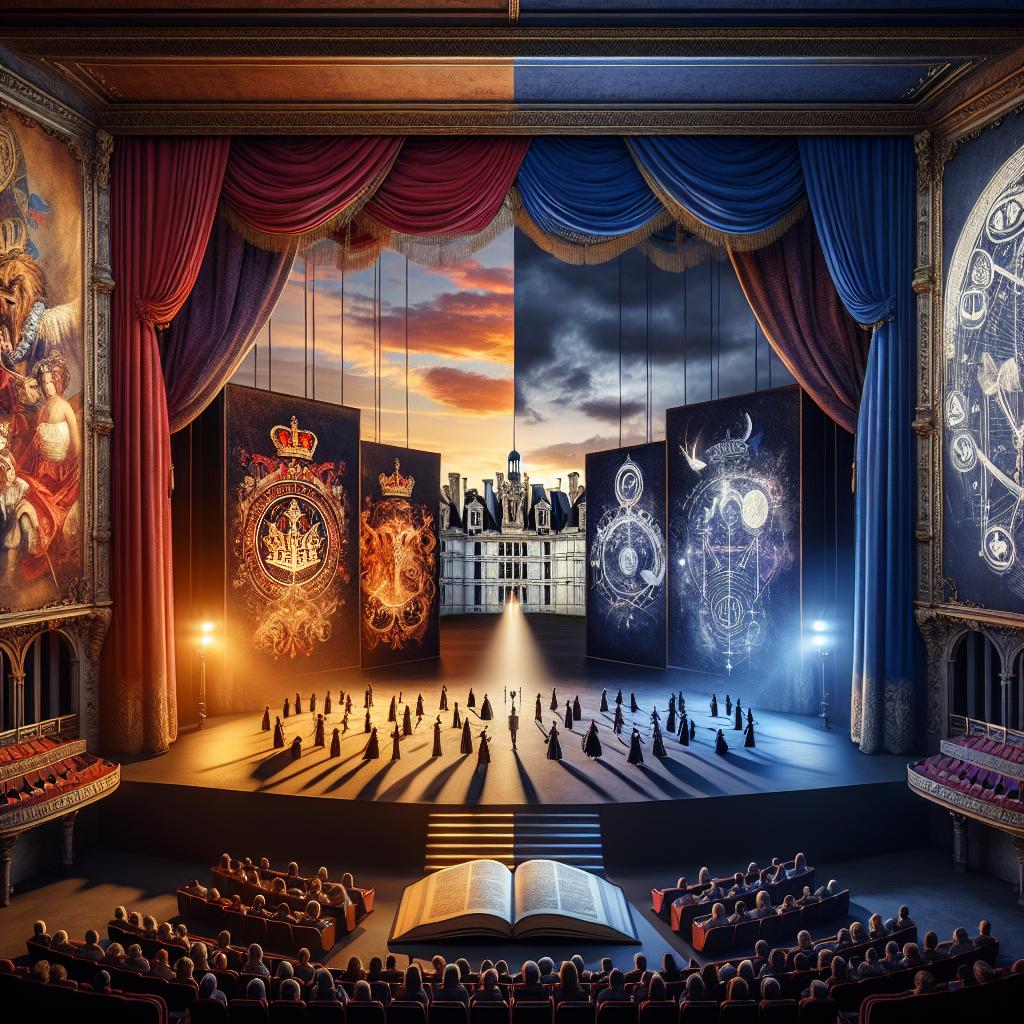Les luttes sociales laissent parfois un goût amer lorsque les résultats attendus ne suivent pas l’intensité de la mobilisation. Comment croire qu’une nouvelle journée d’action intersyndicale puisse infléchir une décision d’État quand, en 2023, quatorze journées de mobilisation n’ont pas suffi à faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites ?
La différence d’estimation des cortèges illustre cette fracture : le ministère de l’intérieur avait alors compté jusqu’à 1,28 million de personnes dans la rue le même jour, tandis que la CGT avançait le chiffre de 3,5 millions. Ces écarts nourrissent le sentiment d’incompréhension et renforcent le découragement ressenti par une partie des salariés.
Un sentiment de découragement partagé
« J’entends très souvent dire “on était des millions, mais le gouvernement est passé quand même”. Les salariés sortis à l’époque sont découragés », constate Teddy Carvigant, élu CGT au comité social et économique d’Auchan Paris Est. Son observatoire du terrain montre que le spectacle des mobilisations massives ne suffit pas à inverser la perception d’impuissance chez nombre de travailleurs.
Au-delà des chiffres, ce sont les témoignages individuels qui rendent compte de la lassitude. « Les salariés nous disent : “Même si on sort, ça ne sert à rien. Bloquer un rond-point comme les ‘gilets jaunes’ non plus. Alors que dois-je faire pour qu’on m’écoute ?” », relate encore Teddy Carvigant. La question met en lumière la difficulté à traduire la colère ou la revendication en résultats tangibles, perceptibles au niveau individuel.
Des causes de mécontentement ancrées dans l’entreprise
Le découragement n’est pas seulement politique ; il est également alimenté par des réalités concrètes dans les entreprises. À Auchan Paris Est, les salariés subissent des licenciements massifs et des fermetures de magasins, rappelle l’élu CGT. Ces événements renforcent la précarité et la défiance, et complexifient la mobilisation collective lorsque chacun fait face à des enjeux personnels immédiats.
Fabienne Dos Santos, déléguée CGT chez Sodexo (restauration collective), décrit une situation qu’elle qualifie de « difficile ». « Le travail est fatigant, mal payé, les plus qualifiés ont profité de la crise du Covid-19 pour changer de métier, et on a depuis beaucoup de mal à embaucher. C’est dur, et cela se manifeste par une montée des tensions entre les équipes », explique-t-elle.
Ces tensions internes pèsent sur la capacité à créer un rapport de force collectif. « Pour autant, chacun reste avec ses problèmes et a du mal à voir qu’un délégué syndical ne peut pas créer un rapport de force seul. Il faut que ça mobilise derrière lui », ajoute Fabienne Dos Santos, soulignant la nécessité d’un engagement plus large et régulier autour de revendications partagées.
Les défis pour les organisations syndicales
Face à ce constat, les syndicats confrontent plusieurs défis. Le premier est de redonner du sens à l’action collective auprès de salariés qui se sentent débordés par des difficultés immédiates : perte d’emploi, conditions de travail dégradées, difficultés de recrutement. Le second consiste à transformer une indignation diffuse en une stratégie cohérente et compréhensible, capable de fédérer au-delà des noyaux militants.
La perception qu’une mobilisation ne suffit pas s’accompagne d’un questionnement tactique. Les salariés évoquent des formes d’action variées, des grèves aux blocages, mais doutent de l’efficacité de ces méthodes si elles ne s’inscrivent pas dans un cadre plus large et durable. Sur le terrain, cela se traduit par une réticence à investir de nouvelles journées d’action quand le bénéfice concret demeure incertain.
Les témoignages recueillis montrent aussi que la sortie de certains salariés pendant la pandémie a modifié la composition des équipes et affaibli des relais locaux. Le départ des profils les plus qualifiés vers d’autres secteurs rend plus difficile la reconstruction d’une base syndicale solide dans certains secteurs, concluent les représentants interviewés.
En filigrane, les propos cités renvoient à une interrogation centrale : comment créer une dynamique collective capable de dépasser la frustration et de produire des résultats visibles ? Les réponses restent partagées et dépendent largement des choix stratégiques des organisations et de la capacité des salariés à se reconnaître dans des revendications communes.
Sans promesses de solutions miracles, les acteurs de terrain insistent sur la nécessité d’un travail de long terme pour reconnecter les actions syndicales aux attentes quotidiennes des salariés, et pour restaurer la confiance indispensable à toute mobilisation durable.