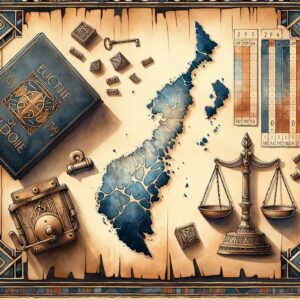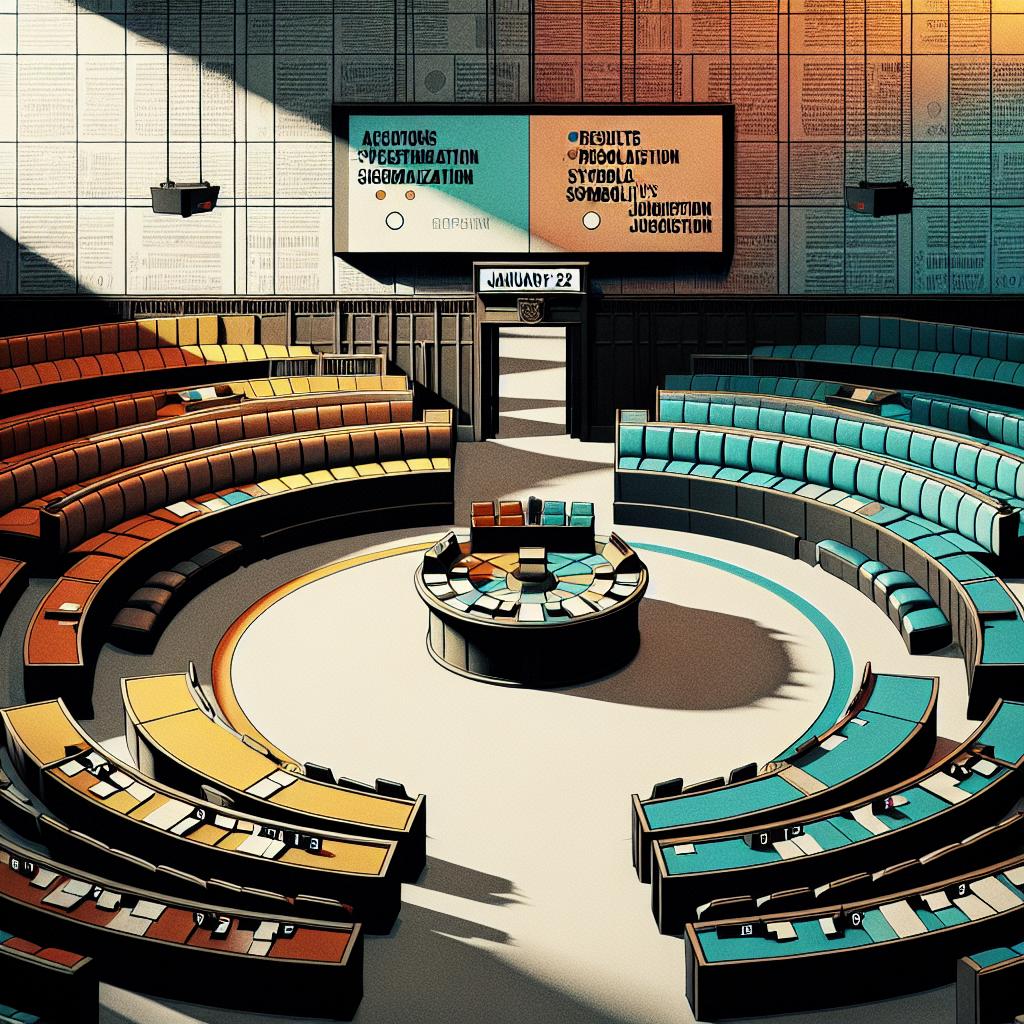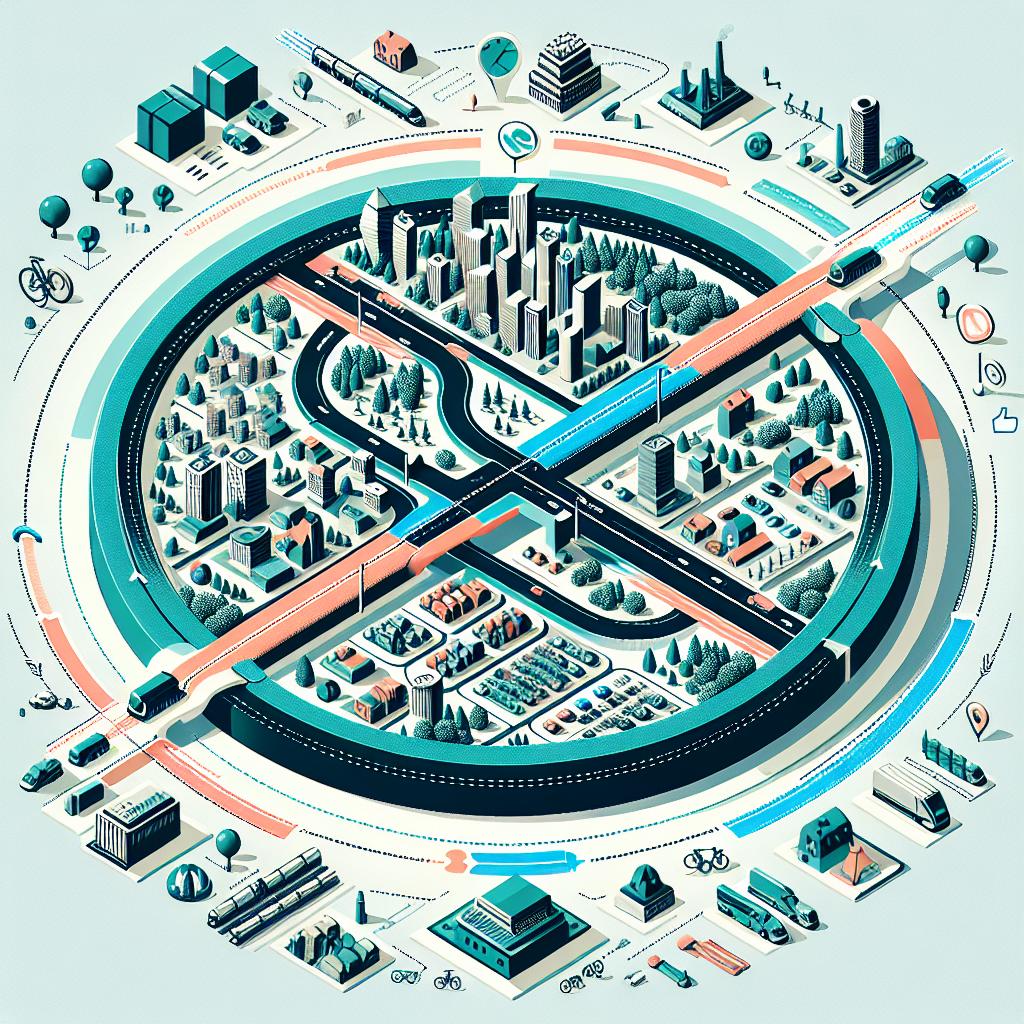Jeudi 18 septembre, la journée de grève et de manifestations organisée à la rentrée a pris une tonalité différente des mobilisations saisonnières habituelles. Plutôt que de contester une réforme précise ou un projet porté par un ministre, le mouvement visait à dénoncer, de façon globale, les inégalités contenues dans le projet de budget 2026 esquissé par François Bayrou et jugé « déjà caduc » par ses opposants.
Un front syndical inédit et une mobilisation massive
Huit organisations syndicales — CFDT, CGT, FO, CFE‑CGC, CFTC, UNSA, FSU et Solidaires — se sont retrouvées unies pour la première fois depuis la contestation de la réforme des retraites en 2023. Le ministère de l’intérieur a évalué la participation à 500 000 personnes, tandis que la CGT revendiquait plus d’un million de manifestants. Les cortèges ont pu défiler sans incident majeur, selon les bilans disponibles.
Ce rassemblement, et l’unité des principaux syndicats, donne à ces organisations un statut d’interlocuteur incontournable pour l’exécutif. Pour Sébastien Lecornu — qui n’a pas encore formé son gouvernement ni précisé ses grandes orientations budgétaires — la manifestation constituait un second avertissement après le mouvement « Bloquons tout » du 10 septembre, perçu comme moins important.
Dialogue social et premières concessions
La montée en puissance des syndicats intervient dans un contexte politique marqué par l’absence de majorité claire à l’Assemblée nationale depuis la dissolution de juin 2024. Cette incapacité des principaux blocs parlementaires à s’accorder sur des mesures susceptibles de réduire le déficit renforce le rôle possible des partenaires sociaux dans une sortie de crise.
Dans la soirée de la mobilisation, M. Lecornu s’est engagé à « poursuivre le dialogue » avec les organisations syndicales. Quelques annonces préalables ont été faites : l’abandon de la suppression de deux jours fériés, proposé initialement par François Bayrou, ainsi que la renonciation à certains avantages accordés aux anciens premiers ministres, déjà actés par M. Lecornu. Ces concessions, si elles marquent un début de réponse, sont jugées insuffisantes par les syndicats.
Revendiquer un « budget de justice »
Sur la place publique, les syndicats réclament un « budget de justice fiscale, sociale et écologique », formule prononcée jeudi par Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT. Les demandes portent notamment sur des mesures fiscales visant à corriger ce que les manifestants décrivent comme une anomalie : les plus grandes fortunes seraient, proportionnellement, moins lourdement imposées que des contribuables plus modestes.
Outre la fiscalité, la réforme des retraites reste un point de crispation. Depuis 2023, ce dossier empoisonne les relations sociales ; les syndicats estiment qu’il faudra des concessions substantielles pour rétablir la confiance. Le monde patronal, et en particulier le Medef, a été appelé à tempérer son intransigeance après l’échec du « conclave » sur les retraites, épisode dans lequel le patronat porte, selon des acteurs du dossier, une part de responsabilité.
Pour dégager une voie politique viable vers le vote d’un budget pour 2026, le gouvernement devra articuler concessions sociales et garanties budgétaires, en évitant d’aliéner soit la gauche parlementaire, soit l’électorat de droite.
Au‑delà des revendications techniques, la mobilisation a exposé une colère plus diffuse : un ressentiment face à l’impression que le système politique « tourne à vide » et que les dirigeants sont déconnectés des réalités quotidiennes. C’est ce malaise latent qui, selon des observateurs, rend la résolution du conflit social plus urgente et plus délicate.
La capacité de Sébastien Lecornu à apaiser les tensions syndicales, à convaincre le Parti socialiste sans braquer la droite ni le patronat, conditionnera en grande partie ses chances de faire adopter un budget 2026 et d’enrayer la paralysie politique actuelle. À défaut, le renouvellement des tensions politiques et sociales risquerait d’accentuer l’instabilité et de profiter aux forces politiques d’extrême droite.