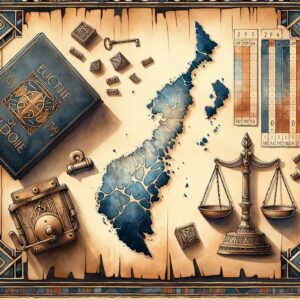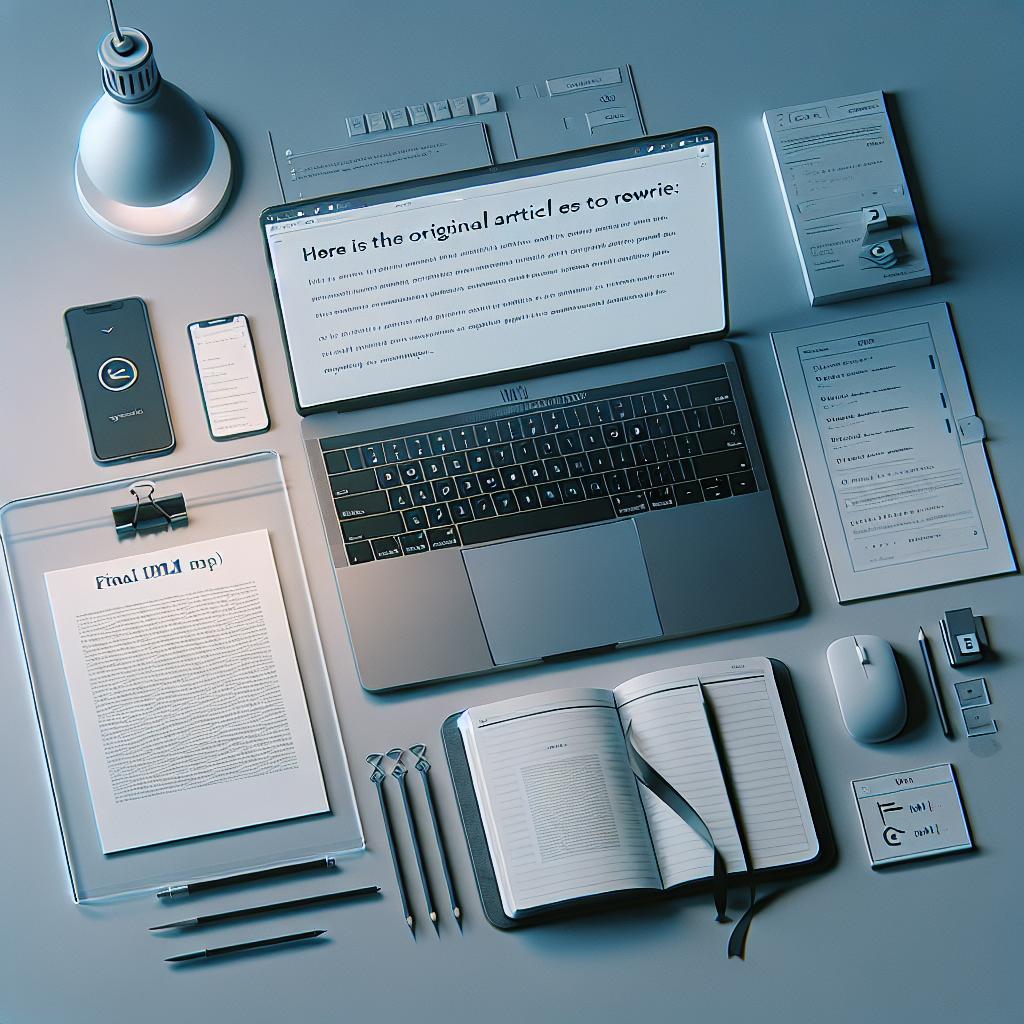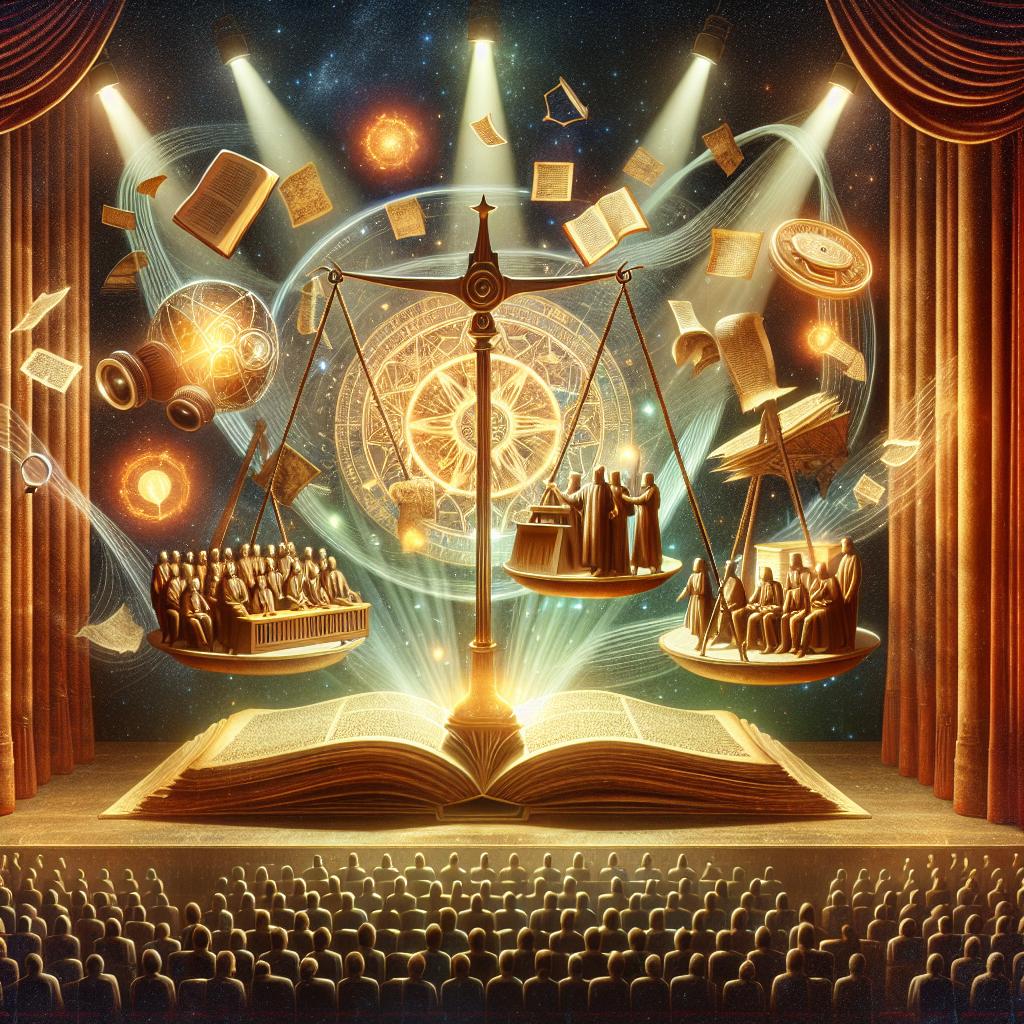Mobilisations rapprochées : du 10 au 18 septembre
La journée d’action intersyndicale du 18 septembre a confirmé une capacité de mobilisation nationale retrouvée : « plus de 500 000 » manifestants selon le ministère de l’intérieur et, selon la CGT, le double. Ces chiffres, dont les écarts reflètent des méthodes de comptage différentes, rappellent les fortes mobilisations du premier semestre 2023 contre le projet de loi sur les retraites, qui n’avaient toutefois pas conduit à un succès politique décisif.
La dynamique observée en septembre ne naît pas d’un seul jour. Elle s’inscrit dans une séquence commencée le 10 septembre autour de l’appel « Bloquons tout », un mot d’ordre diffusé largement sur les réseaux sociaux. Si certaines confédérations, comme la CFDT, ont affiché des réserves à l’égard de ce type d’appel, il est plus utile d’appréhender les deux dates comme liées plutôt que comme disjointes : le 10 septembre a joué le rôle d’un déclencheur informel qui a précipité la convocation des actions du 18.
Rôle des réseaux sociaux et recomposition du calendrier syndical
Le mouvement dit « septembriste », construit en partie sur les réseaux, a perturbé le calendrier que l’intersyndicale envisageait initialement. Sans cette effervescence numérique, l’intersyndicale — qui regroupe huit organisations — envisageait plutôt une mobilisation fin septembre ou début octobre. La poussée autour du 10 septembre a convaincu plusieurs structures professionnelles et territoriales de syndicats (notamment CGT, Solidaires, FSU et FO) d’investir plus tôt l’espace public, physique et numérique.
Cette évolution illustre une recomposition tactique : la capacité des mobilisations à se nourrir d’initiatives spontanées en ligne, tout en restant structurées par des organisations syndicales traditionnelles. Le 10 septembre, sans atteindre la masse du 18, a fourni un point d’appui et un début de dynamique favorable, contribuant à étendre la participation huit jours plus tard.
Chiffres et portée : comparer sans exagérer
L’appel « bloquer tout » n’a pas « bloqué » la France à l’échelle annoncée par certains observateurs, mais il n’a pas été le fiasco prédit non plus. Les services de renseignement territoriaux avaient anticipé une mobilisation moindre ; or, dans certains bilans syndicaux, le 10 septembre a rassemblé entre 250 000 et 300 000 personnes au niveau haut estimé par les organisations de soutien. Ces valeurs rapprochent, en proportions, ce mouvement auto-constructeur des mobilisations massives initiées sur les réseaux sociales par le passé, sans pour autant reproduire toutes leurs caractéristiques.
Par ailleurs, l’ampleur des dispositifs de maintien de l’ordre a pesé sur la visibilité et la circulation des manifestants. Le texte d’origine souligne l’existence d’un « dispositif hors normes de maintien de l’ordre », dispositif qui a été reconduit le 18 septembre et qui explique en partie pourquoi la France n’a pas été bloquée de manière généralisée.
Les écarts de comptage entre autorités et syndicats — plus de 500 000 selon l’État, le double selon la CGT — restent significatifs et fréquents dans l’histoire des mobilisations. Ils reflètent des définitions distinctes de la participation et des méthodes de recensement différentes plutôt qu’une seule vérité incontestable.
Ce que dit la situation politique
À la différence du premier semestre 2023, ces mobilisations apparaissent simultanément plus ancrées sur les réseaux et mieux coordonnées localement par des sections syndicales et territoriales. Cette combinaison a permis une accélération du calendrier de l’action, mais elle n’offre pas, en l’état, de garantie quant à l’issue politique des mobilisations.
Le mouvement conserve des marges d’incertitude : l’impact sur les décisions gouvernementales dépendra de sa durée, de sa capacité à maintenir une pression organisée et des réponses publiques et politiques qui suivront. Les chiffres et les récits produits dans les heures qui suivent les journées d’action doivent donc être lus avec prudence, à la fois comme des indicateurs de force et comme des éléments d’un débat public en cours.
En l’état, la séquence du 10 puis du 18 septembre témoigne d’une capacité retrouvée à mobiliser de larges cohortes de manifestants et d’une interaction renouvelée entre mobilisation en ligne et actions syndicales traditionnelles. Les prochains rendez‑vous et les modes d’organisation qui en découleront permettront de mesurer si cette dynamique se stabilise et s’inscrit dans la durée.