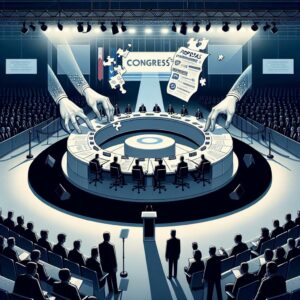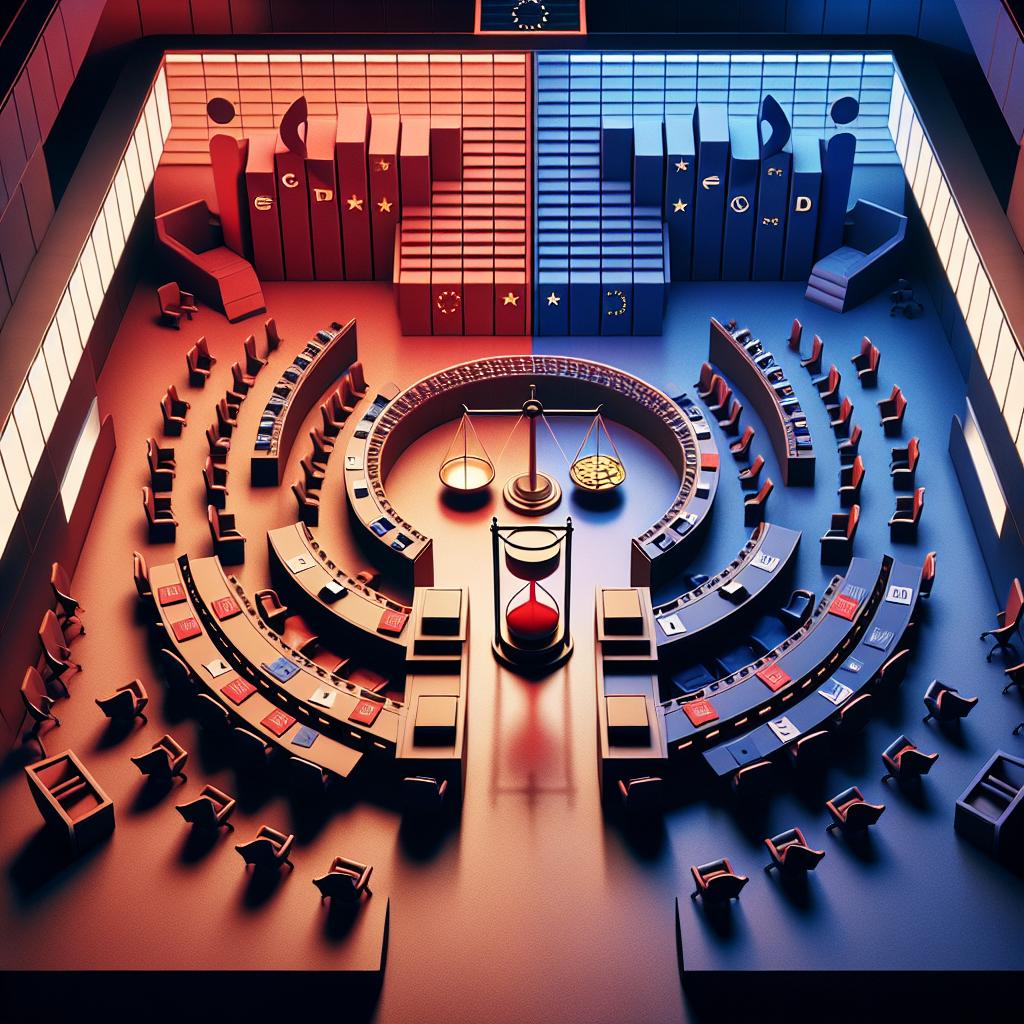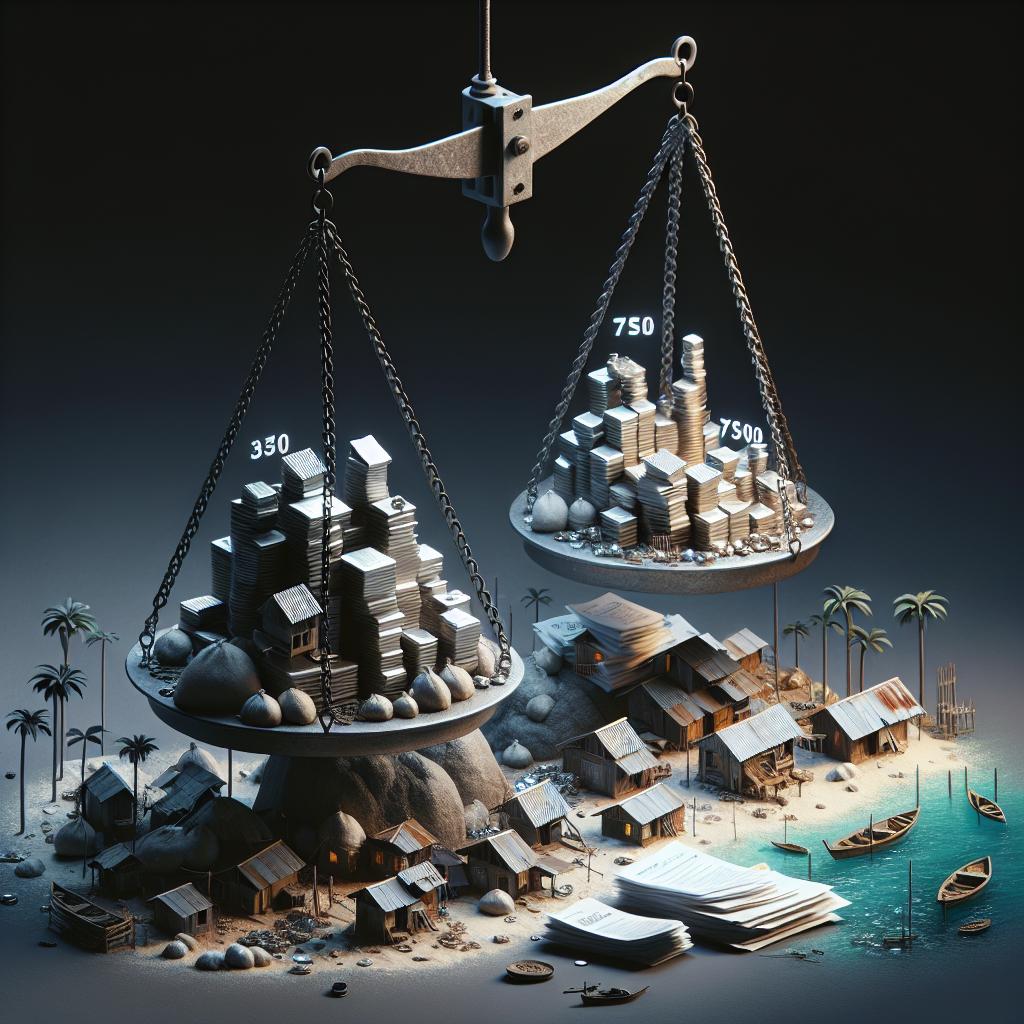Une décision attendue et préparée
La reconnaissance par la France de l’État de Palestine n’a pas résulté d’une improvisation. Emmanuel Macron en avait évoqué l’idée dès le printemps dernier. Initialement prévue pour le mois de juin, cette officialisation avait été repoussée en raison de l’escalade militaire entre Israël et l’Iran.
Sur le plan institutionnel, il s’agit d’une prérogative de la diplomatie française et du chef de l’État : la démarche ne nécessite ni vote du Parlement français, ni procédure spécifique auprès des Nations unies. En choisissant de porter la décision lors de la 80e Assemblée générale de l’ONU, tenue à New York depuis le 9 septembre, Paris entendait donner un retentissement international à son geste et encourager d’autres capitales à suivre.
Un texte et une dynamique diplomatique
La décision française s’inscrit dans une séquence diplomatique plus large conduite avec l’Arabie saoudite. Les deux pays avaient déjà coorganisé, fin juillet, une conférence onusienne consacrée à la solution à deux États, rassemblant une centaine de délégations.
Le texte issu de ces travaux, baptisé « Déclaration de New York », fixe une feuille de route visant un règlement durable du conflit israélo-palestinien. Il combine l’exigence d’un cessez-le-feu à Gaza, la libération des otages et la création d’un État palestinien viable, tout en excluant explicitement le Hamas des négociations.
Adoptée début septembre par 142 États membres de l’ONU, cette déclaration a été présentée par la diplomatie française comme une étape décisive. Si le document a recueilli un large soutien, il a aussi rencontré des oppositions : Israël et les États-Unis ont refusé d’y prendre part. Tel-Aviv a dénoncé une résolution « déconnectée de la réalité ».
Un basculement européen
L’Union européenne, longtemps divisée sur la question palestinienne, a vu son paysage évoluer rapidement. Après l’Irlande, l’Espagne et la Slovénie — qui avaient reconnu la Palestine en mai dernier — la France rejoint désormais la Belgique et, prochainement selon le texte d’origine, le Royaume-Uni, qui s’apprêterait à officialiser sa décision.
Au total, près de 150 pays sur 193 membres des Nations unies reconnaissent aujourd’hui l’État palestinien, indique l’article d’origine. Cette dynamique européenne vise à peser dans un contexte international où les équilibres se redessinent : la reconnaissance de Paris et de Londres ferait basculer quatre des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU vers une position de reconnaissance — la Chine et la Russie ayant reconnu l’entité dès les années 1980.
Pour autant, les États-Unis conservent leur droit de veto et se retrouvent, sur cette question, de plus en plus isolés, selon le compte rendu fourni.
Un rendez‑vous diplomatique crucial
La séquence devait culminer lundi 22 septembre, entre 15 h et 18 h locale (soit de 21 h à minuit, heure de Paris). L’ultime réunion de l’Assemblée générale coïncidait avec le 80e anniversaire de l’organisation, sous la coprésidence conjointe de la France et de l’Arabie saoudite.
Emmanuel Macron devait s’exprimer vers 21 h 30, heure de Paris, devant ses homologues. Son intervention, selon le texte, serait suivie de près : elle engage, dans l’esprit des auteurs du texte, la crédibilité de la diplomatie française et européenne au Moyen-Orient. L’annonce ne mettrait toutefois pas fin aux violences ni aux blocages politiques, mais marquerait un réel basculement diplomatique.
Ce que cela change — et ce qui reste incertain
Aux yeux de ses partisans, la reconnaissance par deux puissances européennes majeures et membres permanents du Conseil de sécurité devrait replacer la solution à deux États au cœur du débat international. Elle réaffirme aussi des demandes précises : cessez-le-feu à Gaza, libération des otages et garantie d’un État palestinien viable.
Reste que le texte et les annonces ne garantissent ni l’arrêt immédiat des hostilités, ni une voie unique vers des négociations inclusives : le Hamas est explicitement exclu des négociations prévues par la « Déclaration de New York », ce qui soulève des questions sur la représentativité politique et les modalités de mise en œuvre.
Enfin, si la France et plusieurs autres pays multiplient les gestes diplomatiques, l’impact concret sur le terrain dépendra de la capacité des acteurs régionaux et internationaux à traduire ces orientations en mesures politiques et sécuritaires effectives.