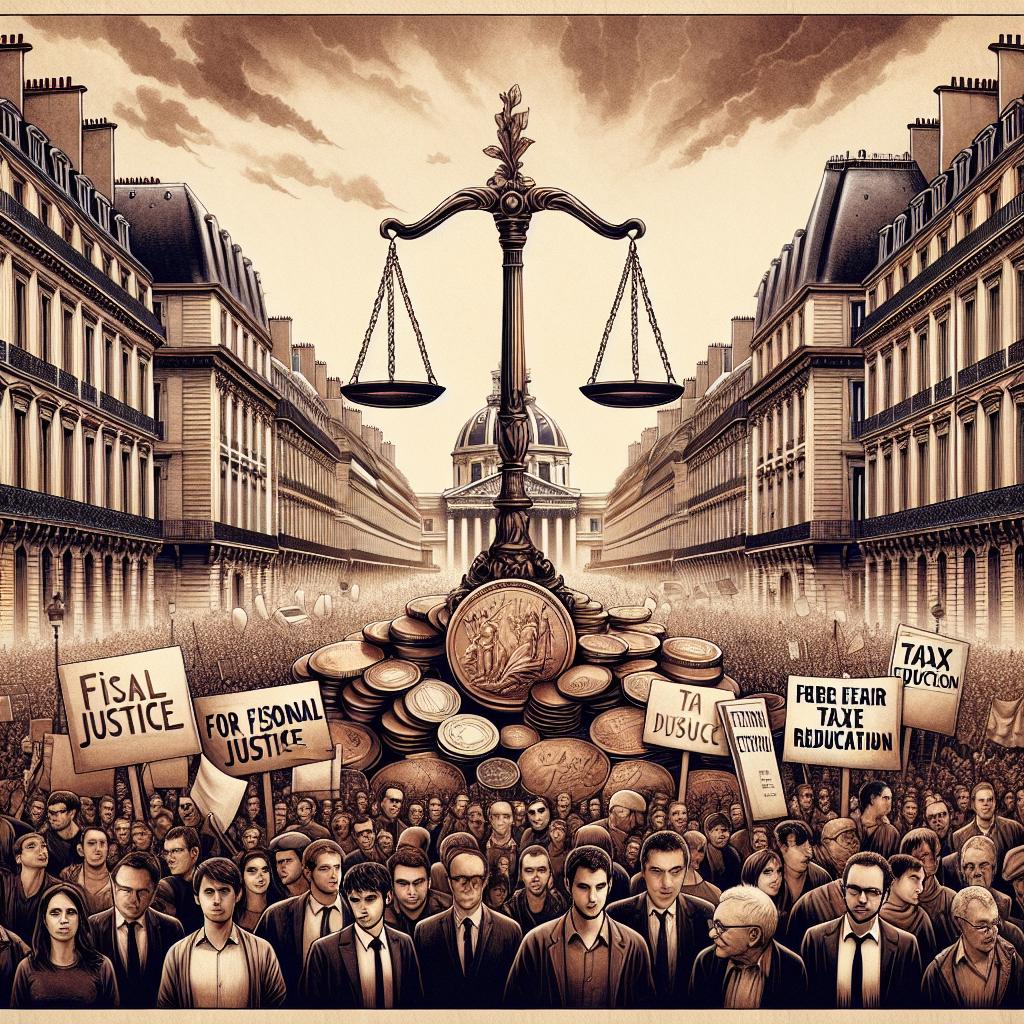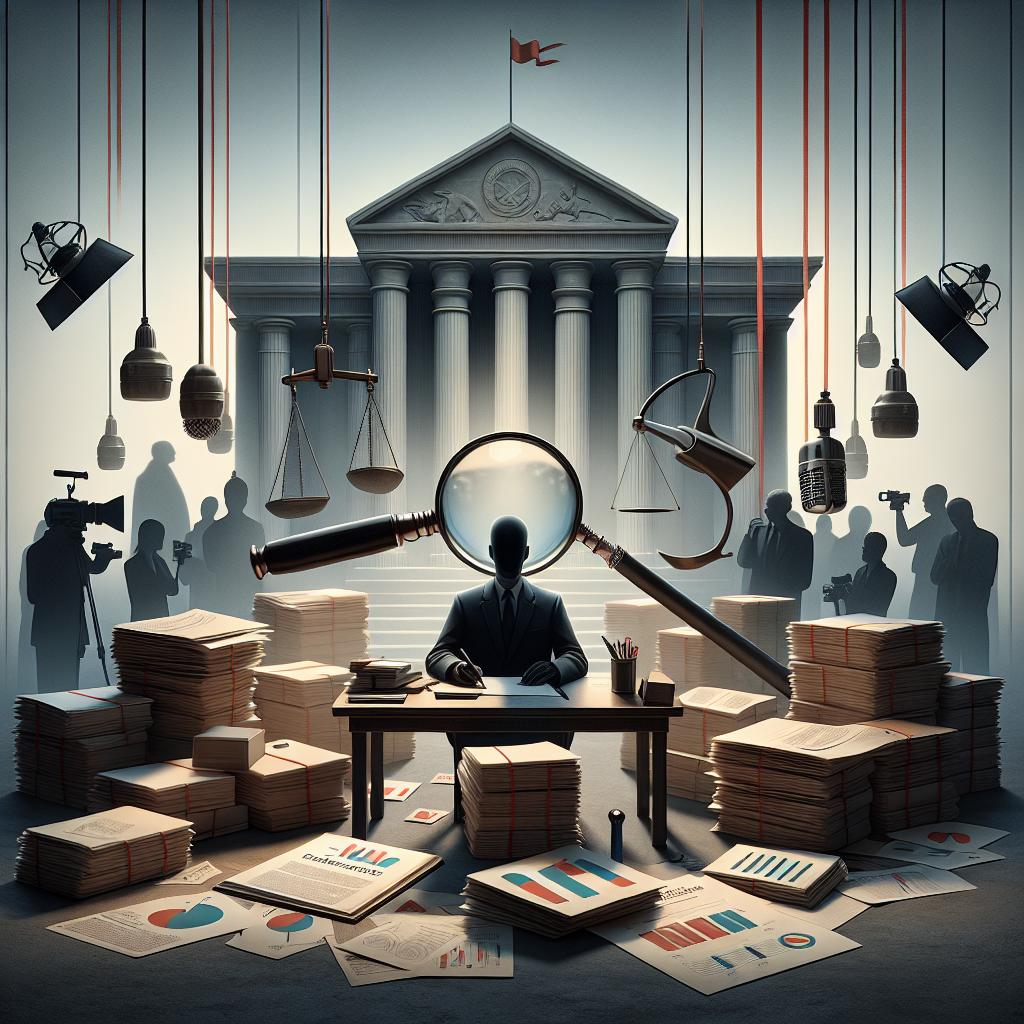La France connaît, en cette fin d’été 2025, une nouvelle poussée antifiscale marquée par des mobilisations et des campagnes virales sur les réseaux sociaux.
Depuis le mois d’avril 2025, le slogan « C’est Nicolas qui paie » circule largement, notamment à droite et à l’extrême droite, pour dénoncer la pression fiscale ressentie par une partie de la population et la prétendue « gabegie de l’État » ainsi que « l’assistanat ».
Un mouvement ample et hétérogène
Les journées de mobilisation récentes illustrent la diversité des acteurs et des revendications. Le 10 septembre 2025, le mouvement « Bloquons tout » a organisé des actions de blocage. Le 18 septembre 2025, une journée de mobilisation sociale a rassemblé un grand nombre de personnes à l’appel de syndicats, de partis de gauche et d’extrême gauche, pour s’opposer au projet de budget 2026, critiquer les nouveaux efforts demandés aux ménages et réclamer au contraire une plus forte contribution des plus aisés.
Ces rendez-vous traduisent une double logique. D’un côté, des protestations nourries par la colère antifiscale classique — refus de nouveaux prélèvements, critique du fonctionnement de l’État — et, de l’autre, des mouvements réclamant davantage de redistribution et une fiscalité plus progressive. Le résultat est une mobilisation ample mais disparate, qui rassemble des motifs contradictoires autour d’un thème commun : la contestation de la politique fiscale.
Une conjoncture politique tendue
La poussée antifiscale s’inscrit dans un contexte politique fragile. Le texte initial évoque un président de la République jugé affaibli, un gouvernement démissionnaire et une majorité introuvable à l’Assemblée nationale. Cette conjoncture institutionnelle contribue à dramatiser les affrontements et à fragmenter les réponses publiques.
Pris en étau entre des appels à la réduction des impôts portés à droite et les demandes de hausse de la progressivité fiscale portées à gauche, les dirigeants paraissent confrontés à des arbitrages difficiles. La combinaison d’une contestation sociale visible et d’une instabilité politique accroît le caractère risqué du moment : le débat sur l’impôt devient un marqueur de tensions plus larges, touchant la légitimité des autorités et la cohésion sociale.
Racines historiques d’une colère récurrente
Cette dynamique ne naît pas ex nihilo. L’histoire française est jalonnée de soulèvements antifiscaux lorsque le pouvoir, en difficulté, multipliait prélèvements et impositions arbitraires. Des révoltes telles que la Harelle rouennaise (XIVe siècle, pendant la guerre de Cent Ans), les mouvements des « bonnets rouges » en Bretagne sous Louis XIV, ou encore les insurgés appelés « croquants » et « nu-pieds » sous Louis XIII, sont des épisodes rappelant la longévité d’une défiance populaire face à l’impôt perçu comme injuste.
La Révolution de 1789 a précisément cherché à régler cette question en instituant des principes nouveaux. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et la Constitution de 1791 posaient en effet l’égalité fiscale et le consentement à l’impôt comme des principes fondamentaux. Ces textes restent des repères symboliques susceptibles d’éclairer les débats contemporains, dont certains échos renvoient à des revendications anciennes : transparence, justice et légitimité de la fiscalité.
Enjeux et risques
L’événementiel récent révèle plusieurs enjeux. D’abord, la nécessité d’un débat public clarifié sur qui doit financer les services publics et selon quelles règles. Ensuite, la difficulté politique d’arbitrer entre demandes contradictoires sans aggraver les fractures sociales. Enfin, le risque de polarisation : lorsque des slogans viraux et des journées de blocage se multiplient, le débat peut se simplifier en antagonismes qui masquent des questions plus complexes.
Cette période appelle une analyse approfondie des ressorts sociaux et politiques du mouvement. Comprendre la diversité des motifs — de la colère contre une imposition ressentie comme excessive à la demande d’une redistribution plus exigeante — est indispensable pour saisir la singularité et les dangers de la situation.
Sans formuler de prescription, il convient de noter que la conjugaison d’une forte contestation sociale et d’une instabilité politique rend la période particulièrement délicate pour le dialogue public. Les prochains arbitrages budgétaires et les initiatives parlementaires seront, à court terme, des moments-clés pour mesurer l’évolution de cette poussée antifiscale.