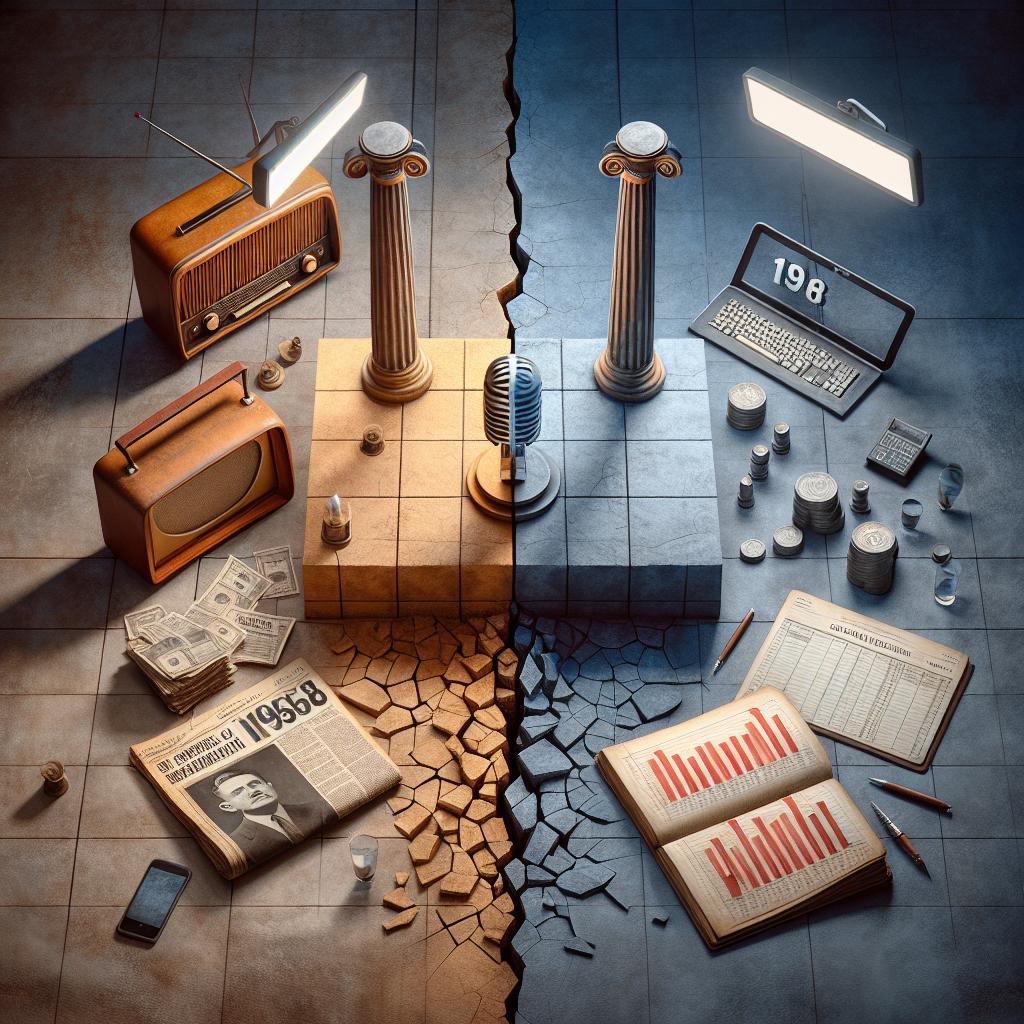La proposition dite « taxe Zucman » relance un débat fiscal et politique vif à la rentrée, au moment où les contraintes budgétaires pèsent sur les choix publics. Ses partisans y voient une mesure d’équité visant à faire contribuer davantage les très hauts patrimoines ; ses opposants redoutent une fuite des capitaux et un effet dissuasif sur l’investissement.
Principe de la mesure et ciblage
La taxe Zucman est conçue comme un impôt plancher : tout foyer disposant de plus de 100 millions d’euros de patrimoine paierait au moins 2 % de la valeur de ce patrimoine chaque année. Concrètement, pour un ménage qui ne s’acquitte aujourd’hui que de 0,5 % de son patrimoine au titre des impôts, la taxe viendrait combler l’écart à hauteur de 1,5 % du patrimoine.
L’objectif affiché par ses auteurs est double : restaurer « davantage de justice fiscale » et dégager une nouvelle source de recettes dans un contexte budgétaire contraint. L’économiste Gabriel Zucman, à l’origine de la proposition, s’appuie sur des constats empiriques selon lesquels le taux effectif d’imposition diminue parmi les fractions les plus aisées de la population.
Données et constats sur l’imposition des très hauts revenus
Des chercheurs de l’IPP ont montré, sur des données datant de 2016, que le taux effectif d’imposition commence à décroître à partir des 0,1 % les plus riches. Selon leur calcul, si les 0,1 % supérieurs sont imposés à 46 % de leurs revenus, les 0,0002 % les plus fortunés (les milliardaires) ne reverseraient que 26,2 % de leurs revenus. Les auteurs expliquent en partie cette anomalie par l’utilisation par les très hauts patrimoines de montages via des holdings, moins exposés à l’impôt sur le revenu.
Les mêmes chercheurs indiquent que ce phénomène de régressivité perdure : lors d’une révision de leurs calculs en septembre 2025, ils notent une baisse d’environ un point du taux effectif d’imposition des revenus des milliardaires. Selon Gabriel Zucman, un impôt plancher fixé à 2 % permettrait d’enrayer cette tendance : « Les milliardaires paieraient autant – mais pas plus – que les catégories sociales situées en dessous d’eux », a-t-il déclaré dans un entretien au Monde.
Différences avec l’ISF et l’IFI
La taxe Zucman se situe dans la lignée des impôts sur le patrimoine, mais elle diffère sensiblement de l’ancien impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de l’actuel impôt sur la fortune immobilière (IFI). L’ISF prenait en compte l’immobilier, les liquidités et les placements financiers ; il a été remplacé en 2018 par l’IFI, qui ne taxe que le patrimoine immobilier.
À la différence de l’IFI, la taxe Zucman s’appliquerait à l’ensemble du patrimoine, y compris les « biens professionnels » comme les actions d’entreprise. Son taux proposé est de 2 % sans mécanisme de plafonnement, alors que les taux de l’IFI varient de 0,5 % à 1,5 % selon les tranches. Le seuil retenu (100 millions d’euros) limiterait l’application à un nombre relativement restreint de foyers : environ 1 800 selon l’économiste à l’origine du texte, contre près de 186 000 ménages assujettis à l’IFI en 2024 et environ 358 000 ménages soumis à l’ISF en 2017.
Rendement attendu et incertitudes
Les estimations du rendement de la taxe divergent fortement. Des scénarios optimistes évoquent un produit annuel de 20 à 25 milliards d’euros. À l’opposé, une tribune publiée dans Le Monde par sept économistes avance une estimation plus prudente, de l’ordre de 5 milliards d’euros, en invoquant les risques d’optimisation fiscale et d’exil des contribuables ciblés.
Un rapport du Conseil d’analyse économique (CAE) mentionné dans le débat avance, sur la base de comparaisons internationales, un rendement effectif « de 0,25 euro par euro espéré ». Gabriel Zucman et certains coauteurs de l’étude contestent la pertinence des extrapolations retenues par le CAE, jugeant les situations non comparables avec un impôt plancher ciblant les ultrariches ; Camille Landais a également réfuté l’usage de telles extrapolations dans Alternatives économiques.
La commission des finances du Sénat et plusieurs observateurs relèvent que toute estimation reste délicate car « aucune autre imposition de ce genre n’existant aujourd’hui, il est possible que les personnes les plus aisées s’exilent pour éviter l’impôt ». Toutefois, des travaux cités par le CAE suggèrent qu’un point de pourcentage supplémentaire d’imposition pourrait entraîner, à long terme, une expatriation supplémentaire comprise entre 0,02 et 0,23 % des hauts patrimoines français, soit une fourchette estimée entre 90 et 900 foyers.
Risques politiques et juridiques
Sur le plan politique, la proposition a connu des débats parlementaires intenses : une proposition de loi portée par des écologistes instaurant la taxe a été adoptée par l’Assemblée nationale le 20 février puis rejetée par le Sénat le 12 juin. Les opposants, parmi lesquels l’ex-premier ministre François Bayrou, qualifient la taxe de « confiscatoire » et évoquent des obstacles jurisprudentiels.
Les défenseurs répliquent qu’un taux limité à 2 % et un seuil élevé à 100 millions d’euros ne sauraient constituer une mesure confiscatoire et que la proposition renforcerait l’égalité devant l’impôt au regard de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Reste que l’appréciation finale sur la conformité constitutionnelle dépendrait d’un examen du Conseil constitutionnel si la mesure devait figurer dans un futur projet de loi de finances.
Enfin, certains partisans proposent d’accompagner la mesure d’un « bouclier anti-exil » : un mécanisme visant à maintenir l’assujettissement des contribuables potentiellement expatriés pendant une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans après leur départ.