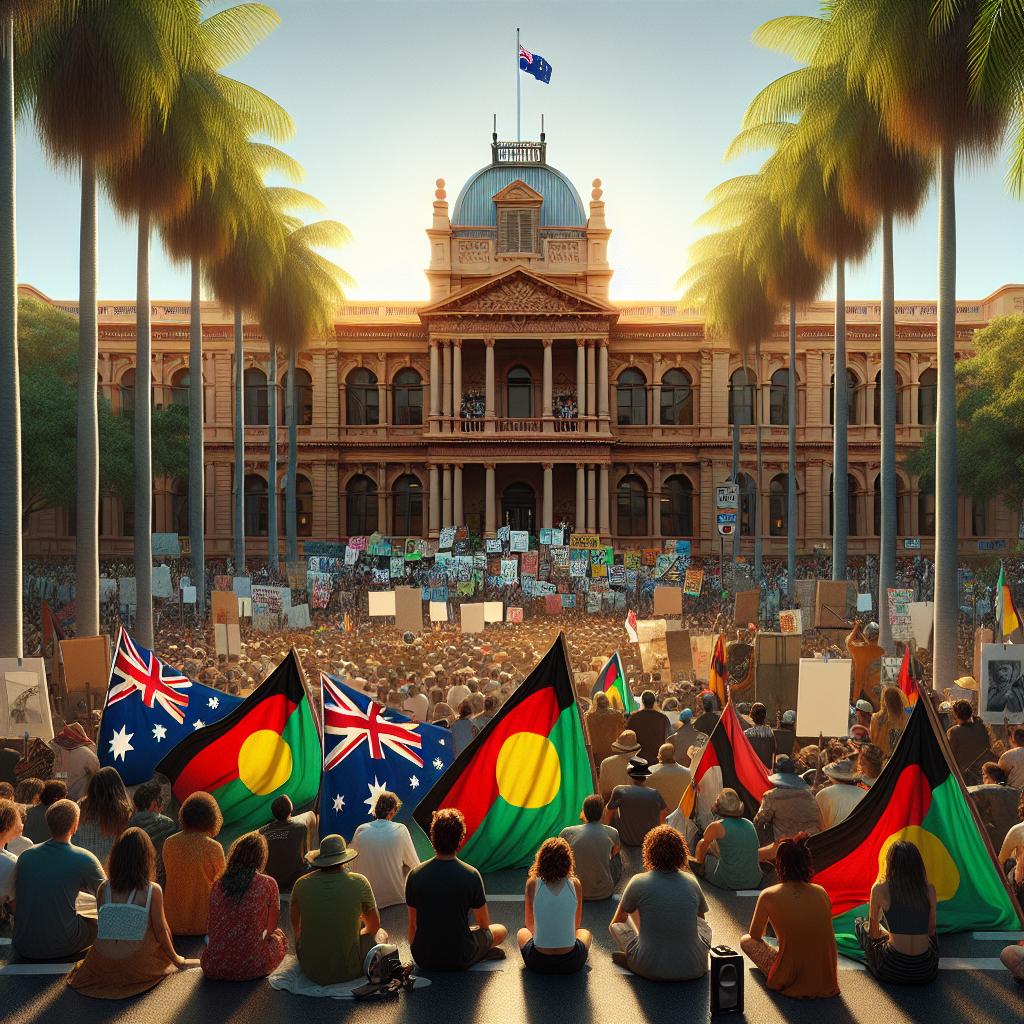Sébastien Lecornu peut‑il réussir là où Michel Barnier et François Bayrou ont échoué ? Chargé de présenter un budget pour 2026 dans une France marquée par la contestation et la fragmentation politique, le nouveau Premier ministre fait face à un exercice délicat : trouver un texte capable d’échapper à une censure parlementaire alors même qu’il ne dispose pas d’une majorité claire à l’Assemblée nationale.
Un calendrier serré et une majorité absente
La contrainte constitutionnelle est nette : le projet de loi de finances pour 2026 doit être déposé au plus tard le 13 octobre sur le bureau de l’Assemblée nationale. Ce délai impose une accélération des arbitrages budgétaires, des négociations et des simulations macroéconomiques, sans marge importante pour des recalages politiques de dernière minute.
Sans majorité organisée, le gouvernement se trouve exposé à la menace d’une censure officielle. Le Rassemblement national et La France insoumise ont la capacité de faire échouer un texte s’ils s’accordent, et les équilibres parlementaires contraignent le Premier ministre à composer avec des partenaires hétérogènes, aux exigences parfois contradictoires.
Des gestes symboliques pour apaiser
Depuis sa nomination le 9 septembre, Sébastien Lecornu a multiplié des annonces ciblées, visant à désamorcer la tension sociale et politique. Il a renoncé à la suppression de deux jours fériés envisagée par son prédécesseur, mis fin aux avantages à vie des anciens Premiers ministres et renoncé au Service national universel (SNU) sous la forme projetée précédemment.
Parallèlement, le gouvernement a annoncé l’ouverture de maisons France Santé, une mesure présentée comme une réponse aux attentes sur l’accès aux soins. Ces décisions sont volontaires et essentiellement symboliques ; elles cherchent à produire un apaisement rapide avant d’entrer dans la phase concrète de construction budgétaire.
Rétablir la confiance, préalable à l’élaboration du budget
Le Premier ministre entame, à compter du 22 septembre, un nouveau cycle de concertations avec les partenaires sociaux et les formations politiques. Sa méthode se veut méthodique et pragmatique : établir des canaux de dialogue, mesurer les marges de manœuvre et tenter de créer des majorités de circonstance autour d’éléments précis du budget.
Les partenaires sociaux gardent une mémoire récente d’initiatives avortées. Le « conclave » sur les retraites, porté par François Bayrou, n’a pas abouti et a laissé des ressentiments, compliquant la disponibilité au compromis. Du côté des députés socialistes, le souvenir de l’été 2025 reste amer, notamment après la décision de François Bayrou de recourir au vote de confiance sans discussions préalables. Comme l’a regretté Manuel Valls, ministre des outre‑mer démissionnaire, « En choisissant le vote de confiance, François Bayrou a rendu plus périlleux l’exercice pour son successeur ». La formule employée pendant l’été a même été comparée, par référence historique, à l’image de « se jeter du haut des tours de Notre‑Dame », reprise de Chateaubriand à propos du gouvernement Polignac en 1830.
Les équilibres politiques et budgétaires à trouver
L’enjeu central consiste à concilier des demandes de nature différente : contenir les dépenses pour répondre aux impératifs de soutenabilité financière, tout en préservant des mesures sociales suffisantes pour rallier les députés de gauche indispensables à toute adoption du budget. Le risque politique est double : trop de concessions à la gauche peuvent aliéner la droite ; trop de rigueur peut provoquer une mobilisation sociale et parlementaire dirigée contre l’exécutif.
Face à ce dilemme, le gouvernement dispose de quelques leviers techniques : redéploiements de crédits, mesures ciblées de soutien à court terme, clauses d’évaluation pour certaines réformes et utilisation prudente d’amendements de présentation. Mais ces instruments exigent des compromis politiques, donc du temps et de la confiance réciproque entre les acteurs concernés.
Enfin, la perspective d’un débat public intense et d’un contrôle parlementaire aigu contraint l’exécutif à anticiper les lignes de fracture. L’absence de majorité absolue transforme chaque négociation en un jeu d’alliances ponctuelles, où les concessions prennent la forme d’échanges de garanties budgétaires et de promesses politiques limitées dans le temps.
Au-delà des annonces symboliques, la réussite de Sébastien Lecornu dépendra de sa capacité à construire des majorités de compromis, à restaurer une relation de confiance avec les partenaires sociaux et à convaincre des groupes parlementaires hétérogènes qu’un budget pour 2026 est compatible avec des objectifs de justice sociale et de viabilité des comptes publics. Dans le calendrier serré qui mène au 13 octobre, le temps politique pour opérer ces conciliations restera le juge le plus exigeant.