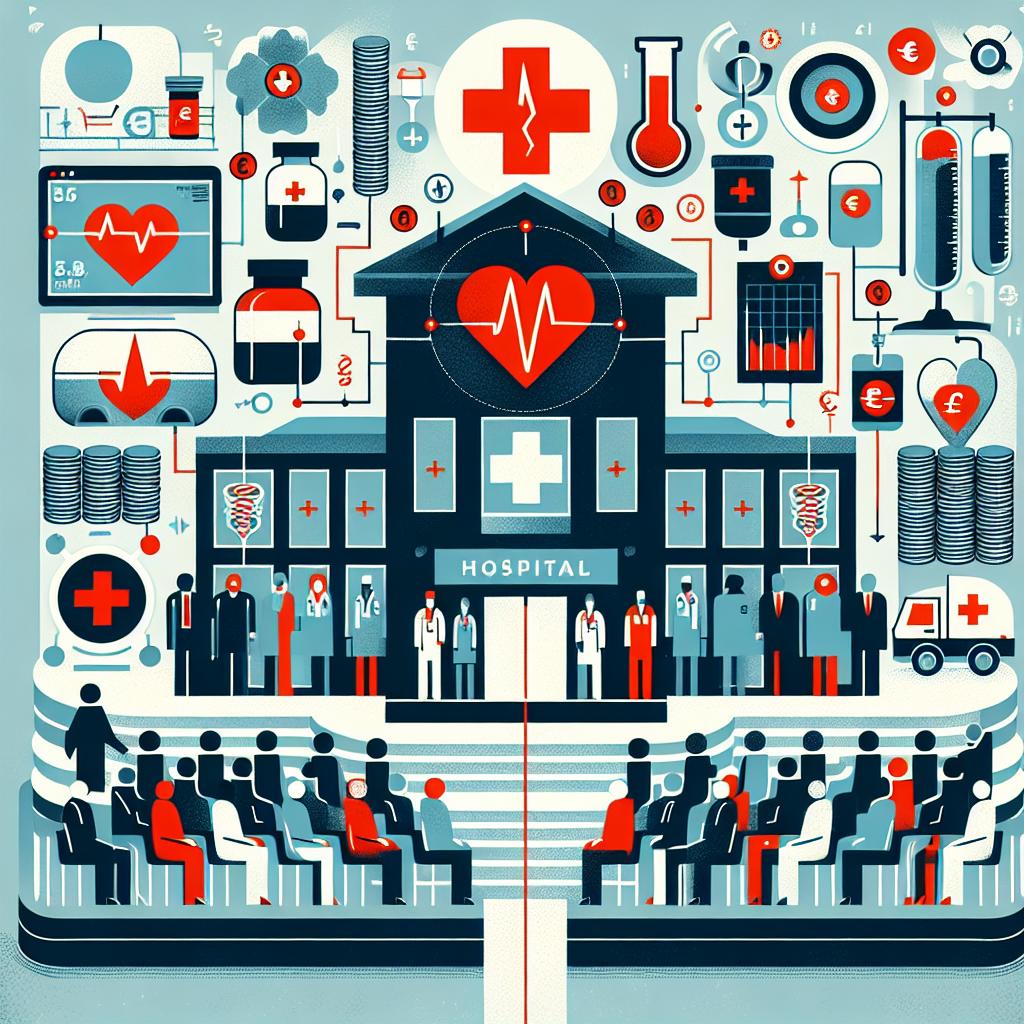Sourire franc, Lumir Lapray salue en habituée le patron du bar La Pétanque, dans le quartier de Ménilmontant, à Paris. Elle enchaîne les cigarettes autour d’un café qu’elle ne finira pas. « J’aime bien dire que je suis une “bobeauf” : j’aime Johnny et le matcha latte », plaisante-t-elle, mêlant autodérision et image contradictoire qui dit quelque chose de son parcours et de son positionnement.
Du militantisme électoral à l’activisme rural
Âgée de 33 ans, Lumir Lapray a été candidate — sans succès — aux élections législatives de 2022 sous la bannière de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) dans la 2ᵉ circonscription de l’Ain. Ce passage par la campagne électorale ne l’a pas détournée de l’engagement : elle se décrit aujourd’hui comme « activiste rurale », une expression qui renvoie à une forme de militantisme issue des territoires, souvent menée en dehors des cadres partisans traditionnels.
Elle partage désormais sa vie entre Paris et la petite commune de l’Ain où elle est née. Ce va-et-vient entre la capitale et les espaces périurbains nourrit son observation de ce qu’elle appelle « cette France périurbaine », un monde social et politique qu’elle a choisi de raconter dans son premier livre.
Un premier livre sur la France périurbaine
Le 24 septembre, elle publie son premier ouvrage, Ces gens-là. Plongée dans cette France qui pourrait tout faire basculer (Payot). Le livre se veut une exploration des familles modestes des périphéries urbaines, de leurs fragilités sociales et de leur tentation — ou de leur basculement — vers le Rassemblement national (RN).
Plutôt qu’un manifeste, le projet se présente comme un récit de terrain : l’auteure rapporte des rencontres, des trajectoires familiales et des observations sur les dynamiques locales. Elle situe ainsi son travail à la croisée de l’enquête sociale et du portrait, cherchant à rendre compte des motifs qui expliquent la progression électorale et l’ancrage du RN dans certaines couches populaires.
La tonalité de l’ouvrage, d’après ses propos, ne cherche pas l’explication unique. Elle insiste sur la diversité des raisons — économiques, culturelles, générationnelles — qui poussent des foyers modestes à reconsidérer leurs options politiques. Le choix de la périurbanité comme focale questionne également l’idée selon laquelle la « France de l’intérieur » serait homogène : il y a des différences marquées entre territoires, et des recompositions sociales en cours.
Observation et position personnelle
Dans ses rencontres et témoignages, Lumir Lapray joue sur la proximité et la distance critique. Sa formule ironique — se qualifier de « bobeauf » — illustre une volonté de rester ancrée dans des références populaires tout en revendiquant une lecture engagée des enjeux locaux. Elle refuse les oppositions simplistes entre « urbain » et « rural » et pointe, implicitement, l’importance des liens sociaux, des emplois précaires, et des perceptions identitaires qui structurent les choix électoraux.
Sa trajectoire personnelle — candidate sous l’étiquette Nupes, puis activiste hors des partis — éclaire aussi une mutation possible du militantisme : passer de la scène nationale et partisane à des engagements plus locaux, axés sur l’accompagnement et la visibilité des populations périurbaines.
Le parti pris narratif du livre, qui s’appuie sur la description de vies et de parcours, met en avant la complexité des phénomènes politiques locaux. La centralité des familles modestes dans son récit renvoie à une lecture sociale des phénomènes électoraux, plutôt qu’à une simple lecture idéologique ou identitaire.
Sans prétendre offrir une explication exhaustive, Lumir Lapray propose une cartographie sensible des tensions et des espoirs qui traversent ces territoires. Son livre, publié chez Payot, s’inscrit dans une veine d’enquêtes contemporaines visant à mieux comprendre les recompositions sociales et politiques françaises.
Enfin, le contraste entre l’image de Ménilmontant, lieu de ses haltes parisiennes, et la commune de l’Ain où elle retourne régulièrement donne au récit une double ancre : la proximité des milieux populaires urbains et la réalité concrète des périphéries rurales. Cette double géographie est au cœur de son analyse et de sa posture d’« activiste rurale ».