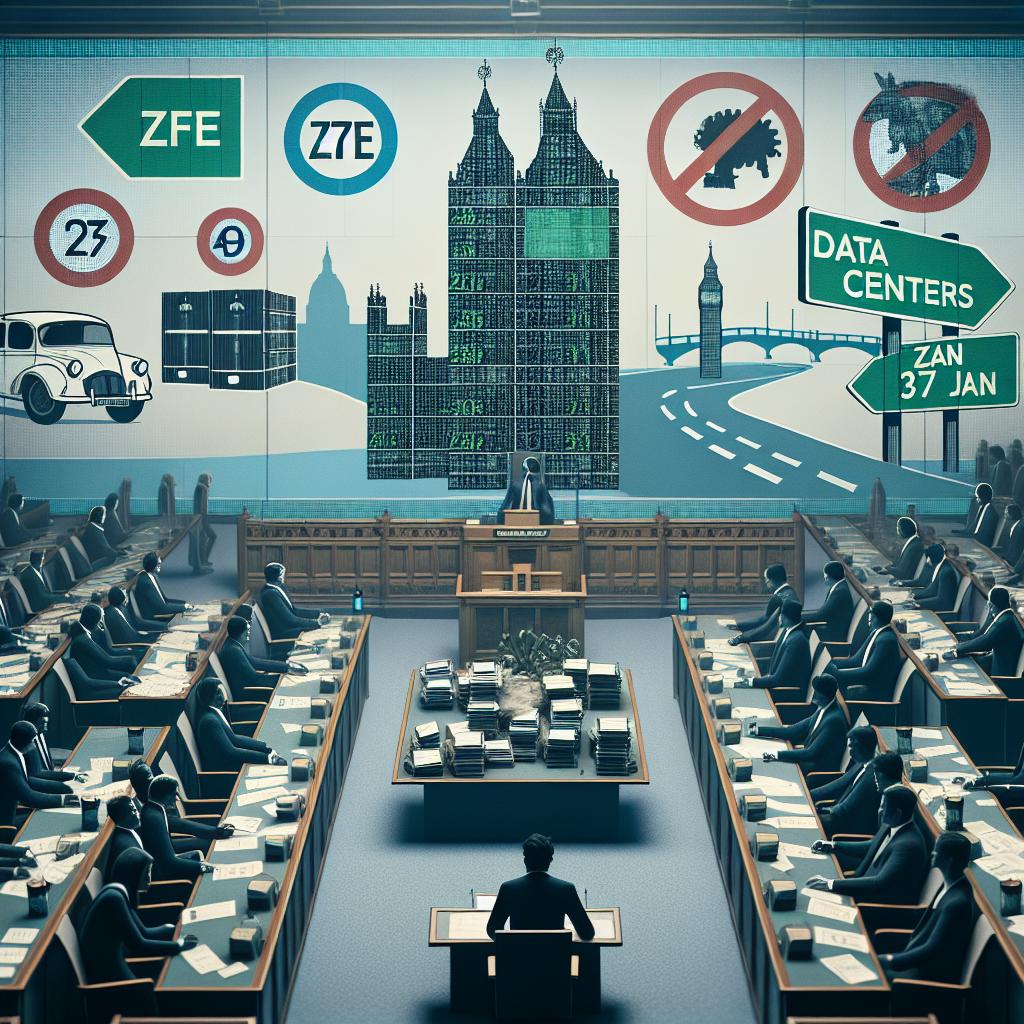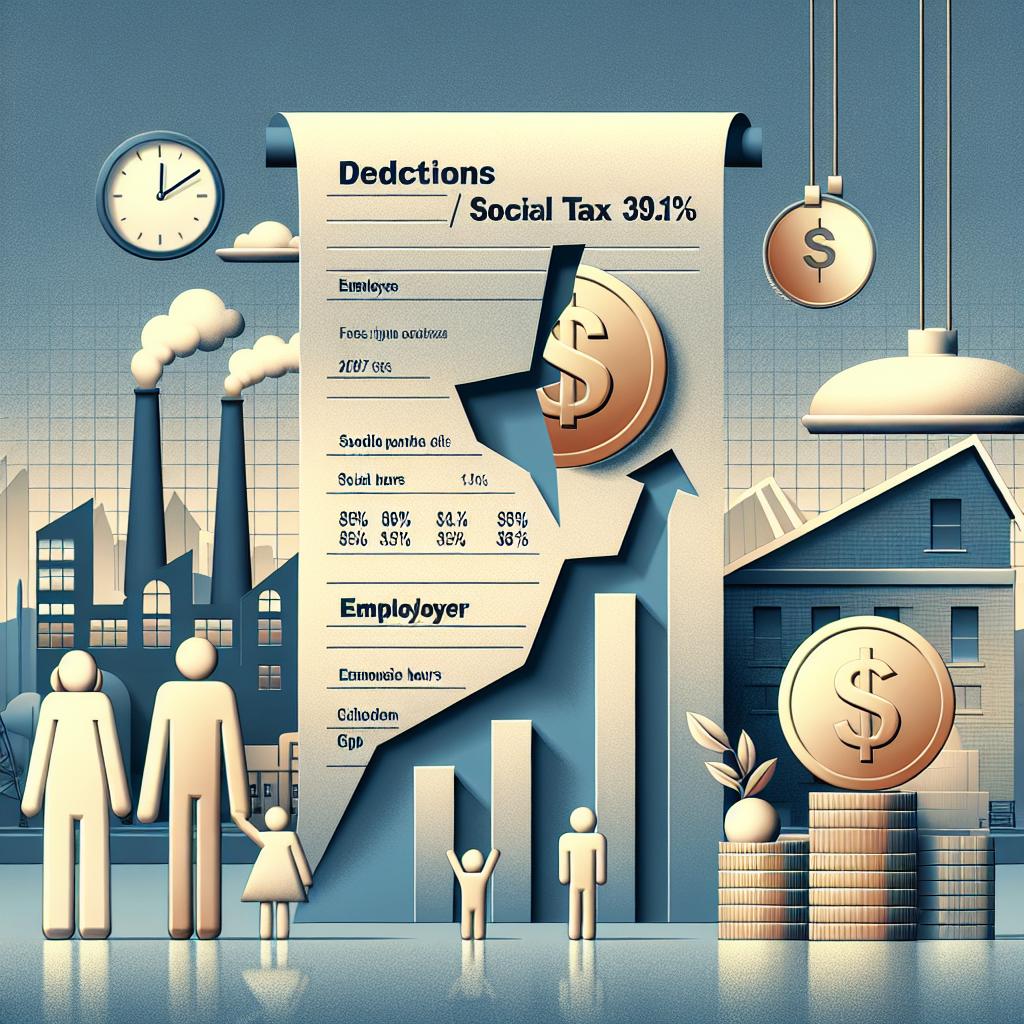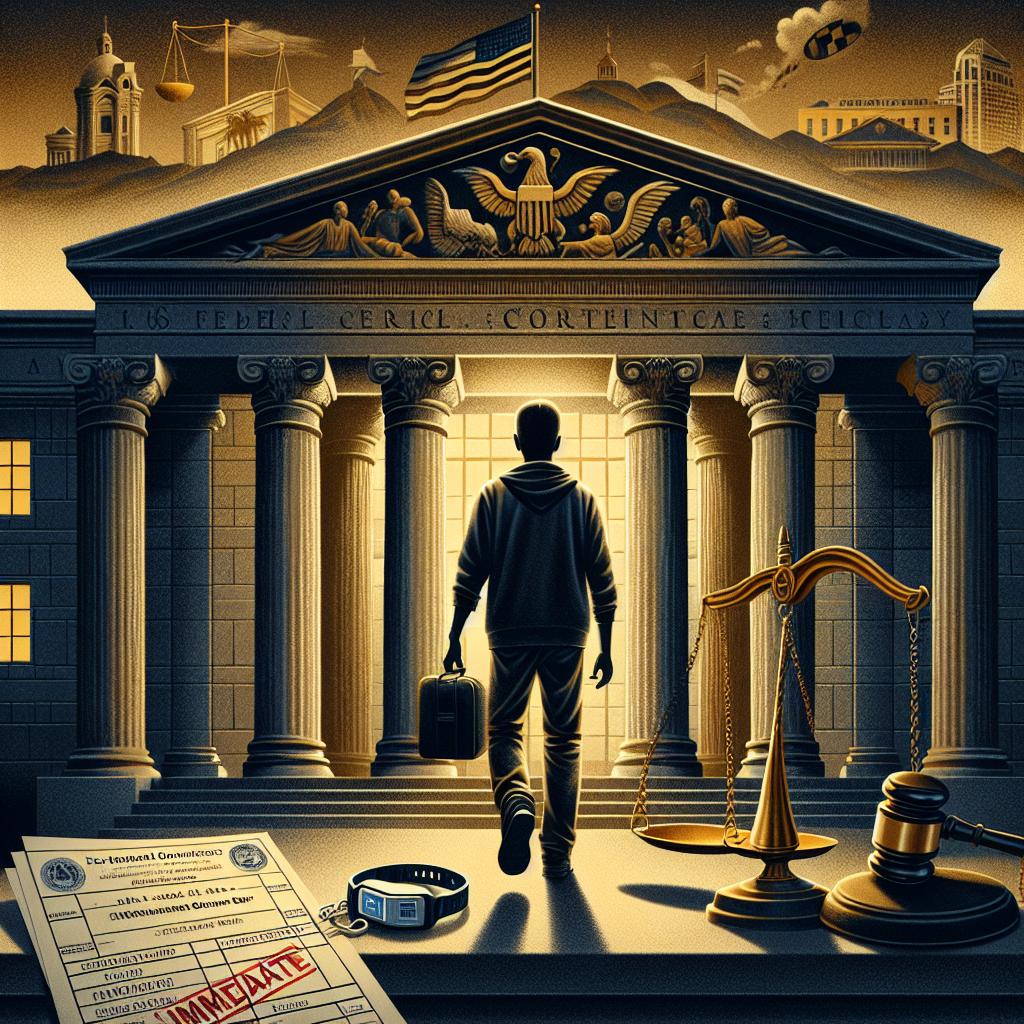Des bennes destinées au nettoyage et au tri ont été installées devant l’imposant bâtiment de plus de 7 000 mètres carrés qui abrite l’ancien palais de la culture. Antonwè, régisseur du Centre des arts et de la culture (CAC) dans sa version « squat », se dit satisfait de cette première étape matérielle. « Il y a des signes encourageants que les promesses de rénovation seront tenues », affirme-t-il.
Occupation, réunion avec les autorités et départ des artistes
Les artistes avaient investi les lieux en juillet 2021 pour alerter sur la situation culturelle de l’archipel. Après des mois de réunions avec la collectivité locale, ils ont quitté les lieux il y a une semaine, selon le récit des acteurs impliqués.
Laurence Maquiaba, membre du Kolèktif Awtis Rézistans et initiatrice du mouvement, rappelle que l’entrée dans le bâtiment s’est faite « juste après les régionales ». Elle est aussi porte-parole de l’Alyans Nasyonal Gwadloup, parti arrivé en troisième position lors du scrutin régional de 2021, résultat qui avait surpris une partie du paysage politique local.
Selon Maquiaba, l’objectif de l’occupation était clair : mettre en lumière l’absence de politiques publiques culturelles et forcer le débat public. Le mouvement a cherché à faire remonter la question culturelle « sur le devant de la scène », en combinant actions artistiques et démarches politiques.
Un chantier interrompu, des causes techniques et budgétaires
Le bâtiment est fermé depuis 2008 et devait faire l’objet d’une rénovation. Toutefois, les travaux engagés à plusieurs reprises ont été abandonnés, selon la communauté d’agglomération Cap Excellence, maîtresse d’ouvrage du chantier. La raison invoquée est celle des « défaillances des entreprises » chargées des opérations.
Le dossier a également souffert d’un montage financier mal anticipé. Le désamiantage et la mise aux normes sismiques ont fait exploser les coûts, qui se sont élevés jusqu’à environ 40 millions d’euros, une somme difficilement supportable pour des collectivités déjà fragilisées sur le plan budgétaire.
Ces éléments techniques et financiers expliquent en partie les interruptions répétées du chantier et le sentiment d’abandon dénoncé par les artistes et acteurs locaux. La combinaison d’imprévus techniques et d’un budget initial sous-estimé a contribué à prolonger l’immobilisme du bâtiment.
Signification des opérations actuelles et perspectives
L’installation des bennes marque une étape visible du nettoyage et du tri des locaux, opérations préalables à toute reprise de travaux. Pour Antonwè, elles constituent un signal tangible que les engagements pris envers le lieu pourraient aboutir à une rénovation effective.
Pour les artistes et collectifs à l’origine de l’occupation, le départ du squat n’est pas présenté comme une capitulation, mais comme le résultat de discussions et d’avancées supposées lors des réunions avec la collectivité. Le lien entre actions culturelles et négociations administratives apparaît ici central.
Reste que la trajectoire du projet demeure conditionnée à la capacité des maîtres d’ouvrage à résoudre les questions techniques et à sécuriser un financement durable. Sans le règlement des problèmes de désamiantage et de mise aux normes, toute reprise durable des travaux risque d’être compromise.
Au-delà du bâtiment lui-même, cette séquence illustre une tension plus large : comment concilier ambition culturelle et contraintes financières dans un territoire où les moyens publics sont restreints. Les acteurs locaux recueillis évoquent la nécessité d’un calendrier précis et d’un montage financier réaliste pour éviter de nouvelles déconvenues.
En l’état, l’installation des bennes et le départ des artistes ferment une phase d’occupation et ouvrent une période d’attente et de vigilance. Les promesses de rénovation restent à traduire en actes concrets, notamment par la reprise effective des travaux et la sécurisation des budgets nécessaires.