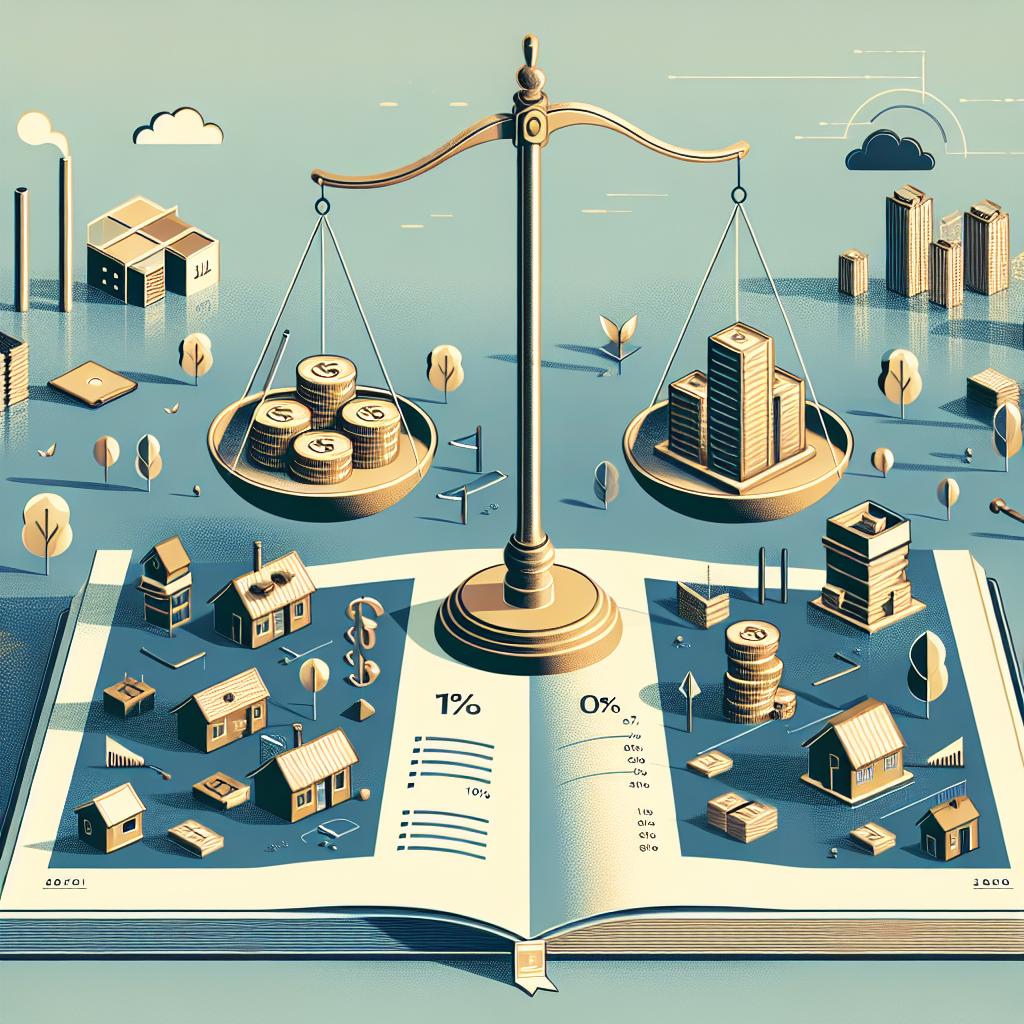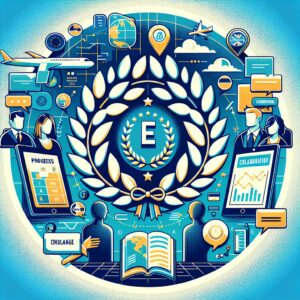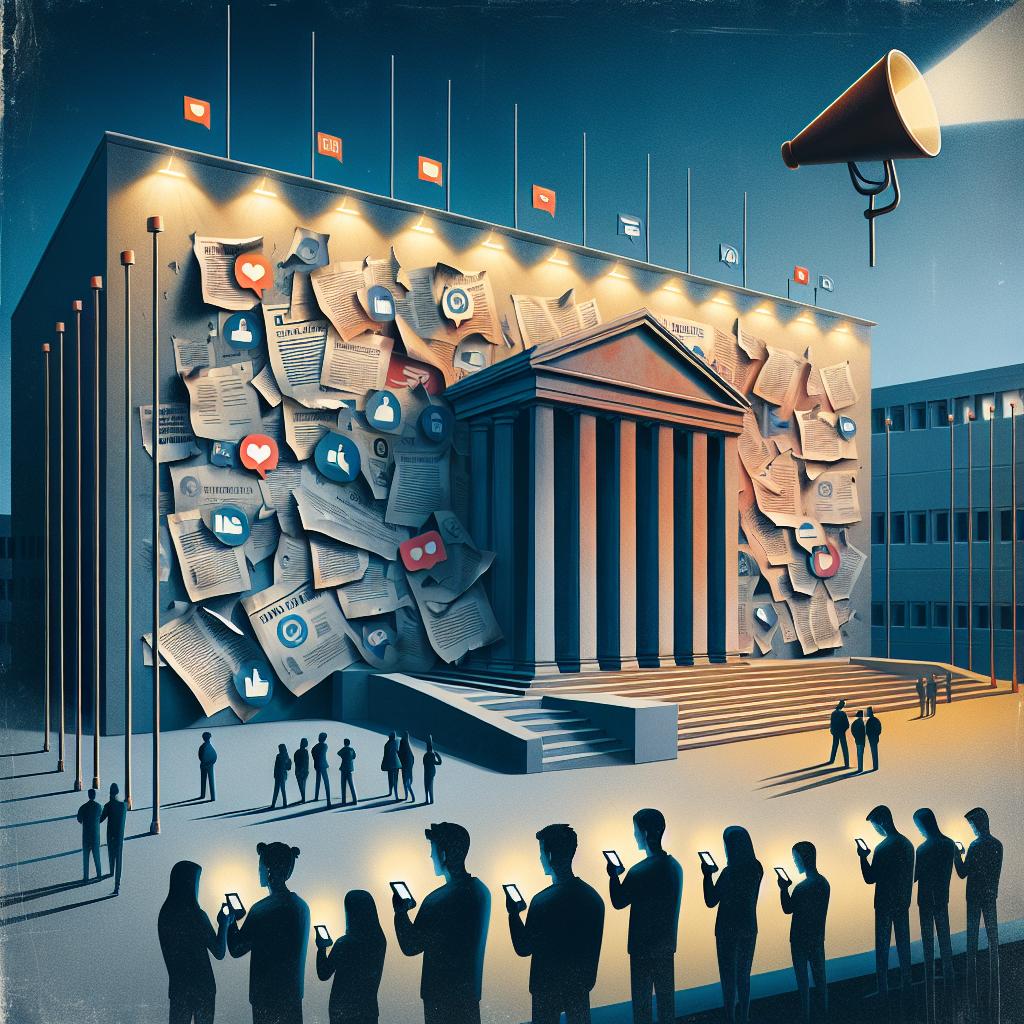Parlons de l’impôt sur le capital. En commençant par la lettre A, pour Maurice Allais, et non par la lettre Z, pour Gabriel Zucman, l’économiste français lauréat du prix Nobel en 1988 a défendu pendant plus d’un demi-siècle l’idée d’un impôt ciblant le capital plutôt que les revenus.
Maurice Allais et la proposition d’un impôt sur le capital
Maurice Allais (1911-2010) a plaidé, de 1948 à sa mort, pour une réforme fiscale de principe : remplacer l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés par une taxation du capital. Dans L’Impôt sur le capital et la réforme monétaire (Hermann, 1977), il détaille sa réflexion et propose un dispositif précis : un prélèvement annuel, au taux de 1 %, appliqué au capital fixe national évalué à la valeur de marché.
Aux yeux d’Allais, l’impôt devait épargner la « richesse en formation » — le travail, les salariés, les artisans, les commerçants et les entrepreneurs — et frapper en priorité la « rente » et les « revenus non gagnés » : ce qu’il qualifiait d’« intérêt pur », ainsi que les profits de monopole ou liés à l’inflation et, plus généralement, la richesse déjà accumulée.
Principes et modalités de la réforme envisagée
La notion centrale chez Allais est celle de « capital fixe » : il s’agit des éléments du patrimoine non délocalisables, tels que les biens fonciers et immobiliers — maisons, appartements, bureaux, magasins, usines et autres locaux d’entreprise. Son projet substituait donc à la fois l’impôt sur le revenu des personnes et l’impôt sur les sociétés un prélèvement unique fondé sur cette assiette.
La proposition comporte des éléments techniques importants rappelés par Allais lui‑même. Le capital à taxer devait être déterminé net de dette lorsque des emprunts sont attachés à une propriété. Il préconisait également des modalités de paiement étalées afin d’éviter que des contribuables ne soient contraints de vendre leurs biens pour faire face à l’impôt. Ces règles visaient à concilier la logique redistributive du prélèvement et la préservation de la continuité d’activité des ménages et des entreprises.
Objections pratiques et réponses d’Allais
L’alternative fiscale proposée par Allais soulève, comme il le reconnaissait, plusieurs difficultés pratiques. Outre la détermination de la valeur de marché du capital fixe, il faut traiter la question de l’endettement, définir des modalités de recouvrement compatibles avec la capacité de paiement des contribuables et assurer une transition sans heurts depuis le système existant. Allais consacre une partie de son ouvrage à ces objections et avance des réponses techniques pour y remédier.
Il n’évacue cependant pas la complexité du chantier : la mise en oeuvre d’un impôt annuel sur un stock de capital impose des choix administratifs et juridiques importants, ainsi qu’une acceptation politique des transferts de charge fiscale entre revenus et patrimoine.
Le constat d’Allais sur la fiscalité française
Allais faisait aussi un diagnostic plus général du système fiscal français de son époque, qui reste pertinent dans la présentation qu’en donne l’article d’origine : les prélèvements obligatoires pèsent majoritairement sur le travail. Certaines formes d’imposition du capital existent — taxe foncière, droits de mutation, taxe de publicité foncière, taxe sur les transactions financières, et d’autres prélèvements — mais, selon le texte, ces recettes ne représenteraient que 4 % du produit intérieur brut (PIB), alors que l’ensemble des prélèvements obligatoires avoisine la moitié du PIB.
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) joue, toujours selon l’exposé, un rôle majeur : elle rapporte entre 7 % et 8 % du PIB chaque année et fonctionne, en pratique, comme une forme d’imposition du revenu. En effet, la consommation des ménages reste, en grande partie, proportionnelle aux revenus en deçà d’un très haut niveau de ressources, si bien que la TVA tend à peser au fil du cycle sur les revenus du travail et la formation de richesse.
De ce point de vue, Allais dénonçait un déséquilibre : la richesse en formation supporte l’essentiel des prélèvements tandis que la richesse accumulée échappe, dans une large mesure, à une taxation directe et régulière.
Le débat ouvert par Allais — technique, économique et politique — demeure un repère historique pour qui s’interroge sur les finalités de la fiscalité et sur la manière d’articuler équité, efficacité et croissance dans la conception d’un impôt sur le capital.