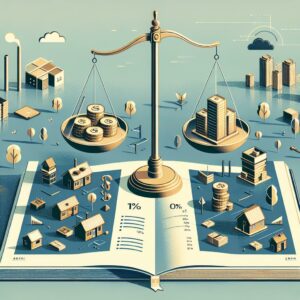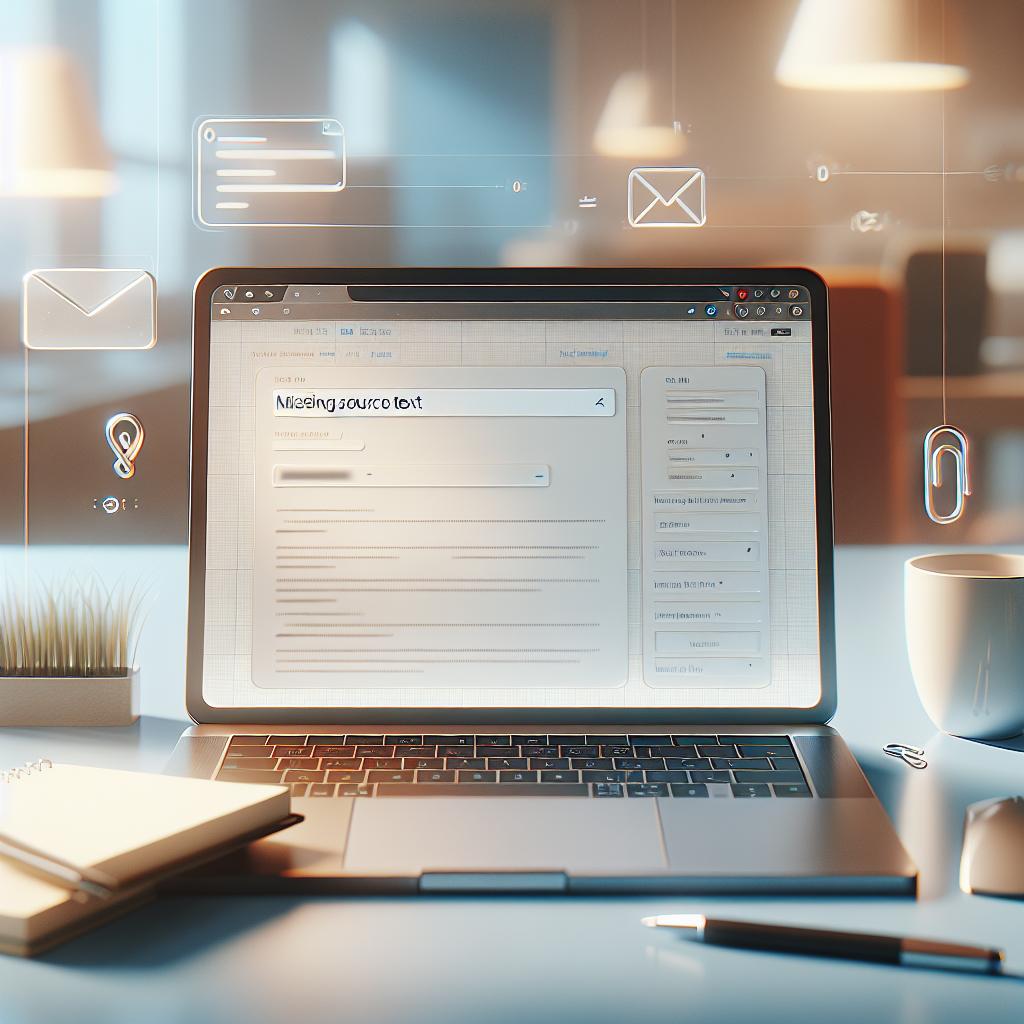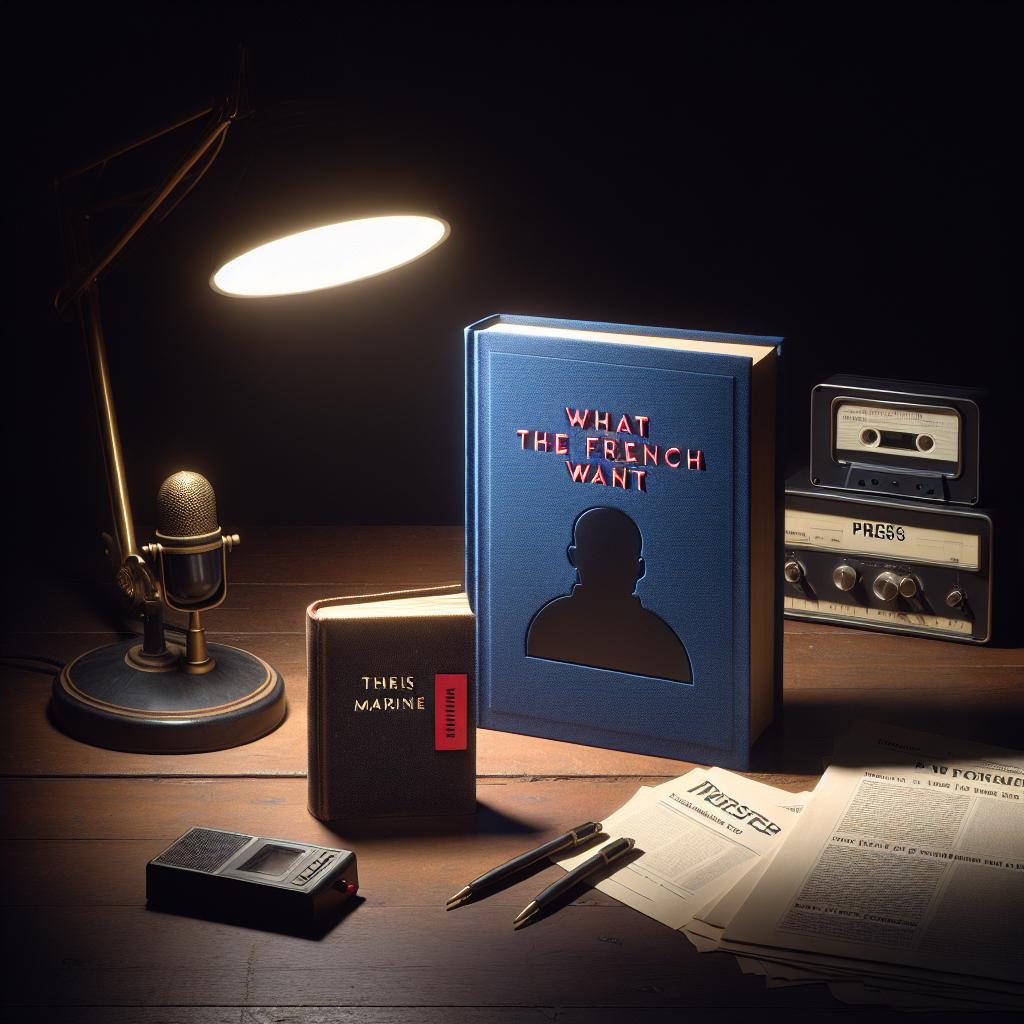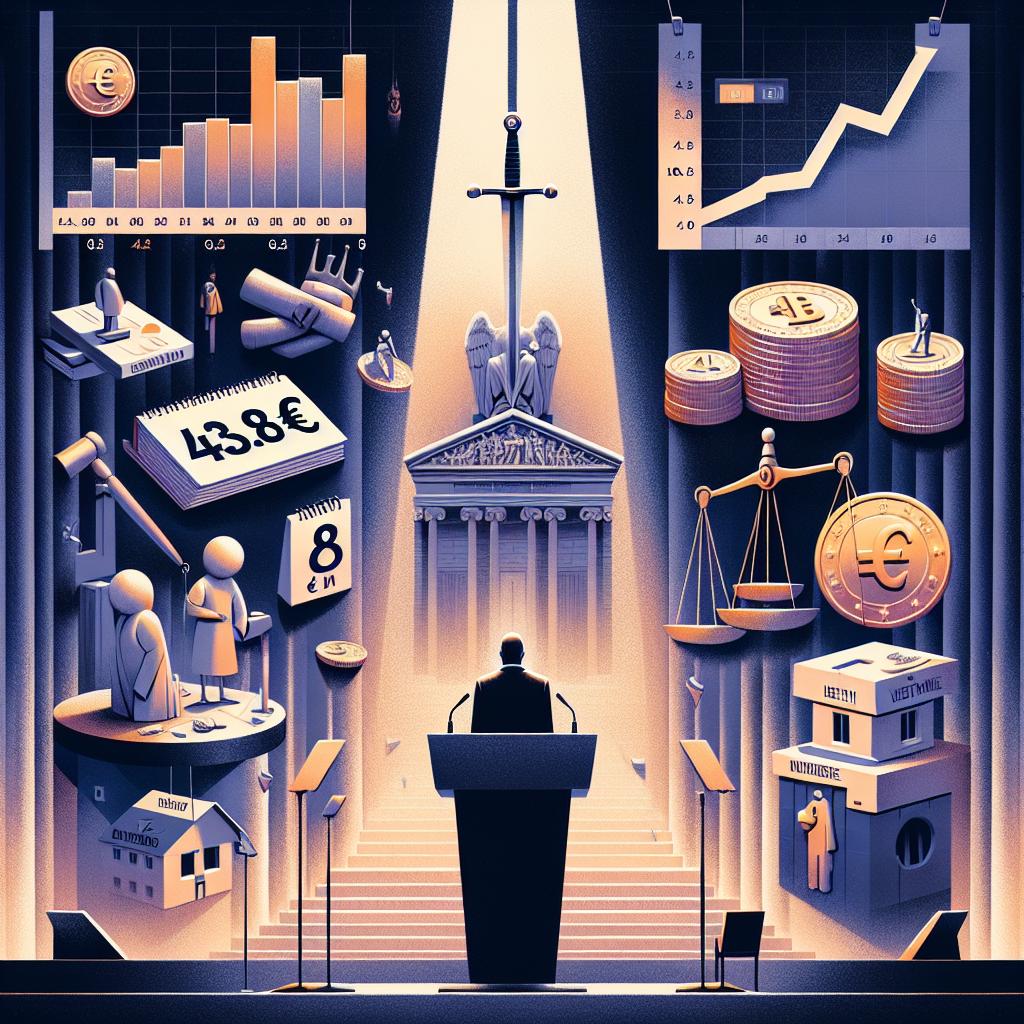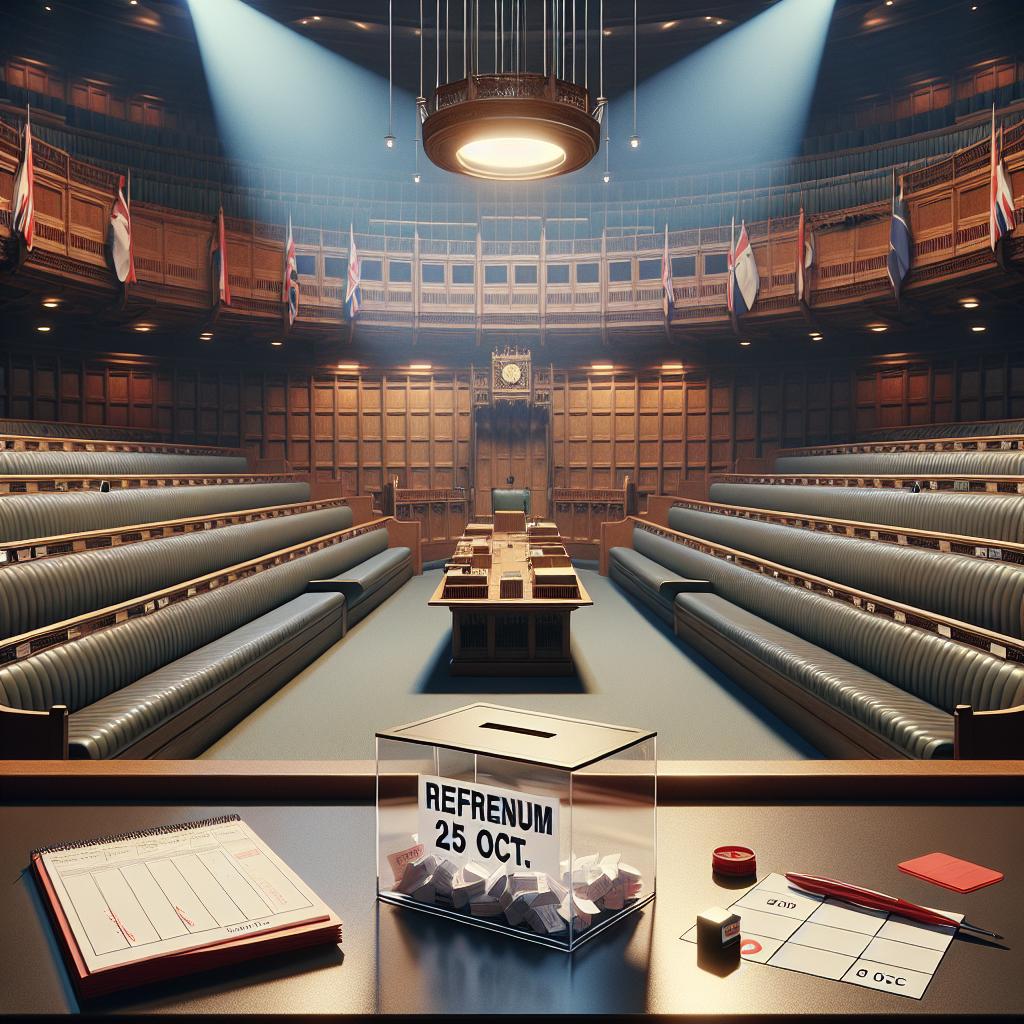Le message des sénateurs est sans ambiguïté : il est temps de « calmer le jeu » sur l’intercommunalité. C’est en substance la conclusion d’une mission sénatoriale dont le rapport a été présenté le jeudi 25 septembre (année non précisée dans le texte fourni), cinquante-et-une minutes après le début de la séance selon le compte rendu officiel. Les auteurs ont voulu dresser un bilan quinze ans après les lois qui, écrivent-ils, ont « bouleversé » le paysage communal.
Un bilan « globalement positif » mais nuancé
Maryse Carrère, sénatrice des Hautes-Pyrénées et rapporteuse de la mission, résume la position : « Le bilan est globalement positif » mais il reste « en demi-teinte ». Elle est aussi présentée comme présidente du groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Les constats dressés par les sénateurs mêlent progrès et limites : si la mise en commun de moyens a permis des économies d’échelle et une meilleure coordination entre collectivités, des faiblesses persistent, notamment sur la gouvernance de certaines intercommunalités.
Le rapport pointe des difficultés concrètes de fonctionnement. Certaines structures peinent à harmoniser leurs décisions, à répartir clairement les responsabilités et à associer les élus locaux — en particulier les maires — aux choix stratégiques. Ces lacunes alimentent des tensions entre organes intercommunaux et collectivités membres, souligne la rapportrice.
Des maires ruraux « mal vécu » les regroupements forcés
La résistance des édiles, surtout dans les zones rurales, est un des éléments mis en avant. Les sénateurs notent que de nombreux maires ont « mal vécu » les « nombreux ‘mariages forcés’ » imposés par l’État lors des vagues de regroupements. Ce vocabulaire traduit un malaise politique et administratif : des fusions conduites parfois sans adhésion pleine et entière des communes concernées.
Le rapport rappelle aussi la très forte fragmentation territoriale de la France. Le pays compte aujourd’hui 35 000 communes, un chiffre inférieur aux 44 000 municipalités recensées en 1789 mais qui demeure élevé par rapport aux autres États membres de l’Union européenne. Selon les sénateurs, ces 35 000 communes représentent encore 40 % de l’ensemble des communes de l’Union européenne, illustrant la singularité française en matière de maillage communal.
Cette fragmentation explique en partie la logique d’assemblage des intercommunalités : regrouper des communes permet de mutualiser des services, d’organiser des politiques locales plus cohérentes et de faire face à des contraintes financières. Mais lorsque les fusions sont perçues comme imposées, elles peuvent provoquer un rejet local et fragiliser la gouvernance collective.
Gouvernance, transparence et représentation
Les parlementaires insistent sur la nécessité d’améliorer la gouvernance des entités intercommunales. Le rapport met en lumière des situations où la répartition des compétences reste floue, où les mécanismes de décision ne favorisent pas toujours la transparence, et où la représentation des communes, notamment des plus petites, paraît insuffisante.
Ces observations ne nient pas les avancées réalisées depuis quinze ans, mais elles invitent à une réflexion mesurée sur la poursuite des réformes. Les sénateurs plaident pour un apaisement des méthodes de regroupement, afin d’éviter l’aggravation des tensions et de garantir que la coopération intercommunale repose sur des bases politiques et administratives solides.
Vers quel ajustement politique ?
Le rapport sénatorial ne propose pas, dans le résumé fourni, une feuille de route détaillée qui serait applicable immédiatement : il met surtout en garde contre des procédures de fusion perçues comme trop contraintes et appelle à une meilleure prise en compte des élus locaux dans les décisions. La formule répétée — calmer le jeu — renvoie à une demande de méthode : privilégier le dialogue, la concertation et des mécanismes de gouvernance clarifiés plutôt que des rapprochements imposés.
En l’état, les conclusions des sénateurs ouvrent un débat politique plus large sur l’équilibre entre la nécessité d’organiser efficacement les services publics à l’échelle intercommunale et la préservation d’une représentation locale jugée légitime par les habitants et leurs élus. Ce débat devrait, selon les auteurs du rapport, guider les prochaines étapes des politiques territoriales.
Le lecteur notera que certaines précisions (notamment l’année exacte de présentation du rapport) ne figurent pas dans le texte fourni. Elles doivent être recherchées dans le rapport complet ou les comptes rendus parlementaires pour qui souhaite vérifier les éléments chronologiques et le détail des propositions.