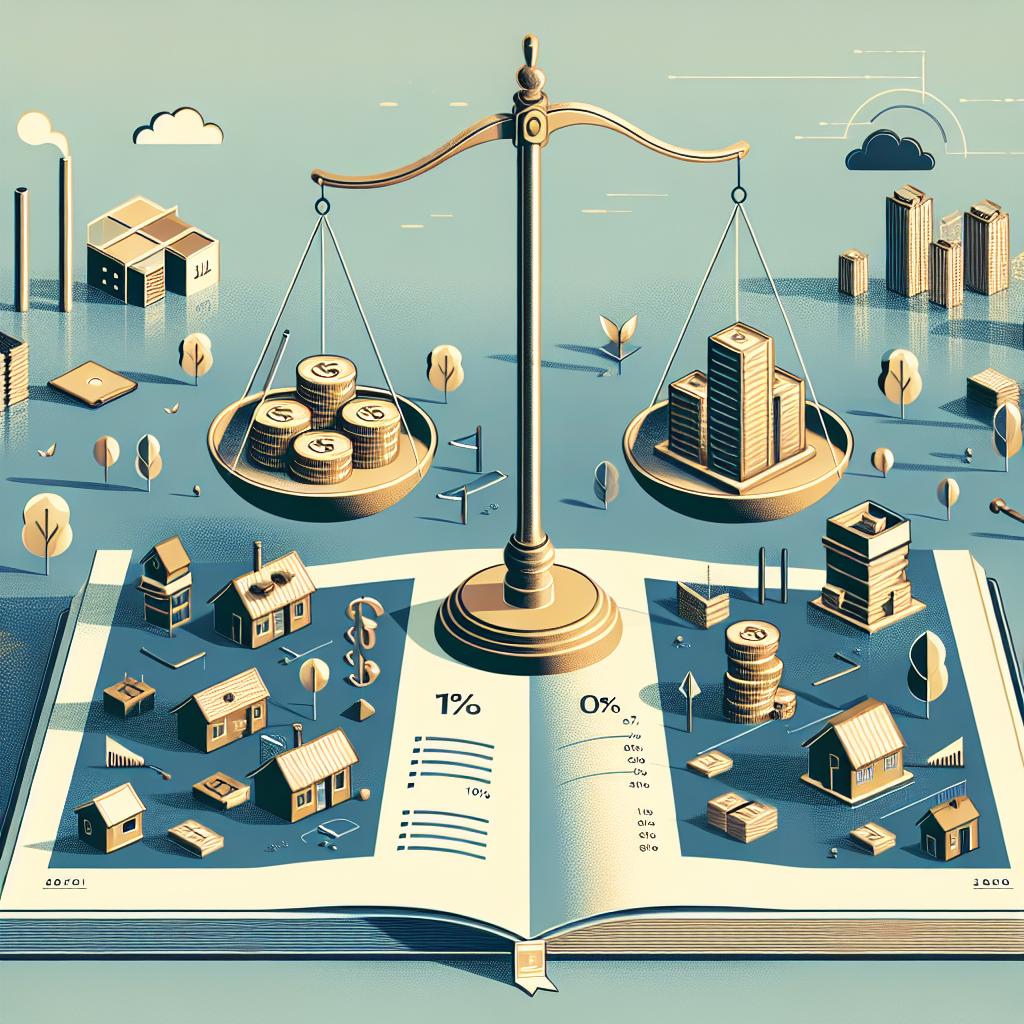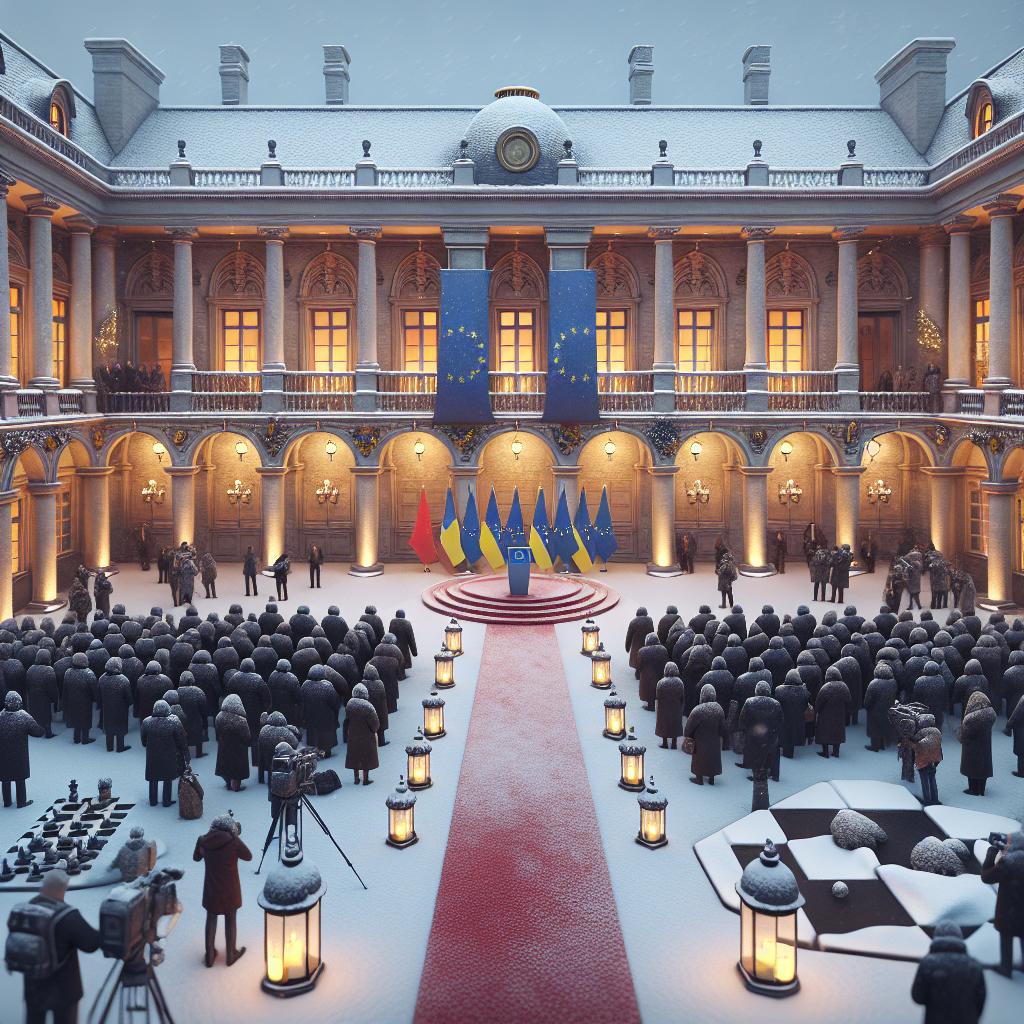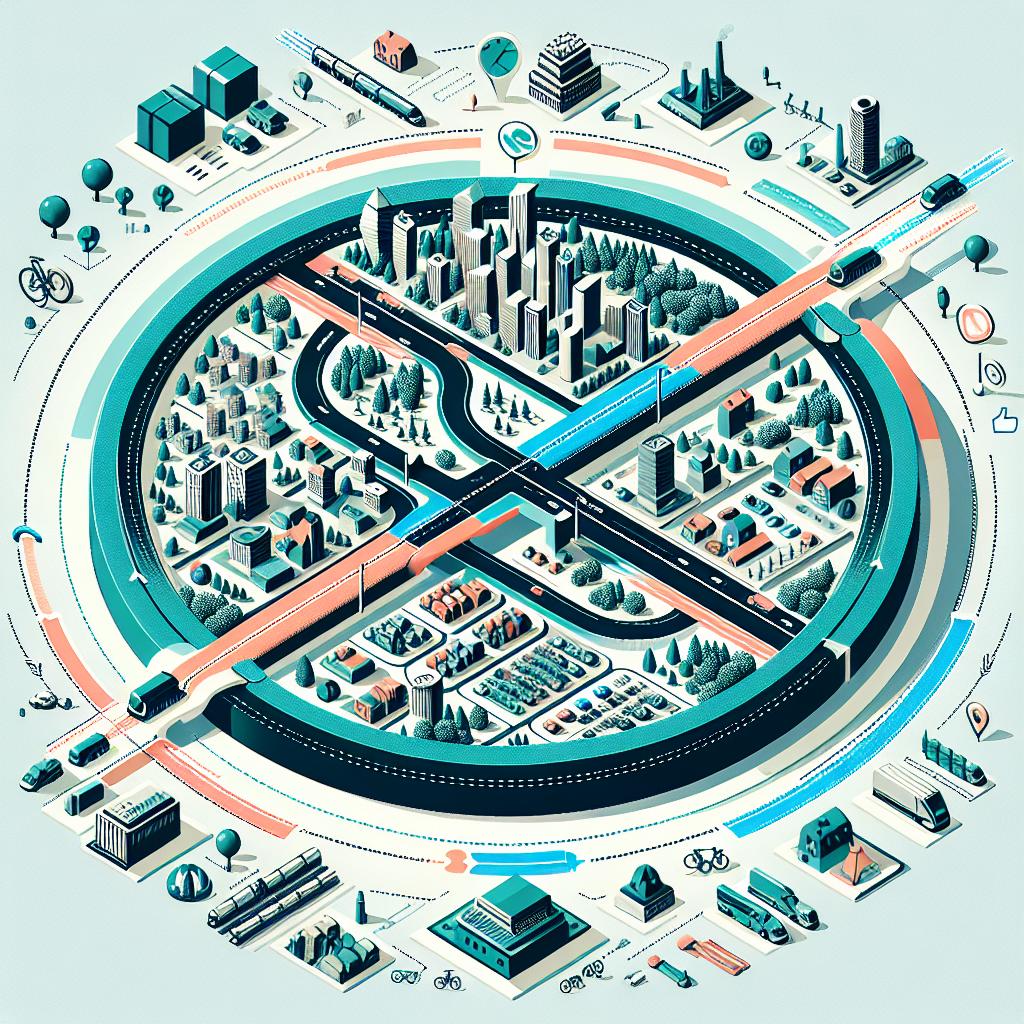À la veille du 80e anniversaire de la Sécurité sociale, le débat public en France reprend les mêmes tensions qu’au lendemain de la Libération : il oppose souvent, de manière simplifiée, le travail à « l’assistanat ». Cette polarisation évacue fréquemment le rôle du capital et occulte les ambitions fondatrices de l’institution. Rappeler ces objectifs originels aide à mieux comprendre ce que la Sécurité sociale fut voulue pour être — et ce qu’elle peut encore inspirer aujourd’hui.
Une ambition claire et assumée
La finalité première de la Sécurité sociale est énoncée sans ambiguïté dans l’exposé des motifs de l’ordonnance du 4 octobre 1945. Le texte explique : « Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d’infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d’eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse, à tout moment, la menace de la misère. »
La formulation est radicale dans le ton et explicite dans le contenu. La Sécurité sociale n’est pas seulement un mécanisme technique de protection contre les risques ; elle vise à réduire une insécurité sociale structurelle qui, selon le législateur de 1945, fonde des rapports de classe inégaux.
Redistribution et égalité
Au-delà de la simple couverture des risques, l’ordonnance place au cœur du projet la redistribution : il s’agit de prélever une part du revenu national afin de « compléter les ressources des travailleurs et familles défavorisés ». Cette phrase fait apparaître la Sécurité sociale comme un instrument de redistribution systémique, destiné à corriger des déséquilibres de revenus entre catégories sociales.
Concrètement, cela signifie que la protection sociale n’est pas neutre politiquement. Elle redistribue des ressources vers ceux qui n’ont pour ressource que leur force de travail, et vers les familles exposées à des aléas économiques. L’objectif était aussi, et toujours, de réduire les inégalités entre les bien portants et les malades, entre les célibataires et les personnes chargées de famille, et entre les actifs et les retraités.
Des influences diverses, une même ambition
On a parfois expliqué la radicalité du texte par la présence, parmi ses inspirateurs, de figures liées au Parti communiste français et à la Confédération générale du travail. Cette lecture est partielle. L’ordonnance est aussi le fruit du travail du Conseil national de la Résistance, coalition large rassemblant des sensibilités politiques variées après l’occupation.
La personnalité de Pierre Laroque (1907-1997) joue un rôle central dans la définition conceptuelle du système. Ancien conseiller d’État et spécialiste des assurances sociales, il rejoint Londres et le général de Gaulle en 1943. Ses écrits, antérieurs et postérieurs à 1945, témoignent d’une réflexion approfondie. Laroque décrit ce chantier comme une « révolution conceptuelle », formulant l’idée d’une protection sociale organisée collectivement et fondée sur la solidarité nationale.
La conjonction d’acteurs divers — syndicalistes, résistants, administrateurs — explique en partie la force et la cohérence du projet. Elle illustre aussi la volonté d’inscrire la protection sociale dans un cadre institutionnel stable, financé par des prélèvements sur le revenu et géré en grande partie par les partenaires sociaux.
Réfléchir à l’histoire de la Sécurité sociale invite à dépasser les caricatures contemporaines. Le débat politique actuel, souvent réduit à une antinomie entre « travail » et « assistanat », occulte la dimension collective et redistributive qui a présidé à la création de l’institution.
À l’heure où la question des inégalités et de la protection contre les risques se repose, la mémoire de 1945 offre des repères. Elle rappelle que la Sécurité sociale n’est pas seulement un système d’indemnisation : elle est une construction politique destinée à réduire l’incertitude matérielle et à limiter les écarts de destin entre ceux qui possèdent du capital et ceux qui n’ont que leur travail.
Le 4 octobre 2025 marquera le 80e anniversaire de l’ordonnance de 1945. Cette commémoration constitue une occasion pour mesurer les écarts entre les objectifs initiaux et les pratiques contemporaines, sans perdre de vue le contexte historique et les choix politiques qui ont façonné cet héritage institutionnel.