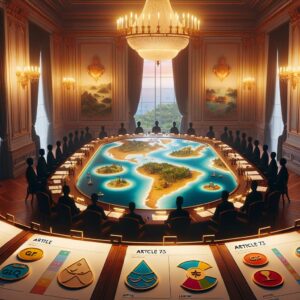Si le mot « désarçonnant » devait être associé à une personnalité, nul doute qu’il trouverait un écho auprès de Donald Trump. Depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier, le président multiplie prises de position tranchées et déclarations publiques, notamment sur le dossier ukrainien.
Dernièrement, sa publication du 23 septembre 2025 sur son réseau Truth Social a surpris : il y qualifie la Russie de « tigre de papier » et assure que l’Ukraine pourrait « retrouver son territoire dans sa forme originelle et peut‑être même aller plus loin » face à Moscou. Ce message tranche avec des prises de position antérieures et illustre la volatilité de sa ligne diplomatique.
Retour en cinq actes
1. Altercation mémorable à la Maison‑Blanche
Le 28 février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est reçu à la Maison‑Blanche pour un échange très attendu. La rencontre, largement retransmise, dérape rapidement sur le plan diplomatique. Devant les caméras, Donald Trump et son vice‑président JD Vance malmènent verbalement Volodymyr Zelensky. Le dirigeant ukrainien garde son calme mais réplique fermement, estimant que ces paroles « finiront par se ressentir » sur le cours du conflit.
Face à l’escalade, Trump hausse le ton : « vous n’êtes pas en position de nous dire cela… vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous risquez la troisième Guerre mondiale ! Ce que vous faites est un manque de respect ». À travers cet échange, l’administration renouvelle l’idée que Kiev « n’a pas les cartes en main » dans ce conflit déclenché en février 2022 par la Russie, tout en signalant un possible infléchissement de la posture américaine.
2. Ultimatum de cinquante jours à Vladimir Poutine
Au cours des premiers mois de son mandat, Donald Trump multiplie les initiatives de médiation. Ses discussions téléphoniques avec Vladimir Poutine, comme celle du 4 juin, produisent peu de résultats tangibles, selon les observateurs. Le 14 juillet, il lance un ultimatum de « cinquante jours » pour mettre fin à la guerre, assorti de menaces de sanctions économiques massives : « si nous n’avons pas un accord d’ici 50 jours… [les droits de douane] seront à 100% ».
Le président évoque également un renforcement de l’armement ukrainien par l’OTAN et décrit son dispositif comme « une très grosse affaire ». Il précise que des équipements militaires d’une valeur de plusieurs milliards de dollars seront achetés aux États‑Unis par des alliés européens, puis distribués « rapidement sur le champ de bataille ».
3. Sommet en Alaska et rencontres bilatérales
Mi‑août, à Anchorage, Trump et Poutine se rencontrent à huis clos. Le 15 août, Donald Trump déroule le tapis rouge sur une base militaire en Alaska : poignées de main chaleureuses, échange de paroles cordiales, puis trois heures d’entretien sans avancée concrète. Les deux présidents se félicitent d’avoir rétabli un canal : surtout, ils ont gagné du temps.
Le ton demeure contrasté. Vladimir Poutine parle d’un « dialogue constructif », tandis que le Kremlin, par la voix de Dmitri Peskov, juge les résultats « proches de zéro ». Les négociations bilatérales relancent cependant l’idée d’une relance d’un processus diplomatique, même si aucun progrès décisif n’est constaté.
4. Avertissements publics et promesses contradictoires
Le 18 août, trois jours après Anchorage, Trump reçoit Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens à la Maison‑Blanche. En amont, il publie un avertissement sur Truth Social : selon lui, Zelensky peut « mettre fin à la guerre presque immédiatement s’il le veut » ou « continuer à combattre ». Le président précise aussi qu’il n’exclut pas que l’Ukraine récupère la Crimée annexée ni qu’elle rejoigne l’OTAN.
Dans le même temps, les alliés européens s’engagent à acheter pour environ 100 milliards de dollars d’armements américains destinés à l’armée ukrainienne. Les discussions sur des garanties de sécurité pour Kiev et sur la formalisation d’engagements se poursuivent, avec l’annonce par Zelensky d’une possible formalisation « d’ici dix jours » de garanties destinées à prévenir toute nouvelle offensive russe.
5. Volte‑face et rupture à l’ONU
Le 2 septembre, lors d’interventions publiques, Donald Trump exprime sa déception envers la Russie et critique l’inaction des négociations. Mais vingt jours plus tard, la volte‑face est complète. Après un entretien avec le président ukrainien en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, le 23 septembre, Trump publie une déclaration sur Truth Social expliquant que l’Ukraine pourrait « retrouver son territoire » et allant jusqu’à qualifier la Russie de « tigre de papier ».
Cette suite d’événements illustre des positions souvent contradictoires, perçues par certains observateurs comme des tentatives de pression sur Kiev ou, au contraire, comme des efforts de médiation. Les déclarations publiques, les ultimatums et les annonces d’aides militaires coexistent sans que l’on observe, à ce stade, un aboutissement clair d’un processus de paix durable.
Au fil des actes, la politique américaine apparaît marquée par des oscillations et un calendrier diplomatique serré. Les engagements chiffrés (50 jours, 10–12 jours, 30 jours, 100 milliards de dollars) et les messages publics restent des éléments centraux pour interpréter la stratégie annoncée et ses conséquences sur le terrain.