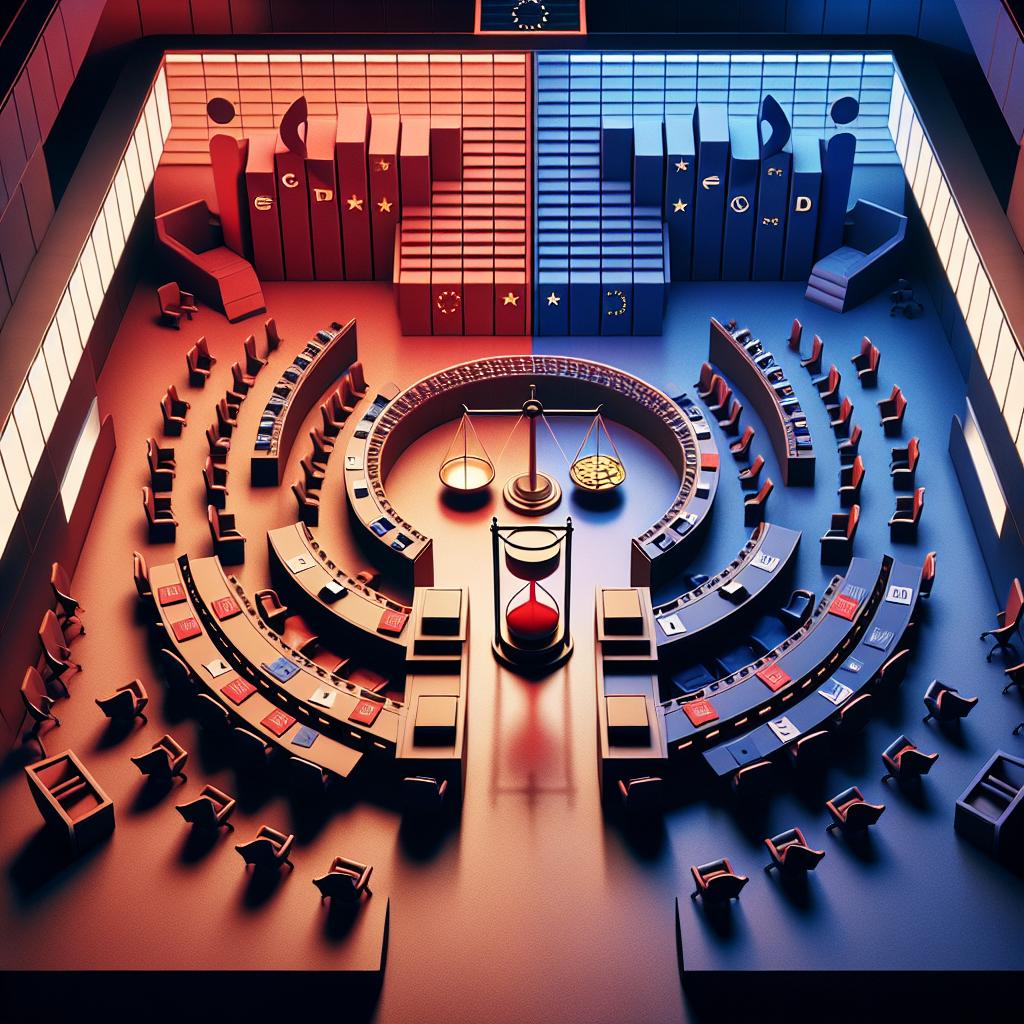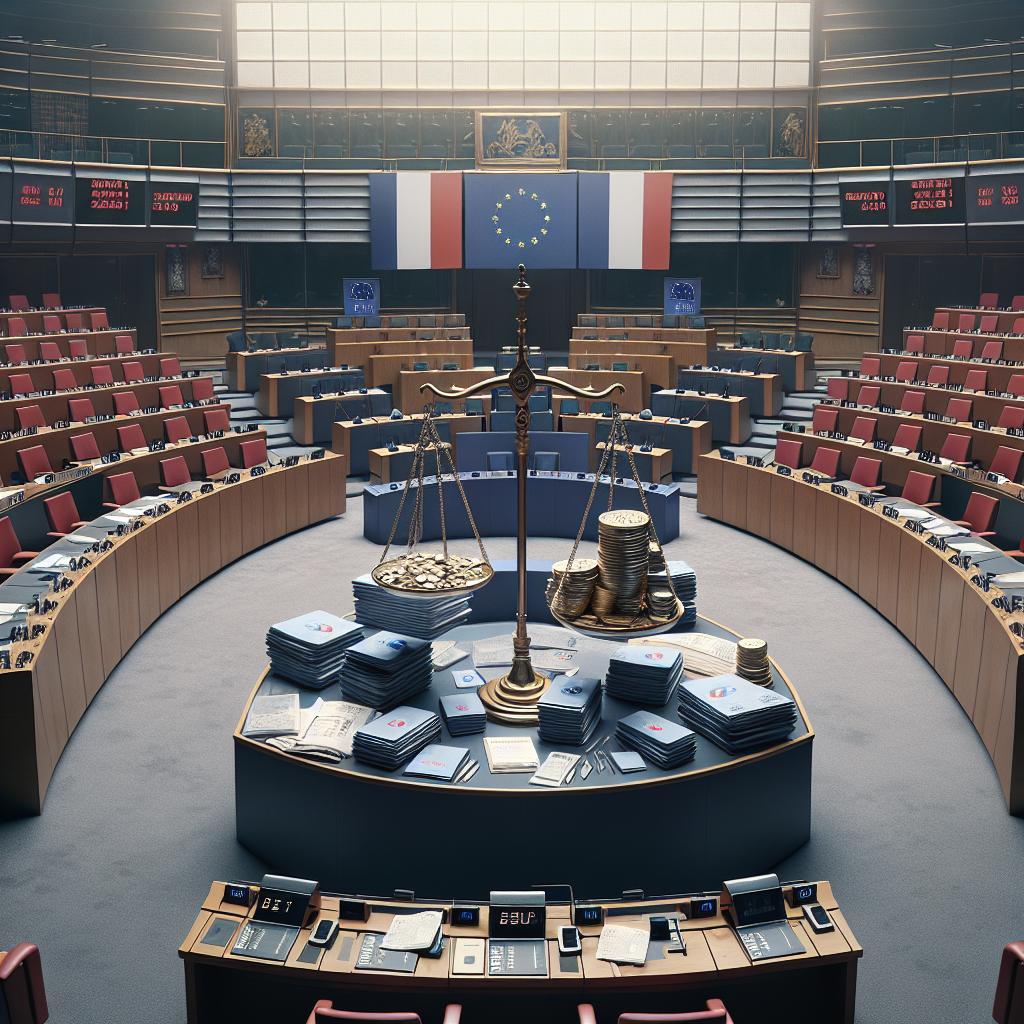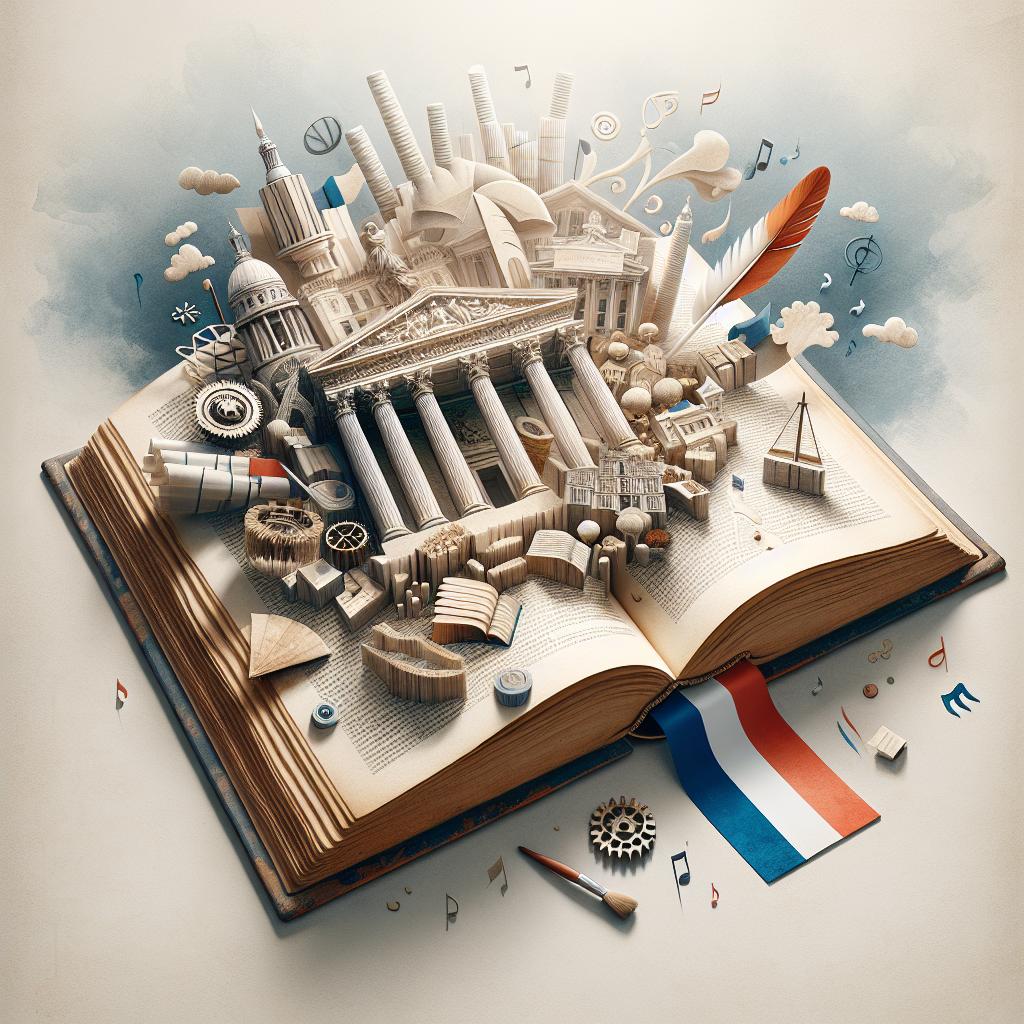Qui contesterait aujourd’hui l’existence des familles recomposées en raison du brouillage relationnel qu’elles entraînent ? Chaque enfant concerné peut avoir plusieurs parents et beaux‑parents, et parfois un grand nombre de grands‑parents. Mais le fait que les fêtes familiales exigent une logistique parfois complexe suffit‑il à réclamer le retour à un modèle unique et ordonné, celui de la famille nucléaire ?
La question n’est pas purement familiale. Dans le monde professionnel, beaucoup d’organisations subissent la même dispersion des responsabilités : chacun participe à plusieurs projets et ne comprend pas toujours la cohérence qui les relie. Devrait‑on pour autant revenir à un organigramme strict et hiérarchique, en « râteau » ?
Une proposition de simplicité pour l’action publique
Le parallèle permet de lire autrement l’annonce récente du nouveau premier ministre sur l’action publique locale. Il y a été question d’un « grand acte de décentralisation » fondé sur la clarification des compétences entre collectivités et sur la fin des financements croisés entre elles. Cette formulation reprend le diagnostique déjà exprimé par le président de la République lors du Congrès des maires, en novembre 2023, qui jugeait l’organisation actuelle « cul par dessus tête » et proposait une remise en ordre comparable à celle d’un « jardin à la française ».
La promesse première de cette orientation est claire : offrir aux contribuables une lecture simple et lisible des dépenses publiques. Une architecture administrative plus lisible paraît de prime abord rassurante et propice à des économies visibles.
Illusion historique et limites pratiques
Pour comprendre les limites de cette quête de simplicité, il faut rappeler un point historique souvent oublié : la décentralisation n’est pas née d’hier. Dès 1982, les lois Defferre ont posé les bases d’un partage de compétences entre l’État et les collectivités territoriales. Elles ont aussi introduit, parfois décrite ainsi, une logique de « taylorisme territorial » : chaque niveau se voit attribuer un bloc de compétences spécialisé.
Dans les faits, cette séparation nette n’a jamais tenu. Les collectivités locales se retrouvent régulièrement à traiter des sujets qui débordent les cadres juridiques et financiers stricts. Les raisons sont multiples : interdépendance des enjeux (logement, transports, énergie, social), adaptations locales imprévues, et besoins de coordination à l’échelle intercommunale ou régionale.
Financements croisés et enjeux partagés
Le nouveau discours critique les financements croisés entre collectivités. Or ce phénomène n’est pas seulement le résultat de rivalités ou d’improvisations budgétaires : il traduit surtout la nature transversale de nombreux problèmes publics. Quand un territoire veut améliorer ses transports, réduire la précarité énergétique ou soutenir une transition économique, les réponses pertinentes mobilisent plusieurs niveaux de décision et plusieurs sources de financement.
Supprimer ou durcir les règles de péréquation et de cofinancement sans repenser les mécanismes de coordination risque d’aboutir à des impasses opérationnelles. Les acteurs locaux peuvent se retrouver sans leviers suffisants pour mener des politiques complexes, même si, sur le papier, les responsabilités paraissent mieux délimitées.
Autre élément à prendre en compte : la quête d’économies visibles peut générer des effets d’annonce qui masquent des transferts de charges moins transparents. Clarifier les compétences est utile ; mais si cela signifie surtout que certaines dépenses seront renvoyées d’un échelon à un autre sans adaptation des ressources, la pression sur les finances locales pourrait s’en trouver renforcée.
La réalité administrative reste donc traversée d’arbitrages, de compromis et d’ajustements permanents. La complexité institutionnelle est en partie le reflet de la complexité des problèmes à résoudre.
En l’état, la proposition d’un « grand acte de décentralisation » pose une question simple et deux défis : comment définir des frontières de compétences qui restent opérationnelles pour des enjeux transversaux, et comment assurer que la simplification formelle ne dégénère pas en désengagement financier d’un niveau de collectivité au profit d’un autre ?
Sans réponse claire à ces défis, la réforme risque de rester une promesse de lisibilité, plutôt qu’un outil d’efficacité locale. Elle illustre, enfin, la tentation récurrente de ramener des systèmes complexes à des schémas simples — une tentation séduisante mais qui, si elle est mal conduite, peut se révéler trompeuse.