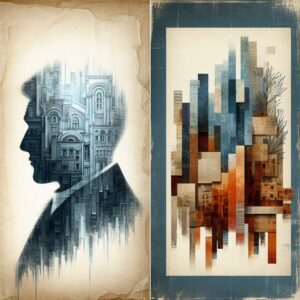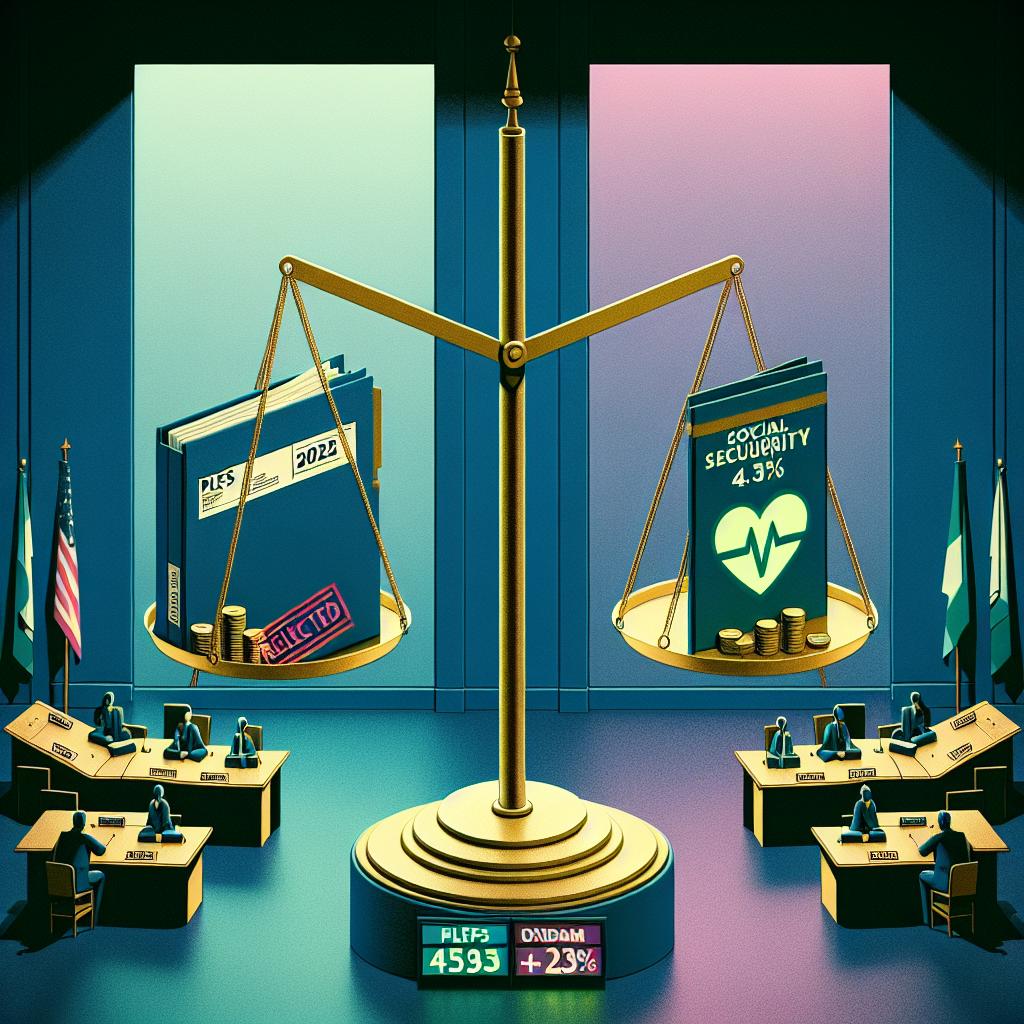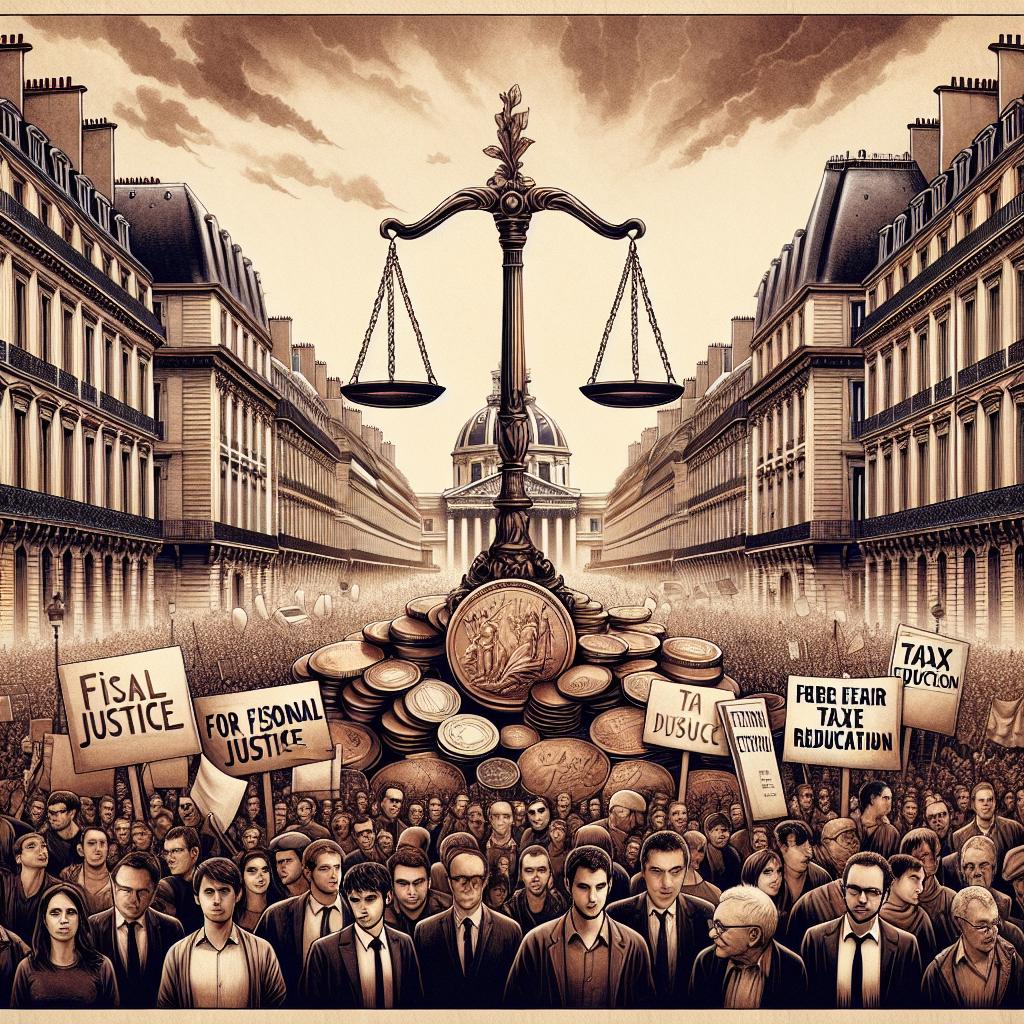A quoi sert de débattre d’un budget quand son adoption et son exécution paraissent incertaines ? À l’approche de débats parlementaires annoncés comme houleux, cette question revient avec insistance parmi députés et sénateurs.
Le calendrier légal prévoit soixante-dix jours de discussions pour un projet de loi de finances. Mais, compte tenu de la crise politique évoquée dans le rapport cité, il n’est pas certain qu’un texte soit adopté dans ce délai. Et, même en cas d’adoption et de promulgation, rien ne garantit que l’ensemble des mesures inscrites dans la loi sera effectivement appliqué.
Les constats du rapporteur général
Ces éléments figurent au cœur du rapport présenté mardi 30 septembre à la commission des finances de l’Assemblée nationale par le rapporteur général du budget, le député centriste Charles de Courson (Utiles, Marne). Il formule plusieurs constats sur la chaîne qui doit relier une loi votée à sa mise en œuvre concrète.
Première observation : l’administration met du temps à prendre les actes réglementaires nécessaires pour que la loi entre en vigueur. Dans le cas du budget 2025, le rapport note qu’à ce jour seuls 36 % des décrets requis ont été publiés. Le document explique que certains textes attendent, en outre, un avis préalable de Bruxelles afin de vérifier leur conformité avec le droit européen.
L’exécution contestée des lois
Le deuxième point d’alerte porté par Charles de Courson tient à l’attitude de l’exécutif face à des dispositions adoptées par le Parlement. « L’exécutif s’assoit parfois sur certaines dispositions ‘pourtant régulièrement adoptées par le législateur et promulguées’ », écrit-il. Il ajoute : « La pratique semble devenue courante depuis 2024. »
Cette critique vise des choix de mise en œuvre qui, selon le rapporteur, conduisent à écarter des dispositions pourtant votées. Le problème dépasse la simple technique administrative : il touche à la confiance entre pouvoirs et à la prévisibilité juridique.
Impacts pratiques et enjeux politiques
Lorsque des mesures prévues au budget ne sont pas traduites en actes réglementaires, leur application devient aléatoire. Cela peut retarder des dépenses, bloquer des dispositifs fiscaux ou sociaux, et rendre incertaine la planification des administrations, des collectivités et des acteurs économiques concernés.
Le rapporteur insiste sur le fait que la dérive signalée porte souvent sur des sujets à forte portée politique. À ce titre, l’enjeu est double : il s’agit à la fois de respecter la séparation des rôles entre Parlement et gouvernement et d’assurer la mise en œuvre effective des choix budgétaires décidés démocratiquement.
Questions de procédure et perspectives
Le rapport met en lumière deux goulots d’étranglement principaux : le délai de publication des décrets et la nécessité d’avis européens pour certains textes. Le premier ralentit l’entrée en vigueur des mesures ; le second est contraint par des exigences de conformité au droit de l’Union.
Sans préconisations détaillées dans le texte cité, la lecture du rapport invite à s’interroger sur la coordination entre les services de l’État, la clarté des calendriers réglementaires et la transparence des motifs conduisant le gouvernement à différer ou à ne pas appliquer certaines dispositions.
En l’état, le constat formulé par le rapporteur général interroge la capacité des institutions à garantir que le vote parlementaire se traduise systématiquement en droits et obligations effectifs. De telles lacunes, si elles se confirmaient, poseraient des questions de légitimité démocratique et de bonne gouvernance.
Le débat parlementaire à venir s’annonce donc non seulement comme une discussion sur des montants et des priorités budgétaires mais aussi comme une interrogation sur la chaîne institutionnelle qui assure, ou non, la traduction des lois en actes concrets.