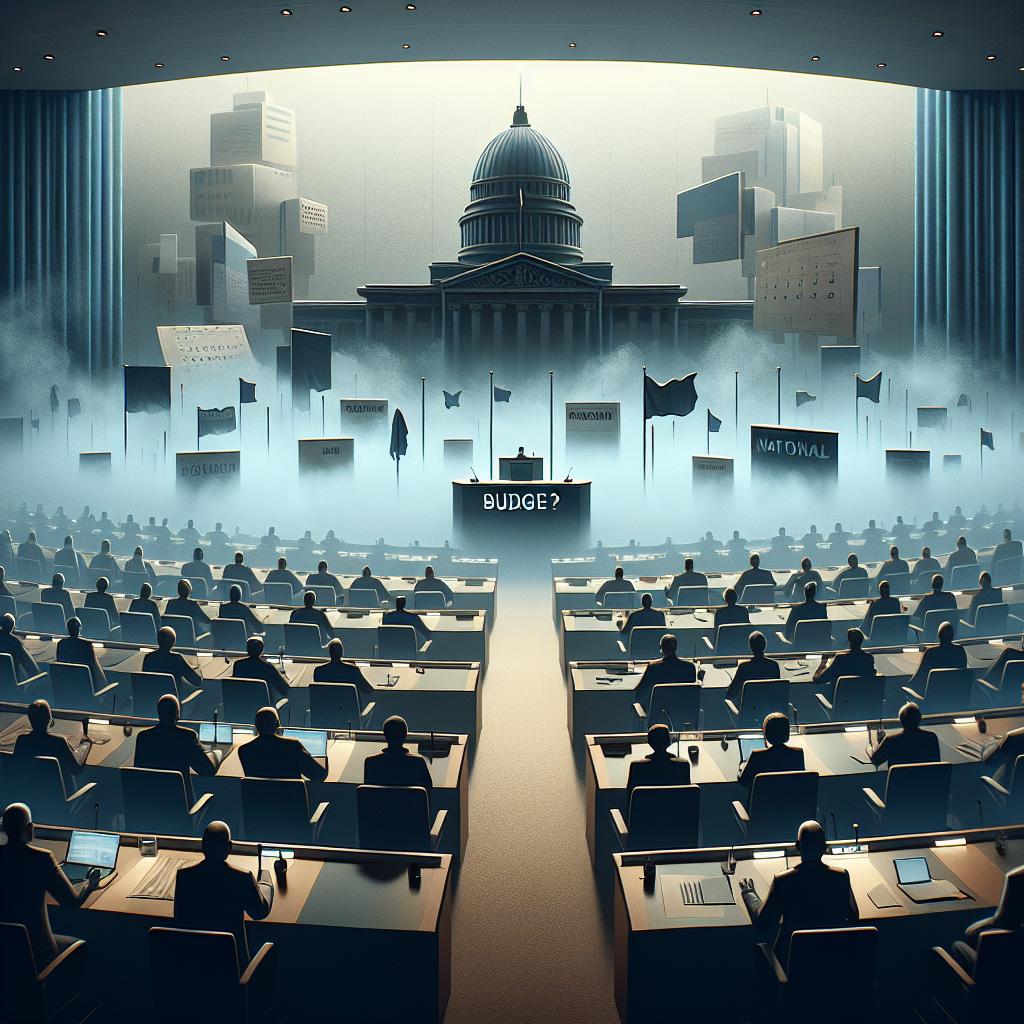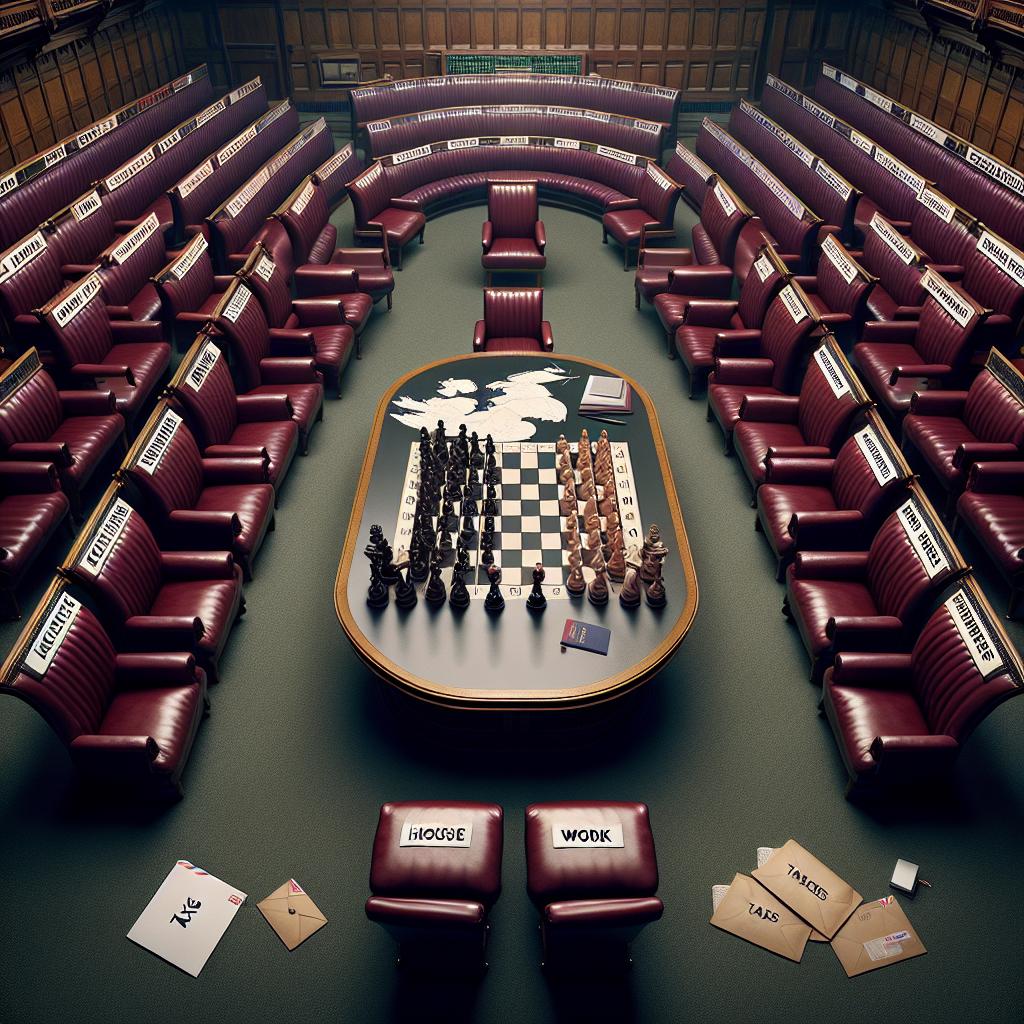« Indignation », « lassitude », « colère » : ces mots résument l’humeur des élus locaux réunis à Aussonne (Haute‑Garonne), près de Toulouse. « On en a ras le bol », reconnaît Jérôme Baloge, maire (centriste) de Niort (Deux‑Sèvres), qui exprime son « incompréhension » face à un « déphasage croissant » entre les décideurs nationaux et les collectivités de terrain.
« Nous sommes consternés par ce que l’on voit. Un épais brouillard est tombé sur le pays, même si les élus locaux sont en fonctions et au travail », ajoute-t-il, résumant le sentiment de nombreux participants.
Une convention marquée par l’exaspération
La convention des intercommunalités de France, qui s’est tenue à Aussonne du 8 au 10 octobre, a rassemblé environ 2 000 élus, selon les organisateurs. Ils représentent les 1 254 structures intercommunales (les « intercos ») qui assurent pour le compte des communes un certain nombre de services publics.
Les débats ont mis en lumière une préoccupation centrale : la difficulté pour ces structures à assurer leurs missions dans un contexte d’incertitudes politiques et financières. Plusieurs intervenants ont insisté sur la nécessité d’outils et de décisions lisibles au niveau national pour permettre aux territoires de planifier et d’investir.
Des conséquences pratiques sur les projets locaux
« On est en bout de chaîne », explique Marc Mossé, vice‑président (sans étiquette) de la communauté d’agglomération des Sorgues du Comtat et premier adjoint d’Althen‑des‑Paluds (Vaucluse). Son intervention souligne le lien direct entre les décisions nationales et la capacité des intercommunalités à conduire des opérations locales.
« Et on souffre des difficultés de la France pour faire notre travail au quotidien. Quand il n’y a pas de budget, nous, derrière, on ne sait pas quelles subventions on va avoir et, par effet domino, on monte moins de projets… », poursuit M. Mossé, décrivant un mécanisme de blocage opérationnel : incertitude sur les dotations, report ou annulation d’investissements, assèchement des initiatives locales.
Plusieurs élus ont rappelé que les intercommunalités assurent des services essentiels (eau, assainissement, ordures ménagères, transports, développement économique, etc.). L’absence de visibilité budgétaire au sommet pèse donc concrètement sur la qualité et la pérennité de ces services pour les administrés.
Un fossé perçu entre l’échelon national et le terrain
Les témoignages réunis à Aussonne décrivent un fossé croissant entre les discours nationaux et la réalité des communes et intercommunalités. Le « déphasage » pointé par M. Baloge renvoie à une impression partagée d’éloignement des décisions par rapport aux besoins locaux.
Certains élus ont mis en avant la difficulté de dialoguer avec des instances nationales perçues comme instables ou peu lisibles, ce qui complique la mise en œuvre de politiques publiques sur le terrain. Le sentiment d’abandon est alimenté par la multiplication des mesures à portée nationale, parfois sans calendrier ni financement clairement définis pour les acteurs locaux.
Ce constat a alimenté les discussions sur la gouvernance territoriale et la nécessité d’une meilleure coordination entre les niveaux de décision. Les participants ont souligné l’importance d’une information transparente sur les marges de manœuvre financières des intercommunalités et sur les priorités d’investissement à court et moyen terme.
Des attentes claires mais peu de solutions immédiates
À l’issue de la convention, le message des élus locaux est resté centré sur trois attentes : davantage de lisibilité budgétaire, une concertation durable avec l’État et des mécanismes de financement stabilisés pour permettre la réalisation des projets.
Malgré l’exaspération affichée, les élus ont aussi rappelé leur rôle opérationnel : ils continuent d’assurer les missions de service public au quotidien et d’adapter leurs priorités aux contraintes. Mais le fil conducteur des interventions était la même : sans visibilité nationale, la capacité d’initiative des intercommunalités s’en trouve affaiblie.
La convention d’Aussonne a permis de faire remonter ces préoccupations au niveau collectif. Reste à savoir quelles réponses institutionnelles ou budgétaires seront proposées pour lever l’incertitude dénoncée par les participants et restaurer une articulation plus fluide entre l’échelon national et les territoires.