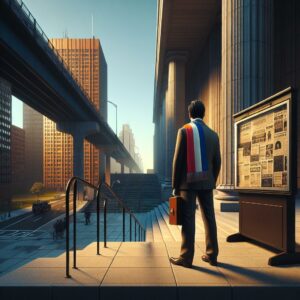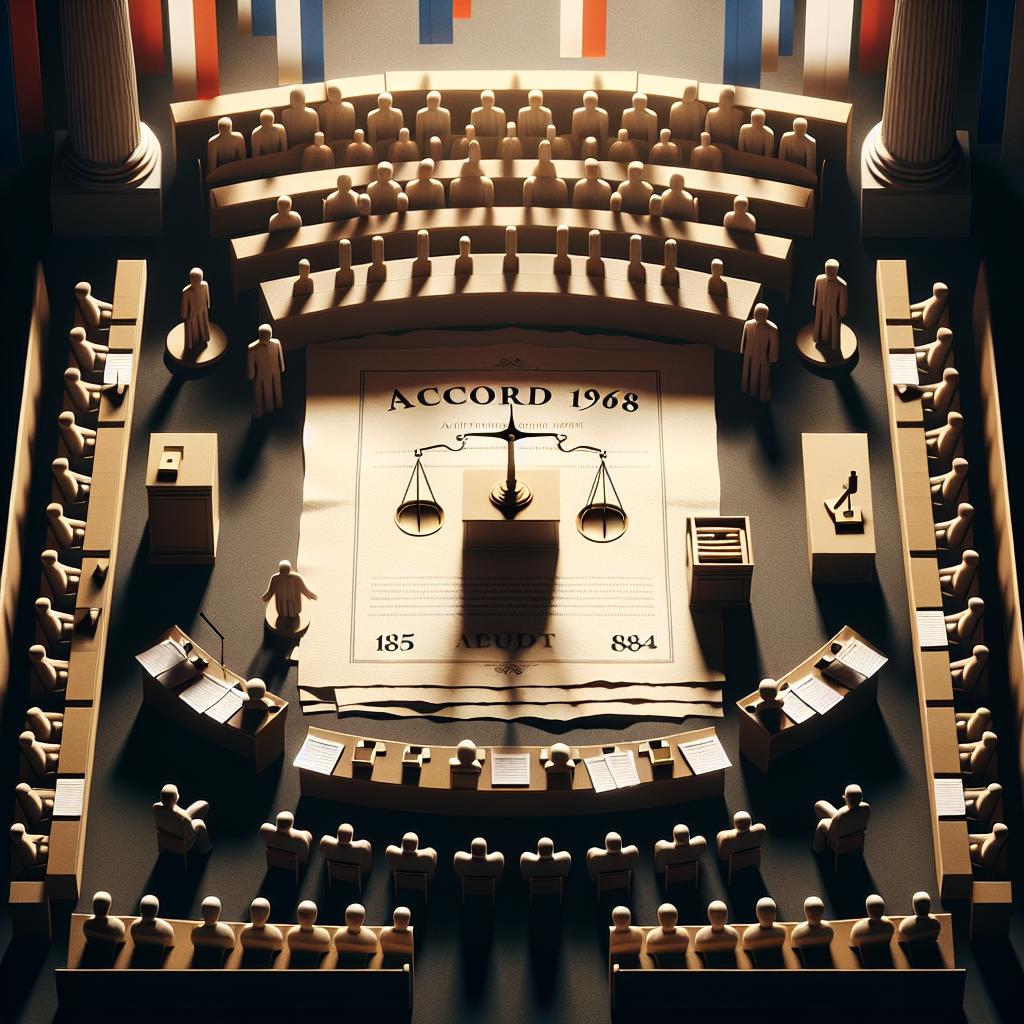À la différence de Berlin, Stockholm ou Londres, qui possèdent chacun un musée consacré à leurs réseaux de transport urbain, Paris ne dispose pas encore d’un lieu dédié aux vestiges de son histoire des transports. Le projet d’un « musée des transports urbains parisiens » a commencé à prendre forme au sein de la RATP en 2023, lorsque Jean Castex, alors nouveau président-directeur général et avoué « ferrovipathe », a lancé l’idée de créer un espace consacré au métro centenaire, aux tramways et aux bus de la capitale.
Origine et calendrier annoncés
Depuis l’esquisse initiale, la RATP a précisé certains éléments du projet. La régie a annoncé une date d’ouverture envisagée en 2032, une échéance qui reste à confirmer au fil des étapes de conception et des autorisations. Le projet est resté porté par la RATP, qui pilote aujourd’hui les études et les choix de localisation, selon « Le Monde », qui s’est entretenu avec la régie parisienne.
Les promoteurs du musée présentent l’initiative comme une manière de préserver et de valoriser des collections, des véhicules et des archives qui documentent plus d’un siècle de mobilités à Paris. Le calendrier 2032 évoqué par la RATP donne une cible claire, mais la réalisation effective dépendra des travaux, du financement, et des décisions administratives à venir.
Le site retenu : ateliers de Championnet (18e)
La RATP a choisi d’implanter le futur musée au cœur des ateliers de maintenance de Championnet, situés dans le 18e arrondissement de Paris. Ce site industriel de quatre hectares est affecté aux activités liées aux transports urbains depuis la fin du XIXe siècle. Il a successivement appartenu à la Compagnie générale des omnibus, à la Compagnie du métropolitain parisien puis, plus récemment, à la RATP.
Le lieu retenu se trouve dans une halle de 12 000 mètres carrés, édifiée après la seconde guerre mondiale. La RATP envisage d’aménager cet espace pour y rassembler véhicules historiques, objets techniques et pièces d’archives, afin d’offrir une lecture chronologique et technique de l’évolution des transports parisiens. La surface évoquée — 12 000 m2 dans une zone centrale — est rare à Paris et représente un atout pour accueillir expositions permanentes et espaces de restauration des véhicules.
Le site de Championnet jouxte d’autres emprises opérationnelles, comme le centre de bus Belliard. La proximité de ces installations pose des questions d’usage et de déploiement logistique qui devront être résolues lors des phases de programmation et de chantier.
Positions institutionnelles et propriété
La conservation de ce foncier au sein de la RATP ne s’est pas faite sans discussions. Île-de-France Mobilités (IDFM), autorité organisatrice des transports dans la région, avait manifesté le souhait de devenir propriétaire de ce type de sites, comme elle l’a fait pour d’autres emprises. Pour autant, IDFM a fait savoir à la presse qu’elle n’était « en rien associée » au projet de musée et a qualifié l’initiative de « un projet de Jean Castex », reprenant ainsi la formulation employée par ses services.
La séparation des rôles entre RATP et IDFM reste un point d’attention pour l’avenir du musée : financement, maîtrise foncière et montage institutionnel devront être clarifiés pour assurer la pérennité du lieu et son ouverture au public.
Depuis l’annonce initiale, la RATP poursuit les études préalables. Le chemin jusqu’à l’ouverture effective devrait inclure des phases de conception architecturale, d’ingénierie patrimoniale et de restauration des objets mobiliers. La date 2032 constitue aujourd’hui la référence communiquée par la régie, mais le calendrier pourrait évoluer en fonction des arbitrages à venir et des contraintes techniques.
Ce projet, s’il se concrétise, permettra de combler une lacune muséographique à Paris et d’offrir au public un nouvel espace pour comprendre l’histoire technique et sociale des transports urbains parisiens. En l’état, la RATP pilote le dossier et communique une ambition assortie d’une localisation et d’une cible temporelle, tandis que d’autres acteurs régionaux observent et rappellent la nécessité d’un cadrage institutionnel clair.