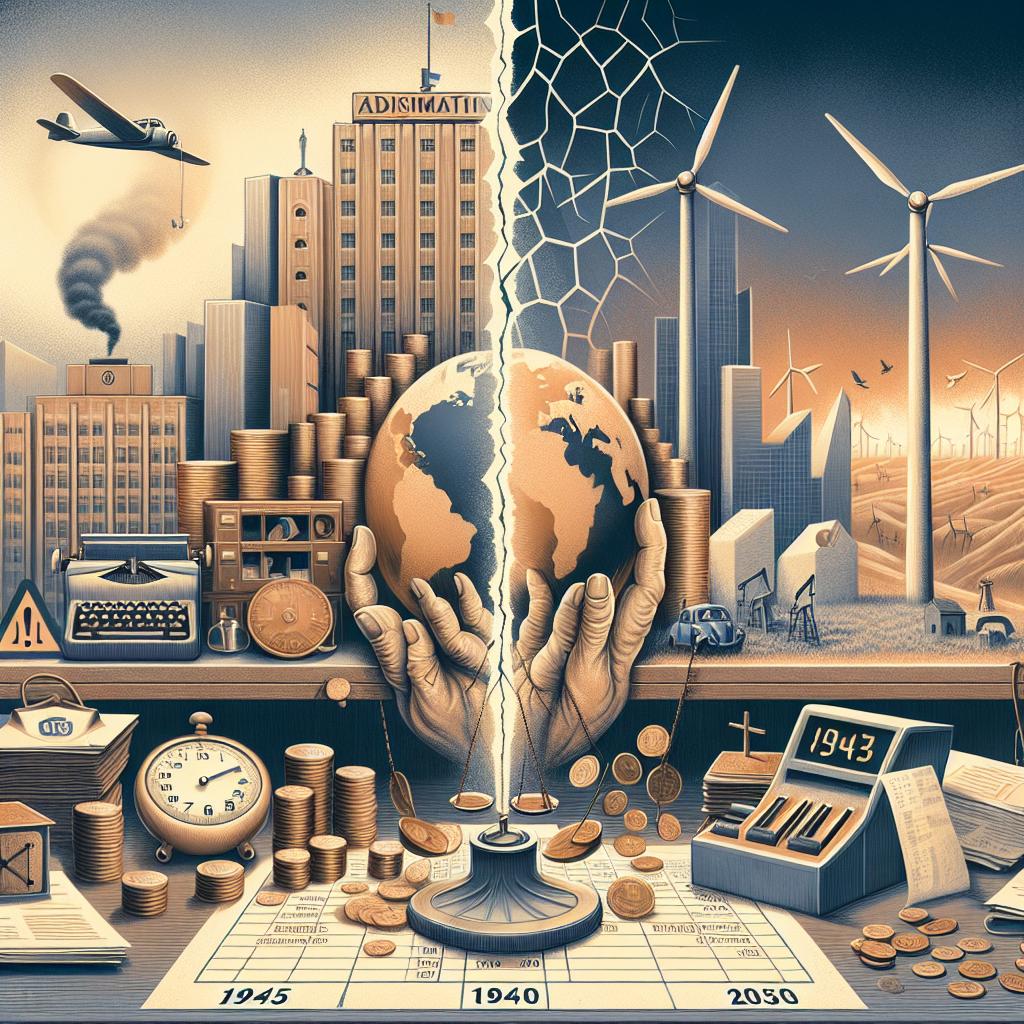Une impasse aux causes multiples
L’impasse politique qui s’est installée depuis plus d’un an résulte de facteurs variés et convergents. On y retrouve la décomposition des partis politiques traditionnels, une radicalisation accrue du paysage politique, une crise de la démocratie observable dans plusieurs pays, l’échec de certaines politiques publiques à améliorer le quotidien des citoyens, la dissolution qualifiée d’aventureuse de l’Assemblée nationale et, plus personnellement, le rôle de la personnalité d’Emmanuel Macron.
Ces éléments, pris isolément, contribuent à expliquer une tension durable. Ils ne doivent toutefois pas faire oublier une cause structurelle, plus profonde et transversale : l’addiction des responsables politiques au présidentialisme majoritaire.
Qu’entend-on par « addiction au présidentialisme » ?
Par présidentialisme majoritaire, on désigne la concentration du pouvoir entre les mains d’un chef de l’État soutenu par une majorité docile à l’Assemblée nationale. L’addiction politique à ce modèle se traduit par la croyance largement répandue au sein des élites et des partis selon laquelle cette concentration du pouvoir constituerait l’essence même des institutions de la Ve République.
Conséquence directe de cette lecture : la pratique présidentialiste s’impose comme la norme, et toute lecture différente de la Constitution du 4 octobre 1958 est présentée comme contraire à « l’esprit des institutions ».
Une double confusion historique
Cette croyance repose sur une double confusion qu’il convient de clarifier. D’abord, elle assimile trop rapidement la pratique présidentialiste portée par le général de Gaulle à l’intention des constituants de 1958. En réalité, l’élaboration de la Constitution ne se réduit pas à l’enregistrement des choix d’un seul homme : le texte est le produit de compromis entre acteurs politiques et institutions internes, et ces compromis n’impliquent pas nécessairement la mise en oeuvre immédiate d’une pratique présidentialiste telle qu’elle se développera ultérieurement.
Ensuite, la lecture courante omet que la mise en pratique du présidentialisme a pris forme progressivement. La pratique présidentialiste, telle qu’elle est perçue aujourd’hui, ne s’est pleinement affirmée qu’à partir des années 1960, et elle a évolué au fil des décennies en fonction des usages politiques et institutionnels.
Un renversement historique
Autre point essentiel : le présidentialisme d’origine n’était pas identique à la pratique contemporaine. Il était, dans une certaine mesure, tempéré par la responsabilité directe du chef de l’État devant le peuple. L’exemple souvent cité est celui de 1969, lorsque Charles de Gaulle interpréta l’échec d’un référendum comme un retrait de confiance et choisit de démissionner. Ce geste illustre une conception du pouvoir où le président restait soumis à un contrôle politique et symbolique de l’opinion populaire.
À l’inverse, la situation récente montre un renversement de cette logique. Les appels à la démission d’Emmanuel Macron, évoqués ces derniers mois par certains opposants, ont été présentés par des alliés et des partisans comme contraires à « l’esprit » de la Ve République. Ce retournement souligne une tension : les règles implicites du jeu politique ont évolué, et la référence à l’esprit constitutionnel sert parfois à justifier des pratiques institutionnelles nouvelles ou inversées.
Conséquences pour la vie politique
Cette addiction au présidentialisme a des conséquences visibles sur la qualité du débat public et sur le fonctionnement des institutions. Elle renforce l’attente d’un exécutif omnipotent capable de trancher seul des questions complexes, tout en fragilisant les mécanismes de contrepoids parlementaires et la responsabilité collective des gouvernements devant les assemblées représentatives.
En outre, l’idée que la légitimité du pouvoir dépend d’une majorité disciplinée à l’Assemblée nationale encourage des stratégies politiciennes de court terme, axées sur la conquête ou la conservation d’une majorité, au détriment de l’élaboration de politiques publiques durables.
Au terme de cette analyse, l’addiction des responsables politiques au présidentialisme apparaît moins comme une explication unique que comme une cause structurelle majeure de la crise actuelle. Elle interagit avec les autres facteurs cités — décomposition des partis, radicalisation, difficultés socio-économiques — et contribue à perpétuer une situation d’impasse.
Reste la question implicite : comment reposer les équilibres institutionnels sans réécrire la Constitution ni effacer les compromis historiques ? Le diagnostic posé met d’abord en lumière la nécessité d’une réflexion collective sur la pratique du pouvoir, et non seulement sur son texte.