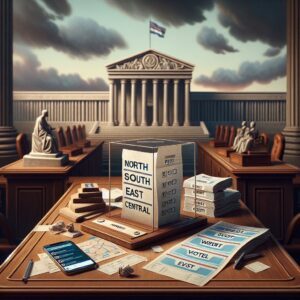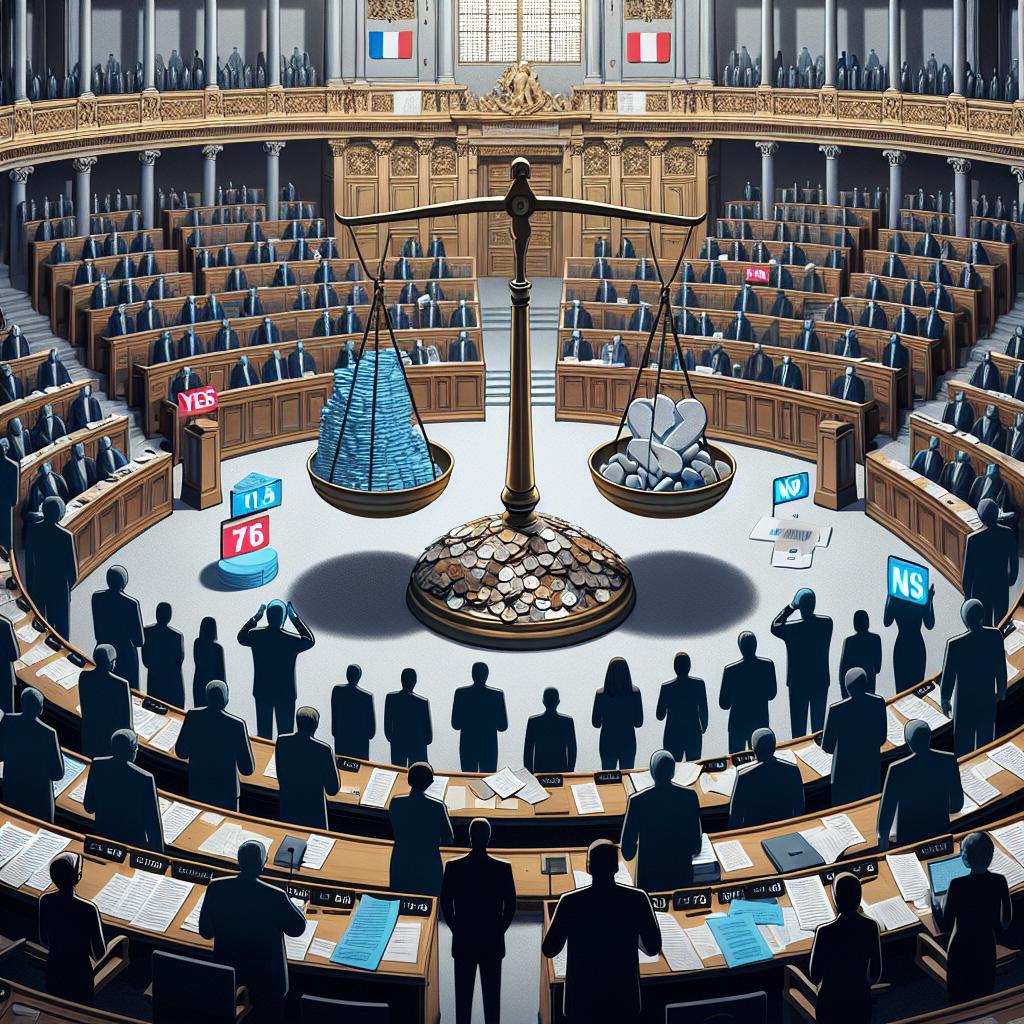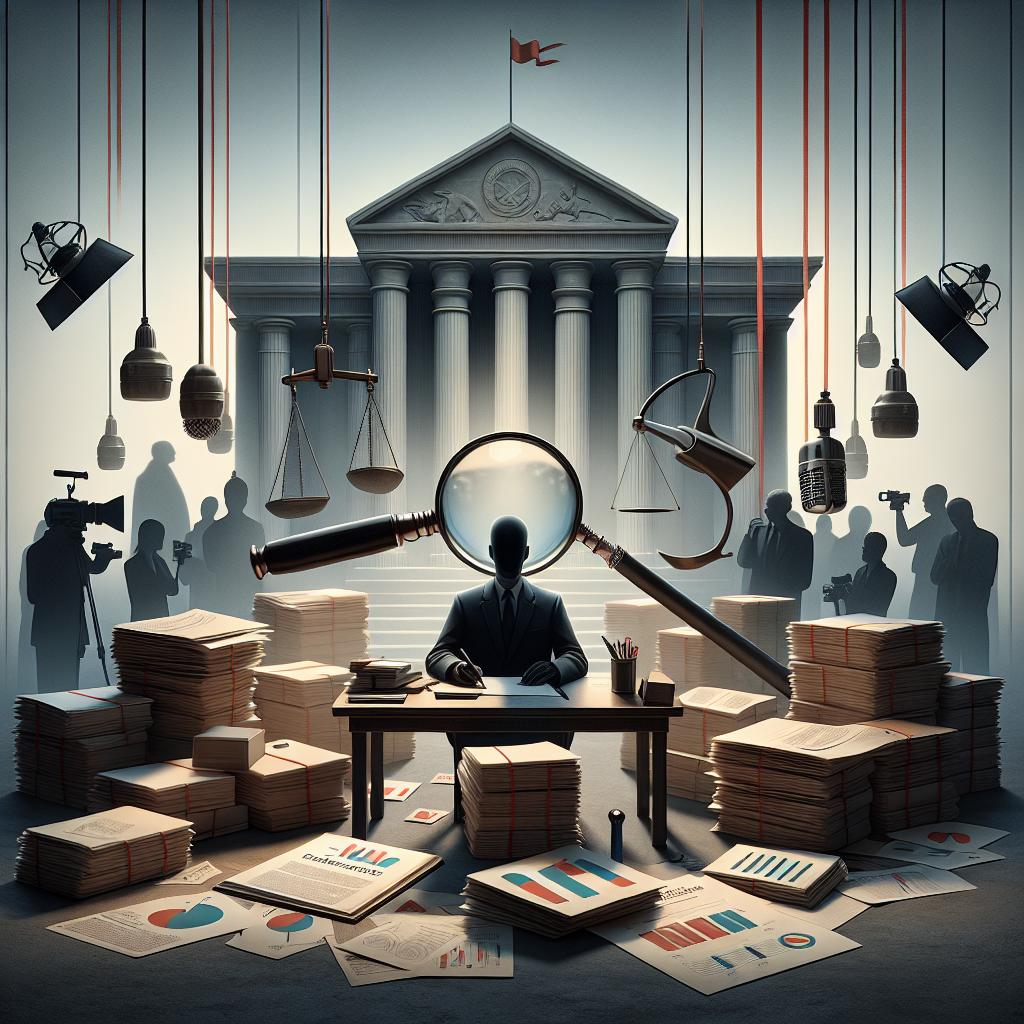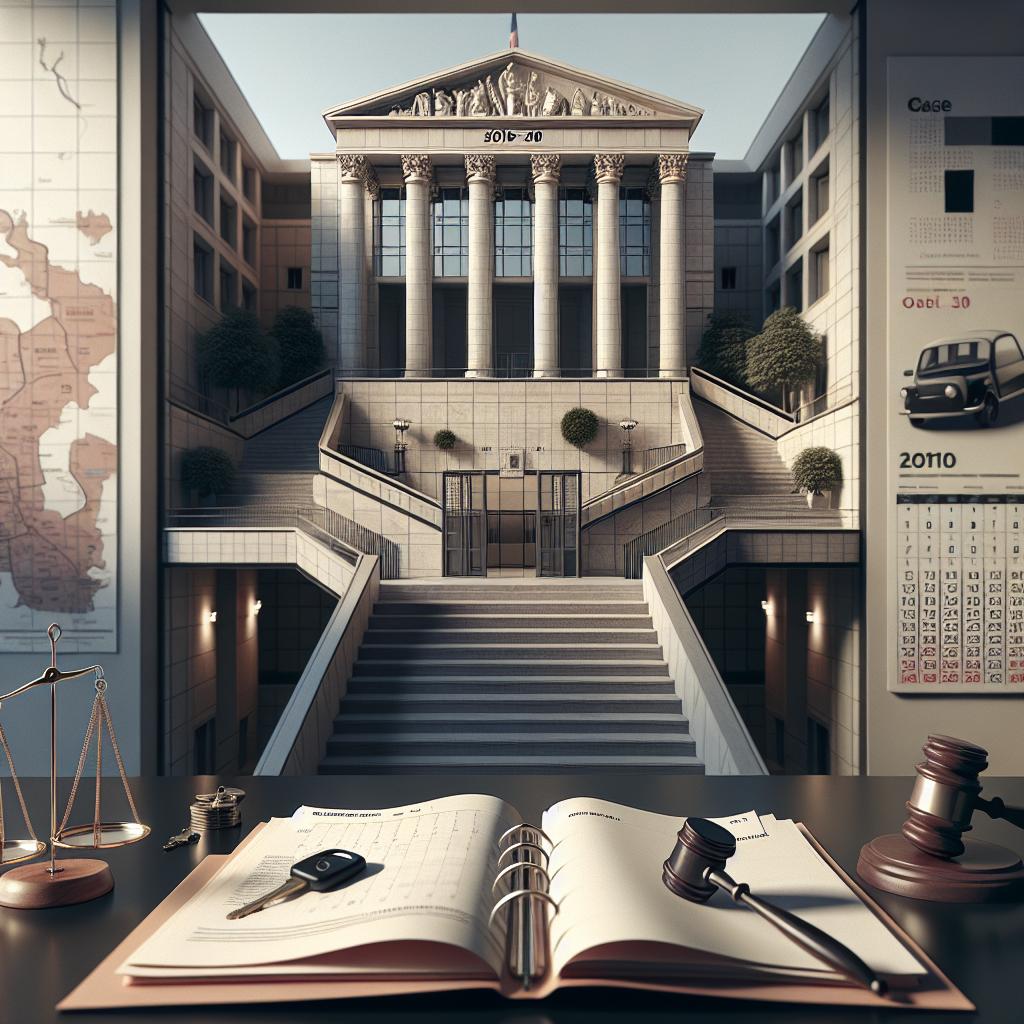Le Conseil d’Etat a été saisi vendredi 10 octobre d’un référé‑suspension pour trancher une question juridique et politique sensible : la France et le Royaume‑Uni pouvaient‑ils convenir, en dehors d’un vote parlementaire, d’un mécanisme d’échange de personnes migrantes à leur frontière commune ?
Le recours déposé par seize organisations
Le recours a été introduit par seize associations, parmi lesquelles le Secours catholique, Utopia 56, l’Auberge des migrants, Médecins du monde et le Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti). Ces organisations demandent la suspension de l’accord bilatéral signé en juillet, connu sous le nom de « One in, one out ».
Les requérants contestent la mise en œuvre immédiate de cet accord et sollicitent du juge des référés qu’il interrompe son application le temps que le litige principal soit examiné. Le dépôt d’un référé‑suspension indique l’urgence et les enjeux perçus par ces associations, sans préjuger du fond.
Les modalités de l’accord « One in, one out »
L’accord signé en juillet prévoit un mécanisme réciproque entre Londres et Paris. Concrètement, le gouvernement britannique peut renvoyer vers la France des personnes qui ont rejoint le Royaume‑Uni après avoir traversé la Manche à bord d’embarcations légères. En parallèle, et sur une base de réciprocité, le Royaume‑Uni accepte d’accueillir sur son sol certaines personnes migrantes se trouvant en transit sur le territoire français.
Le texte vise explicitement à réguler les flux transmanches et à empêcher des traversées jugées dangereuses, mais les modalités précises d’application — critères de renvoi, procédures d’identification et garanties individuelles — font l’objet d’interrogations et de contestations qui ont motivé le recours devant le Conseil d’Etat.
Objectif affiché et chiffres récents
Les deux gouvernements présentent l’accord comme un instrument destiné à dissuader les départs vers le Royaume‑Uni. Selon les éléments cités par les parties, près de 187 000 personnes sont parvenues à traverser la Manche depuis l’émergence du phénomène dit des « small boats » à la fin de 2018. Parmi elles, plus de 35 000 l’auraient fait depuis janvier 2025.
Ces chiffres, repris dans la communication publique des Etats, soulignent l’ampleur et la persistance du phénomène. Ils expliquent en partie la volonté de Paris et Londres de négocier des dispositifs bilatéraux pour mieux contrôler les passages et réduire les risques liés aux traversées en embarcations de fortune.
Enjeux juridiques et politiques
La question centrale posée au Conseil d’Etat est de savoir si un tel accord bilatéral peut entrer en vigueur sans passer par une procédure parlementaire nationale, et si sa mise en œuvre respecte les principes et garanties du droit national et européen. Les requérants estiment que l’accord soulève des doutes sérieux quant à la protection des droits des personnes concernées et aux compétences requises pour l’adopter.
Sur le plan politique, l’affaire illustre les tensions entre mesures de contrôle des frontières, coopération internationale et obligations de protection des personnes migrantes. Elle intervient dans un contexte où la gestion des passages transmanches est devenue un sujet récurrent de friction entre Paris et Londres, et un thème sensible de débat public.
Le sort du référé dépendra de l’appréciation du juge des référés sur l’urgence et le doute sérieux quant à la légalité de l’accord. Si le Conseil d’Etat ordonne la suspension, l’application pratique du mécanisme « One in, one out » serait temporairement interrompue en attendant une décision sur le fond.
À l’inverse, un rejet du référé laisserait l’accord en vigueur pendant l’examen judiciaire ultérieur, ce qui pourrait conduire à son déploiement opérationnel selon les modalités convenues entre les deux Etats.
Le dossier soulève des questions qui dépassent les aspects strictement administratifs : il touche à l’équilibre entre coopération internationale en matière migratoire et respect des garanties procédurales et des droits fondamentaux. Le Conseil d’Etat, saisi en référé, devra arbitrer rapidement l’une des problématiques majeures de la politique migratoire franco‑britannique récente.