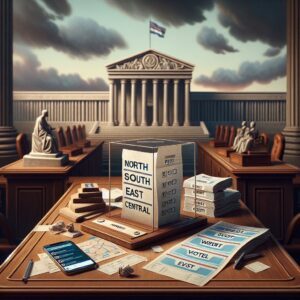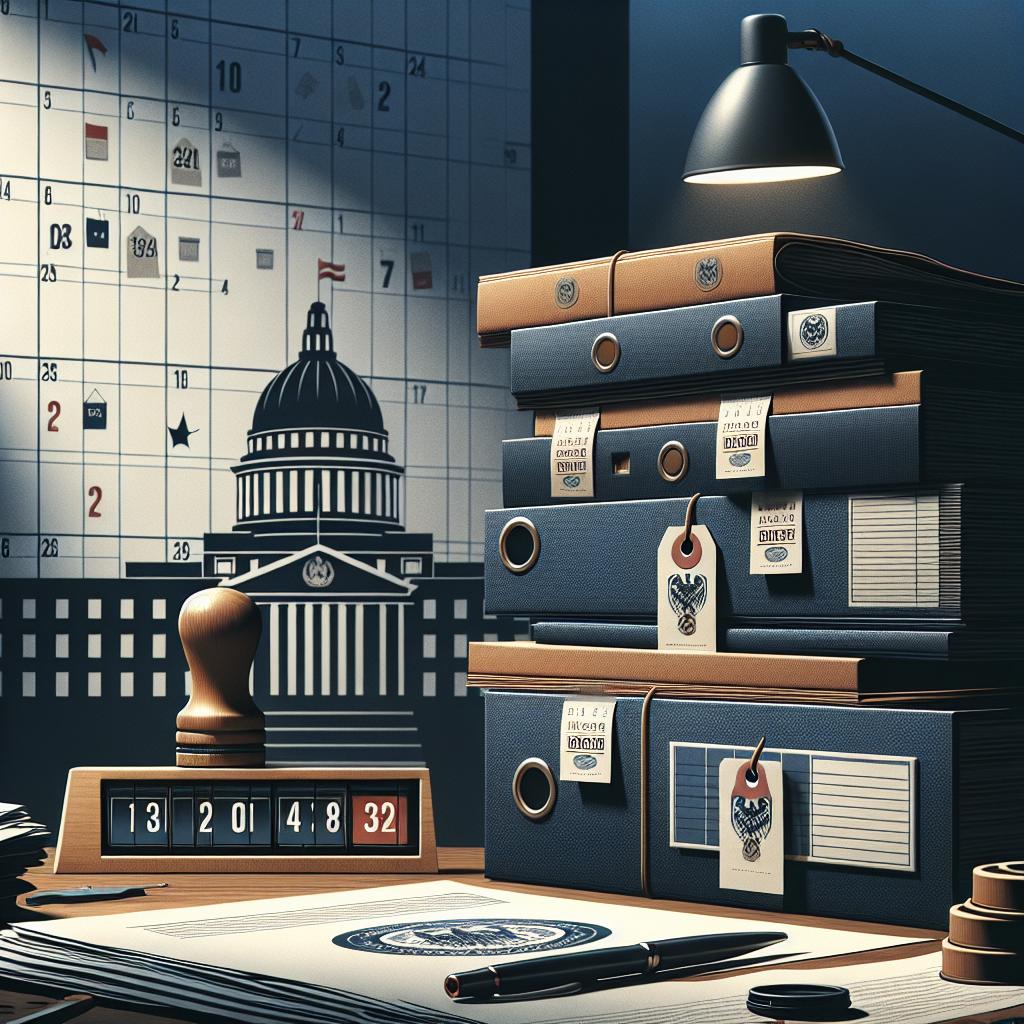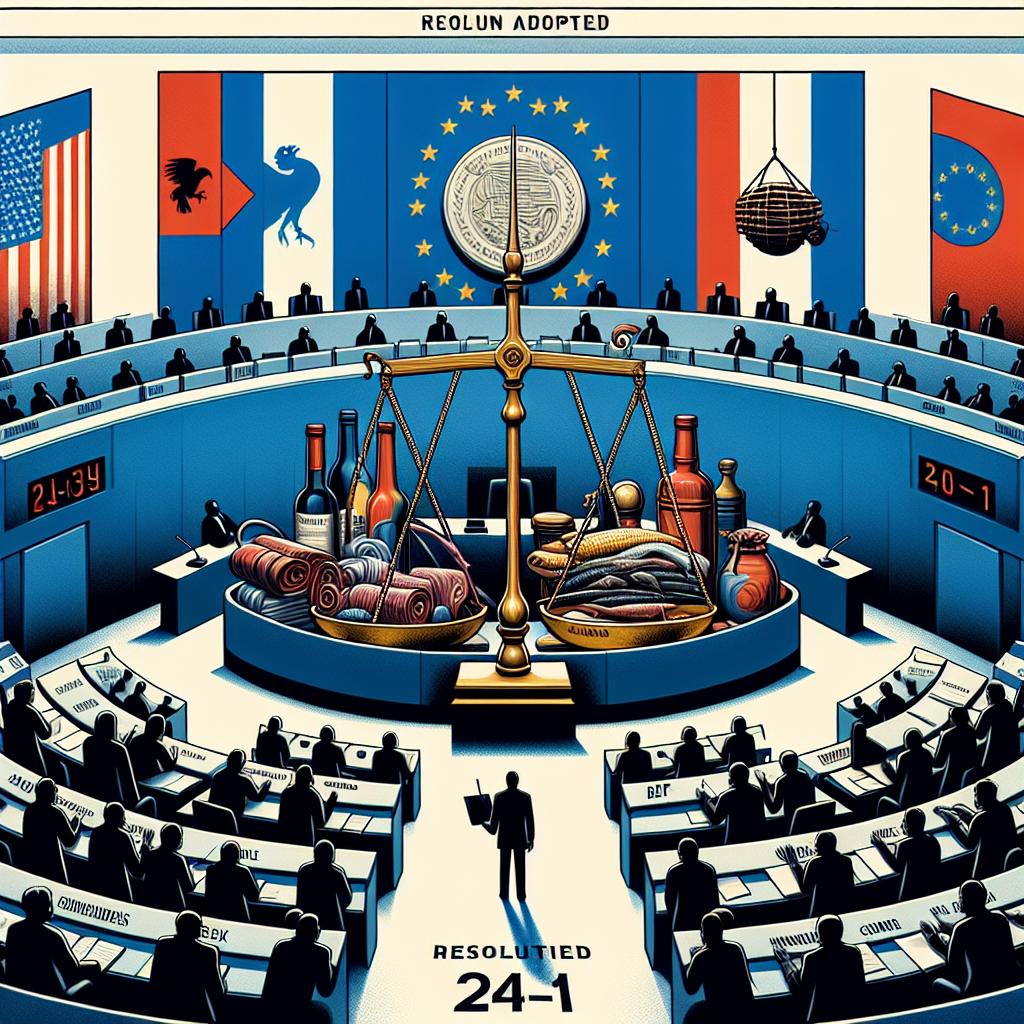Olivier Faure n’a finalement pas pris possession de l’hôtel de Matignon. Le président Emmanuel Macron a nommé, vendredi 10 octobre, Sébastien Lecornu — qui avait démissionné la semaine précédente — au poste de premier ministre.
Pour la quatrième fois depuis les législatives de juillet 2024, la gauche, et en particulier le Parti socialiste (PS), voit la fonction lui échapper alors même qu’elle a réussi ces dernières semaines à imposer certains de ses thèmes au débat public, comme la « taxe Zucman » ou la suspension de la réforme des retraites.
Déception et attentes au Parti socialiste
La déception a été nette chez les responsables et militants socialistes, nombreux à espérer un retour au pouvoir après huit années d’absence. Pour les nostalgiques d’une « époque dorée » du PS, certains étaient prêts à occuper Matignon malgré un contexte politique jugé hostile, rappelant l’adage selon lequel « un parti de gouvernement gouverne ». Ils savaient toutefois que, historiquement, l’accès à Matignon n’est pas toujours un raccourci vers l’Élysée.
Le premier secrétaire du PS avait formulé des engagements ambitieux en direction de l’exécutif : renoncer « en toutes circonstances » à l’usage de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, ainsi qu’à des mécanismes considérés comme des freins — l’article 40, qui limite l’ajout de dépenses nouvelles, ou l’article 45, qui proscrit les « cavaliers législatifs ». Ces conditions rendaient toute négociation avec l’exécutif particulièrement contraignante.
Contraintes parlementaires et calculs politiques
Sur le plan numérique, le PS se trouvaient à la peine : allié aux Écologistes et au Parti communiste, il ne totalise que 124 députés, une faible base pour gouverner sans alliances plus larges. La marge de manœuvre était donc réduite face à une Assemblée nationale fragmentée.
À gauche du PS, La France insoumise (LFI) exerce une pression constante. Jean‑Luc Mélenchon, qui multiplie les appels au respect du « vote des électeurs », reste une force capable de sanctionner toute concession jugée trop éloignée du programme du Nouveau Front populaire (NFP). Le texte d’origine souligne d’ailleurs que, pour Mélenchon — « en campagne perpétuelle » — l’agenda semble orienté vers une accélération du calendrier électoral, l’ex homme politique étant âgé de 74 ans et voyant probablement dans les prochains scrutins une ultime opportunité.
Dans ce contexte, la marge d’erreur pour le PS était étroite : accepter les conditions posées par le premier secrétaire revenait à prendre le risque d’une gouvernance ingérable, tandis qu’un refus aurait signifié rester en dehors de l’exécutif, mais préserver une identité critique vis‑à‑vis de l’exécutif.
Les précédentes tentatives de constituer une majorité stable avaient déjà montré la fragilité des équilibres parlementaires. Comment, dès lors, le parti à la rose aurait‑il fait mieux que les tentatives antérieures, conduites par Michel Barnier et François Bayrou, qui se sont heurtées à la censure parlementaire ? Cette interrogation illustre la difficulté d’installer un gouvernement durable sans majorité claire.
Dans l’immédiat, la nomination de Sébastien Lecornu marque la volonté de l’exécutif de maintenir une continuité gouvernementale malgré les remous. Pour la gauche parlementaire, la décision met en lumière l’écart entre influence sur le débat public et capacité à traduire cette influence en responsabilité gouvernementale.
La situation politique demeure donc marquée par une forte polarisation et par des jeux d’alliances incertains. Le PS sort de ces épisodes avec une visibilité accrue sur certaines thématiques, mais sans le pouvoir exécutif qu’il espérait retrouver.