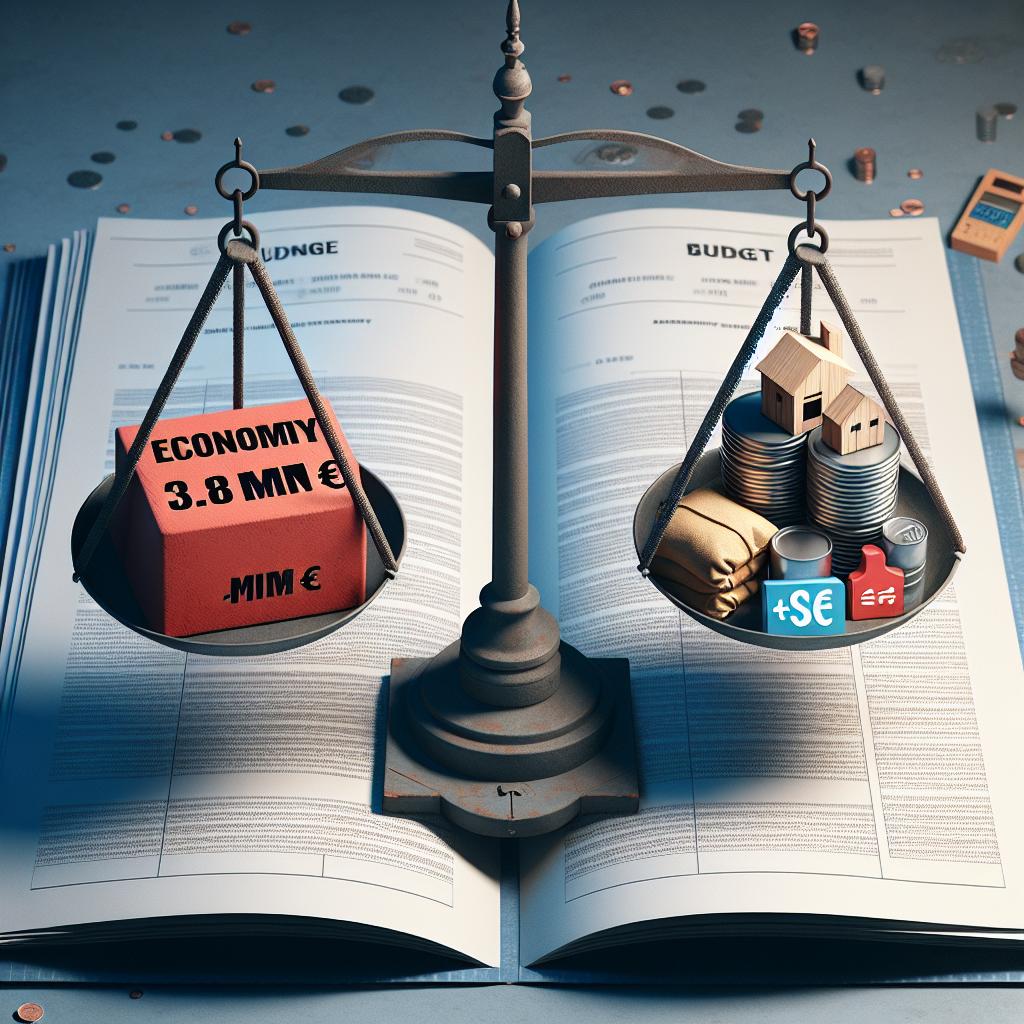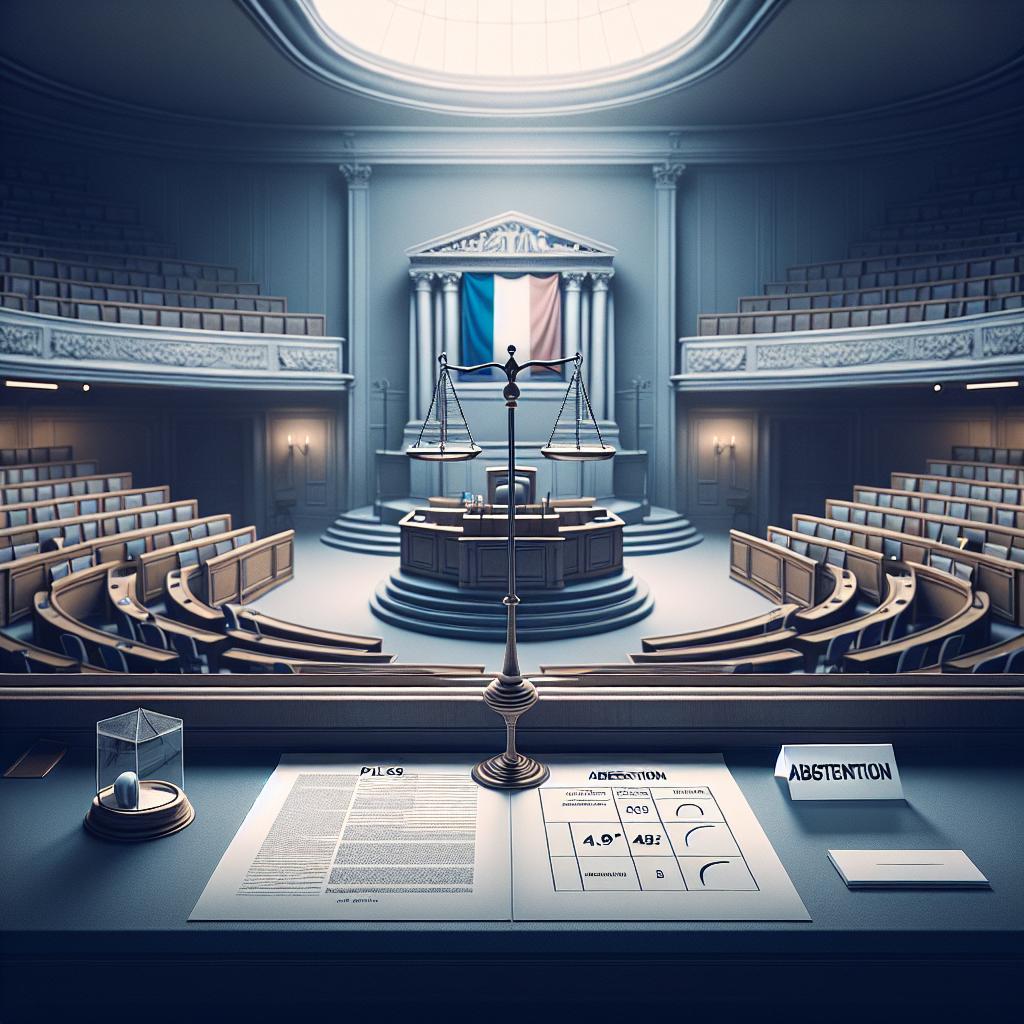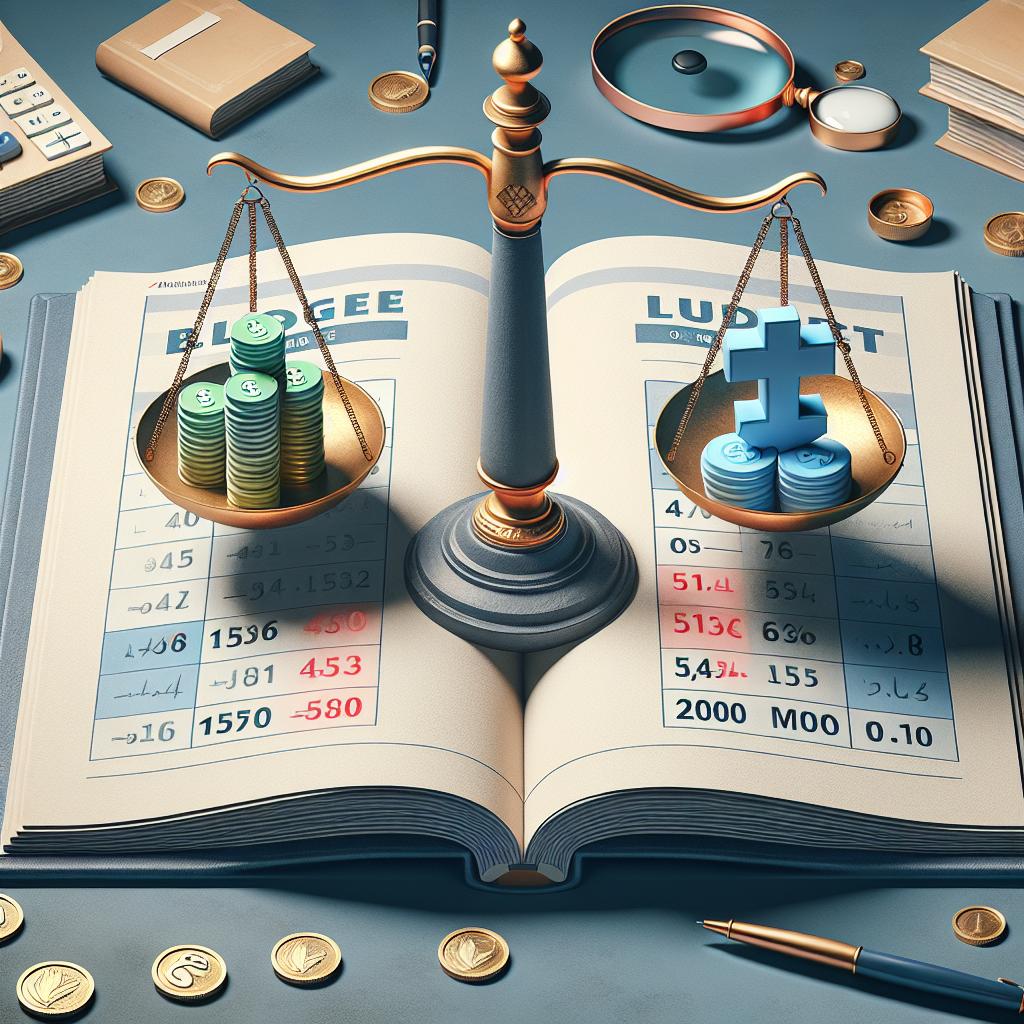Trois mois après l’annonce de l’Insee sur la hausse record de la pauvreté en 2023 — qui a porté la part de personnes vivant sous le seuil de pauvreté à 15,4 % de la population — les projets de loi de finances (PLF) et de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), rendus publics mardi 14 octobre, prévoient plusieurs mesures d’économies susceptibles d’affecter le niveau de vie des ménages modestes.
Des crédits ciblés mais limités
Les documents budgétaires prévoient des augmentations de crédits sur certains volets sociaux. Le « pacte de solidarité » voit son enveloppe majorée de 5 millions d’euros, l’aide alimentaire bénéficie de 10 millions d’euros supplémentaires et la lutte contre le sans‑abrisme reçoit 110 millions d’euros en plus. Ces hausses viennent compléter des dispositifs existants mais restent modestes au regard des besoins affichés par les associations et des chiffres de pauvreté publiés par l’Insee.
Ces allocations sectorielles ont pour objectif de soutenir des dispositifs concrets — maraudes, centres d’hébergement, aides alimentaires — mais elles ne compenseraient pas nécessairement l’impact d’autres mesures d’économies prévues par les lois de finances.
La « année blanche » : gel des prestations indexées
La mesure la plus controversée est la mise en place d’une « année blanche » : un gel, pour une année, des montants des prestations sociales qui sont habituellement indexées. Concrètement, le texte prévoit de ne pas appliquer la revalorisation automatique de plusieurs aides, ce qui permettrait, selon le gouvernement, d’éviter 3,8 milliards d’euros de dépenses.
Sont concernés par ce gel un ensemble large de prestations : le revenu de solidarité active (RSA) et la prime d’activité, les pensions de retraite, l’allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA, ex‑minimum vieillesse), l’allocation aux adultes handicapés (AAH), les aides au logement comme les APL, ainsi que les allocations familiales. Le mécanisme touche donc à la fois les revenus de remplacement et des transferts visant les ménages à faibles ressources.
Réactions et inquiétudes
Les associations de lutte contre la pauvreté ont vivement critiqué cette décision. Elles estiment que geler les revalorisations pèsera directement sur le pouvoir d’achat des plus fragiles et risque d’accroître la pauvreté monétaire et la précarité des ménages déjà affectés par l’augmentation des prix.
Pour ces organisations, les quelques dizaines ou centaines d’euros que représentent certaines revalorisations annuelles constituent une marge de manœuvre essentielle pour des familles ou des personnes isolées. Le contraste entre l’augmentation ciblée des crédits (+5 M€, +10 M€, +110 M€) et l’économie attendue de 3,8 milliards d’euros par le gel renforce leurs arguments sur l’insuffisance des mesures compensatoires.
Impact possible sur les indicateurs sociaux
Trois mois après la publication des chiffres de l’Insee sur 2023, le contexte social reste marqué par une hausse sensible de la pauvreté. Les économistes et acteurs sociaux consultés lors des débats budgétaires soulignent que, sans revalorisation, le pouvoir d’achat des bénéficiaires de prestations indexées peut se dégrader, entraînant une hausse du nombre de personnes sous le seuil de pauvreté ou un approfondissement des situations de précarité.
Le choix de geler les indexations vise à maîtriser les dépenses publiques à court terme. Toutefois, il interroge sur les effets à moyen terme : pression accrue sur les associations caritatives, recours plus fréquent aux aides d’urgence, et risques pour la santé ou l’insertion professionnelle des personnes concernées.
Un débat sur l’équilibre budgétaire et la protection sociale
Les projets de loi mettent en évidence la tension entre impératifs budgétaires et objectifs de protection sociale. D’un côté, le gouvernement présente la « année blanche » comme un instrument de maîtrise des dépenses. De l’autre, les acteurs de terrain et certaines formations politiques rappellent que la protection sociale joue un rôle stabilisateur pour les revenus et pour l’économie locale.
Le débat parlementaire à venir devra arbitrer entre ces logiques. Il portera notamment sur la durée et l’étendue du gel, sur d’éventuelles mesures ciblées pour protéger les publics les plus fragiles, et sur les modalités de financement des dispositifs d’aide à la précarité.
En l’état, les chiffres avancés dans les projets (les hausses de crédits et l’économie de 3,8 milliards d’euros) restent au cœur des discussions. Leur traduction effective dans la loi définira l’ampleur des conséquences pour les personnes concernées et la trajectoire des dépenses sociales dans les mois à venir.