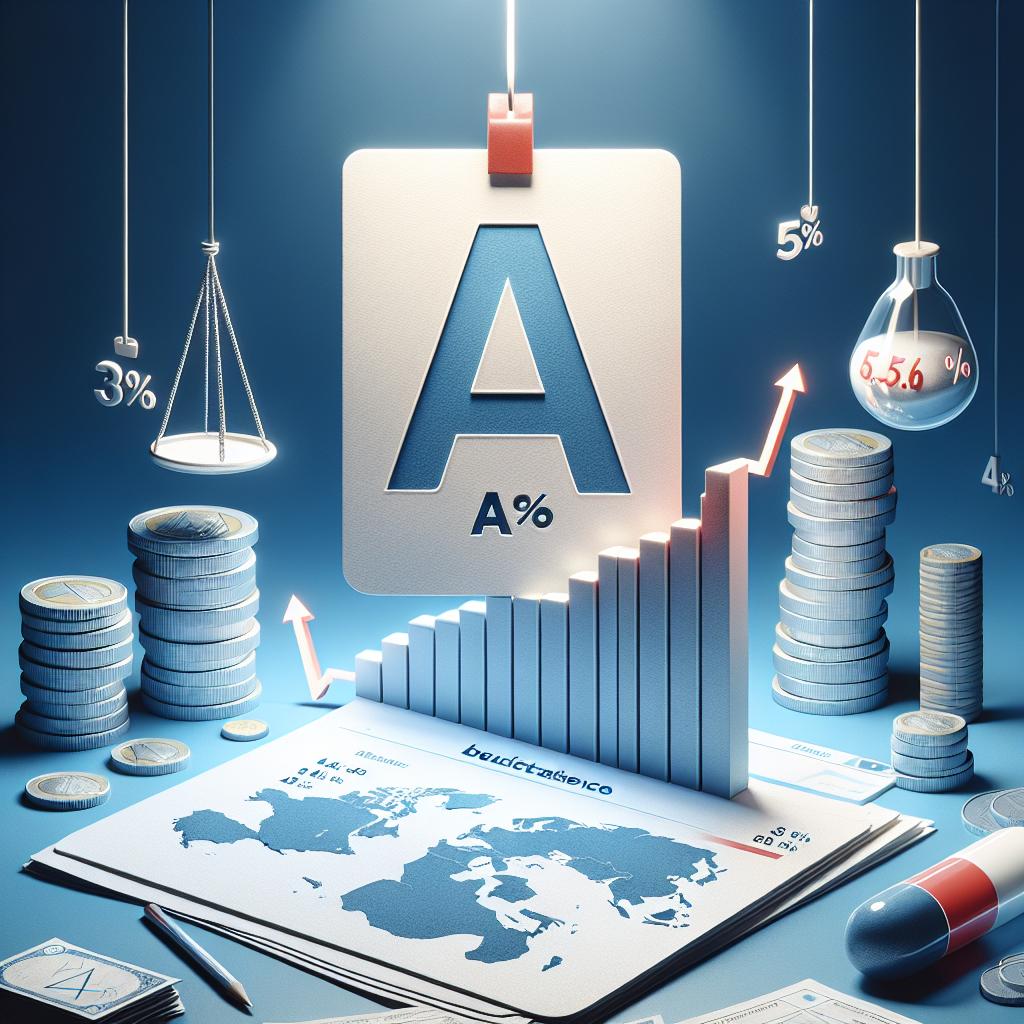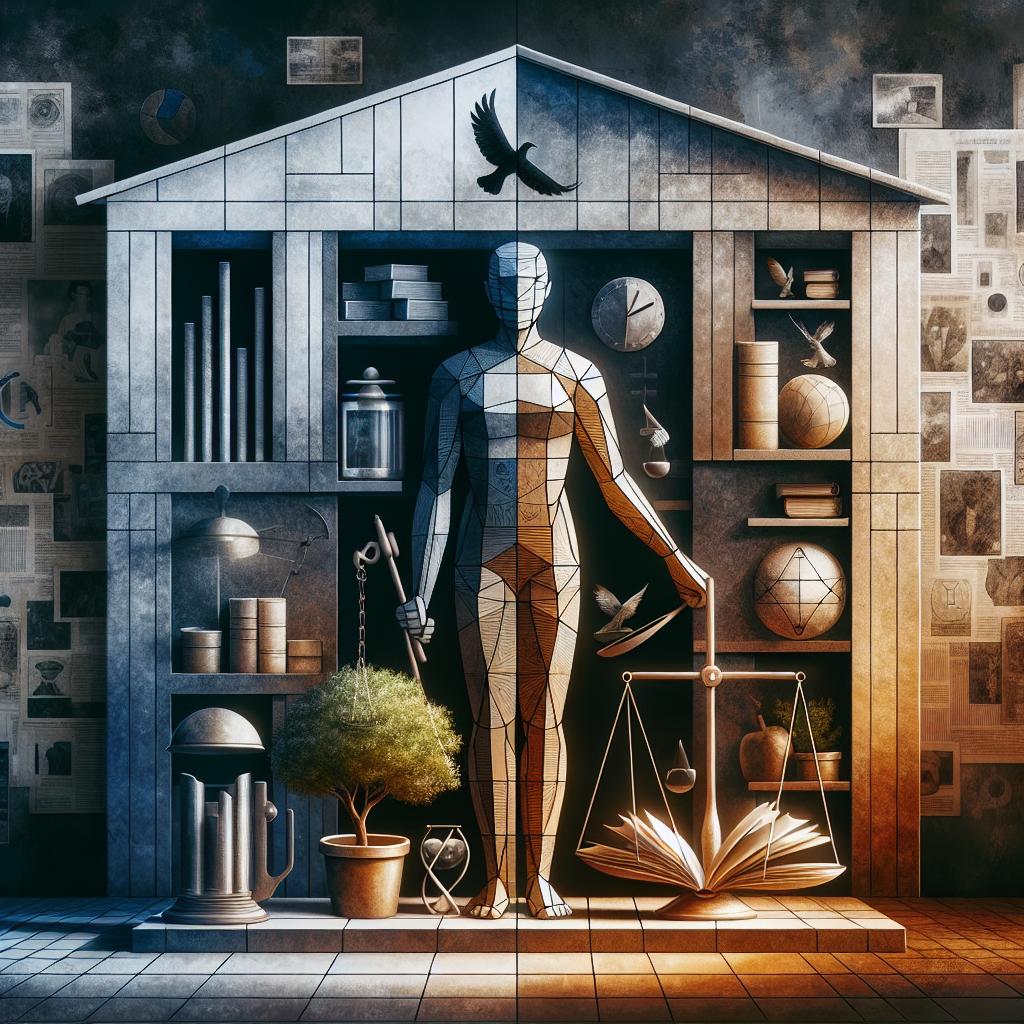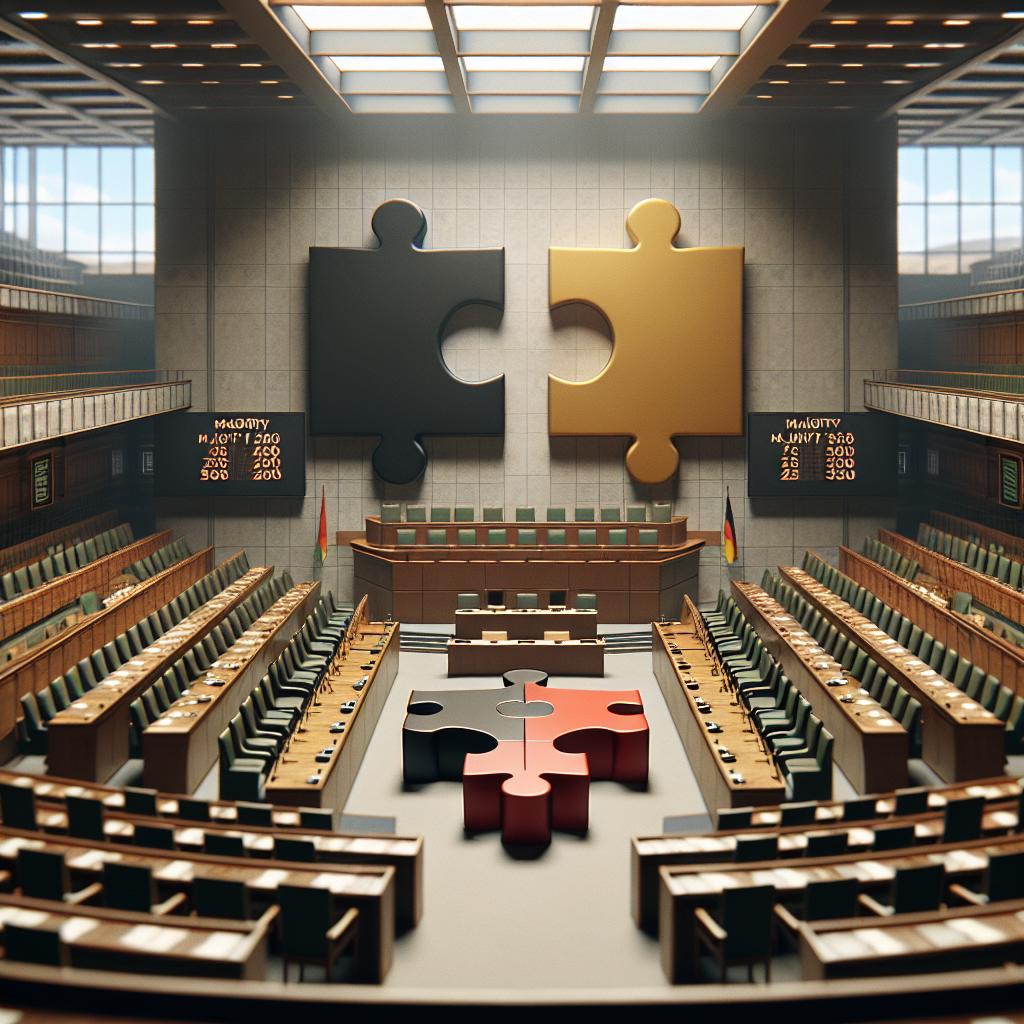En 2012, au plus fort de la crise de la zone euro, la France avait perdu son AAA sur sa dette publique, la note la plus élevée attribuée par les agences de notation. Une glissade lente s’en est suivi, d’abord dans les catégories AA puis, plus récemment, vers la catégorie A.
Les 12 et 17 octobre, respectivement, les agences Fitch et S&P (anciennement Standard & Poor’s) ont abaissé la note française à A+, plaçant la France au même niveau que l’Espagne ou le Portugal. Ces décisions sont présentées par les agences comme le reflet d’une détérioration des finances publiques plutôt que comme l’origine d’un mouvement de panique sur les marchés.
Agences : thermomètres plutôt que déclencheurs
Les agences de notation jouent un rôle d’observateur : elles évaluent la solvabilité d’un État à partir d’éléments macroéconomiques et budgétaires. Dans leurs communiqués, elles ont exprimé une perte de confiance dans la trajectoire budgétaire annoncée par le gouvernement. Le langage employé, malgré son ton mesuré, souligne un scepticisme sur la capacité des autorités à atteindre leurs objectifs de déficit.
Selon l’article d’origine, le gouvernement prévoit un déficit public de 5,4 % du produit intérieur brut (PIB) en 2025, réduit à 4,7 % en 2026. Les agences jugent cette amélioration improbable. S&P anticipe un déficit de 5,3 % du PIB en 2026, tandis que Fitch table sur une hausse du déficit à « 5,5 %–5,6 % ». Ces estimations rejoignent, d’après le texte, le consensus de certains économistes, la Société Générale évoquant notamment un chiffre autour de 5,5 %.
Une crédibilité budgétaire mise à l’épreuve
La conséquence principale, notent les observateurs cités, est une érosion de la crédibilité budgétaire de la France auprès des marchés, des investisseurs internationaux et de ses partenaires européens. La promesse formulée à Bruxelles de ramener le déficit à 3 % du PIB d’ici à 2029 est présentée dans l’article comme ayant perdu de sa valeur politique ou symbolique aux yeux des agences et des marchés.
Cette perte de crédibilité est jugée « hautement dommageable » dans le texte. L’argument n’est pas que la France risque l’effondrement immédiat, mais que la confiance, une fois entamée, pèse sur le coût du financement et sur les marges de manœuvre budgétaires à moyen terme.
Situation financière réelle : inquiétudes vs réalité
Pour l’instant, la situation n’apparaît pas catastrophique à court terme. L’article rappelle que la France continue de se financer sur les marchés : « chaque émission de dette trouve de nombreux acheteurs ». Plusieurs facteurs atténuent le risque immédiat : un niveau élevé d’épargne parmi les ménages français, la taille de l’économie — qualifiée dans le texte de « septième plus importante au monde » — et une structure économique diversifiée.
La crainte d’une intervention du Fonds monétaire international (FMI), évoquée politiquement par François Bayrou selon l’article, est qualifiée de « grossière exagération » et de procédé contre‑productif sur le plan politique. L’auteur souligne que, malgré la dégradation des notes, les fondamentaux à court terme permettent encore au pays de trouver des financements.
Enjeux politiques et budgétaires
Le cœur du problème est politique autant qu’économique : les agences expriment un doute sur la volonté ou la capacité des autorités à réduire le déficit selon le calendrier annoncé. Ce doute influe sur la perception extérieure de la discipline budgétaire française et peut peser sur les décisions d’investissement ou sur les conditions de financement à horizon moyen.
En résumé, la dégradation à A+ représente un signal important — une alerte sur la trajectoire budgétaire — sans pour autant traduire une urgence financière immédiate. L’enjeu pour les responsables publics reste de restaurer la confiance en clarifiant la trajectoire des comptes publics et en proposant des mesures crédibles et vérifiables pour réduire le déficit à moyen terme.