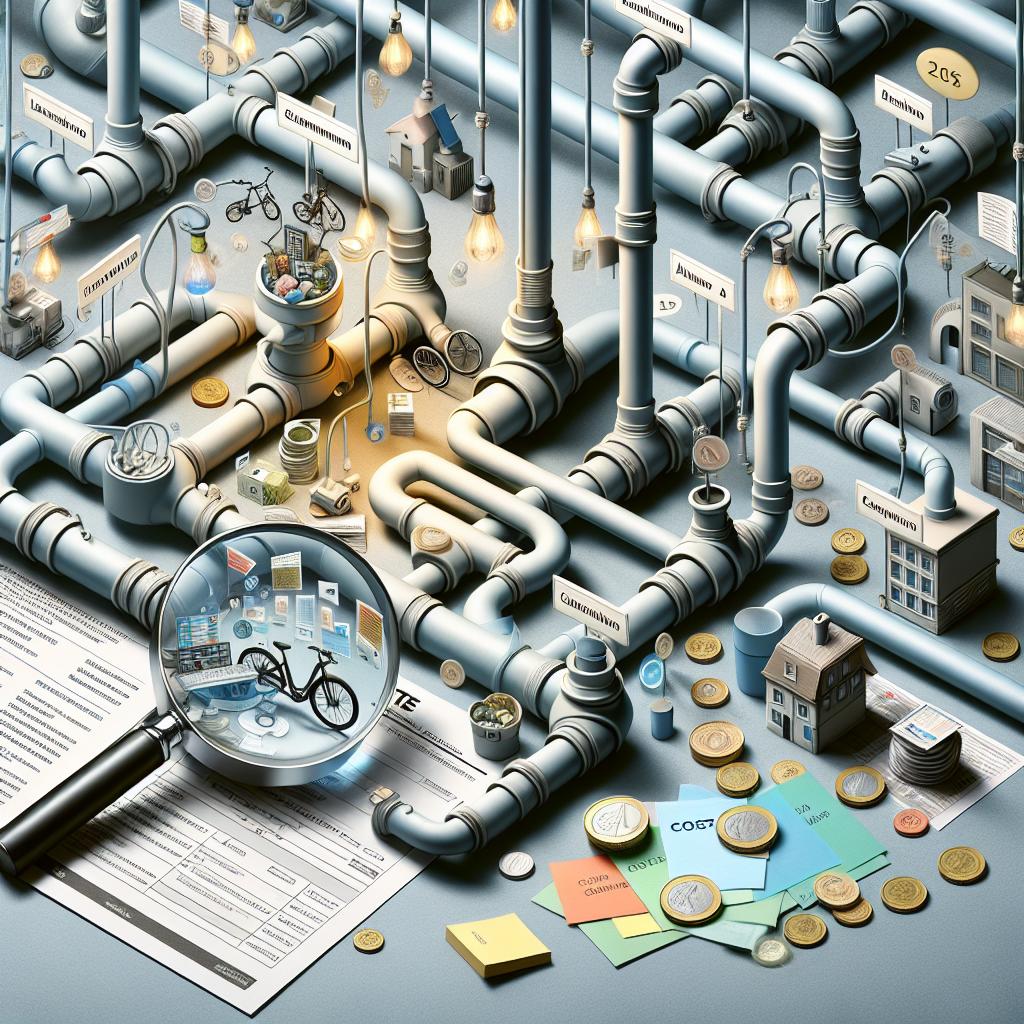Dans le débat public sur les recettes et les dépenses, l’attention se porte souvent sur la taxation des très hauts patrimoines et des entreprises. Un angle mort revient cependant trop peu : l’accumulation d’aides budgétaires et de niches fiscales qui complexifie l’architecture fiscale et pèse sur les comptes publics.
Un empilement d’aides et de dispositifs
La France combine un niveau élevé de dépenses publiques et une fiscalité marquée par de nombreux « dérogatoires » au droit commun. En 2024, les dépenses publiques représentaient 57 % du produit intérieur brut et les recettes 51 %, l’écart correspondant au déficit. Historiquement, le pays a souvent compensé des taux d’imposition élevés par des assiettes étroites et des mesures ciblées : déductions, réductions, abattements, crédits d’impôt et aides budgétaires multiplient les exceptions.
Le phénomène concerne entreprises et particuliers. Les chambres de métiers et de l’artisanat recensent plus de 2 300 dispositifs d’aide aux entreprises, y compris prêts et garanties. Pour les ménages, on compte plusieurs centaines de mesures distinctes, hors prestations sociales et hors interventions des collectivités territoriales. Parmi les dispositifs connus figurent le chèque énergie et le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile. D’autres mesures, a priori plus marginales, portent par exemple sur la réparation d’un appareil électroménager ou l’achat d’un vélo électrique.
Si l’on restreint l’analyse aux seuls dispositifs fiscaux dérogatoires, dits « niches fiscales », les évaluations varient mais convergent vers un ordre de grandeur : entre 380 et 500 dispositifs pour les particuliers et les entreprises réunis.
Coût, dispersion et opacité
Plusieurs rapports récents — issus de l’Inspection générale des finances, de la Cour des comptes et du Haut-Commissariat au Plan — estiment que le coût des dispositifs en faveur des entreprises avoisine 100 milliards d’euros, hors allègements de cotisations sociales. Les mesures qui ciblent les ménages représentent elles aussi des montants significatifs, décrits dans les mêmes rapports comme « des dizaines de milliards d’euros », même si leur total exhaustif reste difficile à établir.
Cette tuyauterie financière, comme certains observateurs la qualifient, complique la lecture des politiques publiques. La multiplicité des dispositifs fragmente le budget, rend la mesure des effets plus délicate et accroît la difficulté à piloter la dépense publique de manière lisible et efficiente.
Conséquences pour les finances publiques et la gouvernance
L’existence d’un grand nombre d’exceptions à la règle fiscale affecte plusieurs dimensions. D’abord, la transparence budgétaire : plus les dispositifs se multiplient, plus il devient ardu d’évaluer précisément leur coût et leur efficacité. Ensuite, l’équité fiscale : des traitements différenciés peuvent produire des effets redistributifs inattendus ou favoriser certains secteurs au détriment d’autres.
Enfin, la gouvernance : la multiplication des niches complexifie la gestion administrative et sollicite des ressources importantes pour l’instruction, le contrôle et l’évaluation. Elle limite aussi la marge de manœuvre des décideurs lorsqu’il s’agit d’arbitrer entre soutien ciblé et simplification de la fiscalité.
Points de vigilance
Trois caractéristiques récurrentes émergent de l’examen de ces dispositifs. Premièrement, le ciblage : certaines aides atteignent leur objectif de soutien, d’autres se révèlent mal calibrées et produisent des effets limités. Deuxièmement, la redondance : des dispositifs se chevauchent et finissent par couvrir les mêmes bénéficiaires sans gains d’efficacité clairs. Troisièmement, la complexité administrative : le coût de gestion et de contrôle n’est pas neutre et pèse sur les administrations comme sur les bénéficiaires.
Les évaluations disponibles soulignent que, au-delà des montants, c’est la structure même de ces aides qui pose question. Les chiffres cités — plus de 2 300 dispositifs pour les entreprises, entre 380 et 500 niches fiscales, un coût proche de 100 milliards d’euros pour les dispositifs entreprises — invitent à une lecture attentive plutôt qu’à des constats simplistes.
Sans conjecturer sur des réformes particulières, il apparaît que la lisibilité et l’évaluation systématique des dispositifs constituent des préalables pour tout débat budgétaire sérieux. Comprendre où se concentrent les aides, quels sont leurs effets réels et combien elles coûtent demeure essentiel pour rapprocher dépenses et recettes et mieux maîtriser le défi fiscal et budgétaire évoqué en introduction.