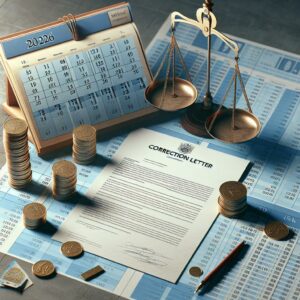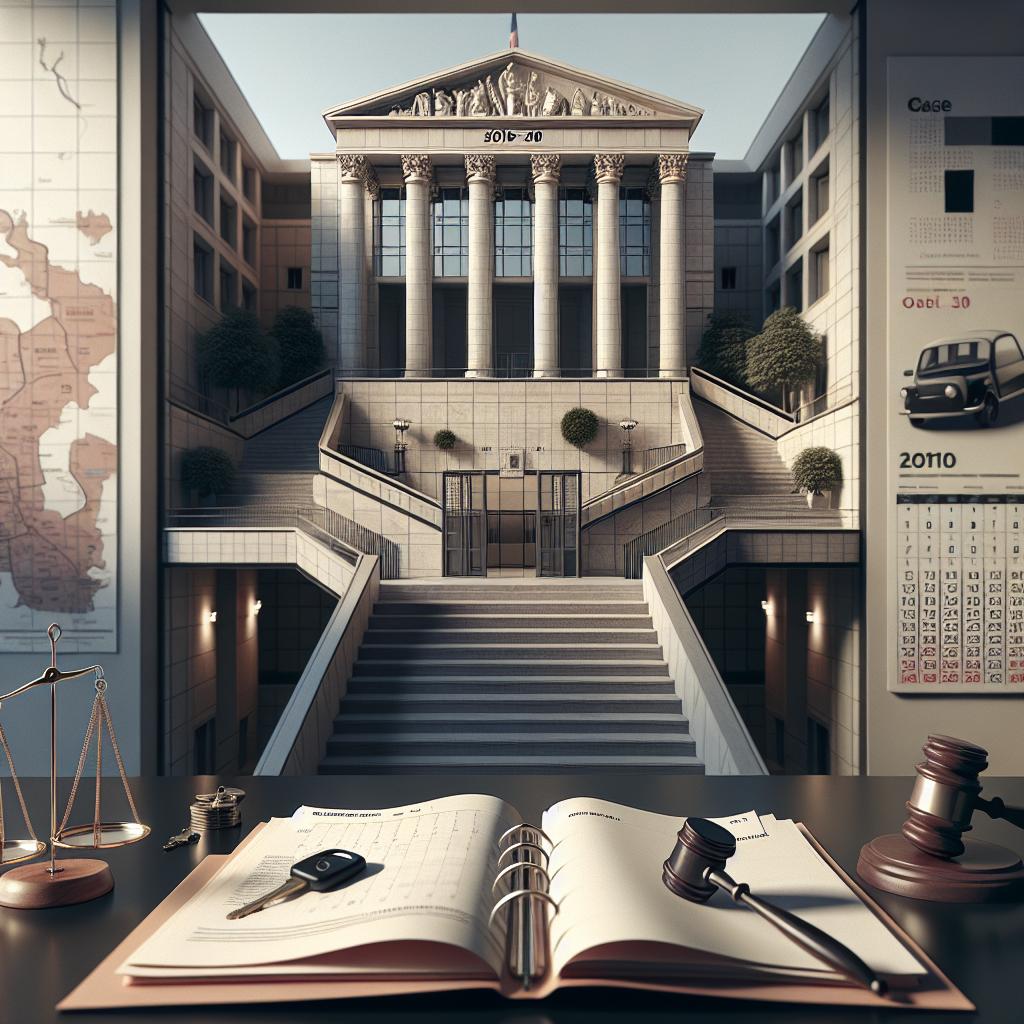Quarante ans d’un virage européen et d’une influence croissante
Longtemps perçue comme un symbole d’ouverture depuis son adhésion à la Communauté économique européenne en 1986, l’Espagne célèbre le 1er janvier 2026 les 40 ans de son entrée dans l’Union européenne. Cette trajectoire européenne a contribué à transformer le pays, qui a évolué d’une jeune démocratie fragile après la dictature de Francisco Franco (1939–1975) vers un acteur majeur doté d’une voix singulière sur la scène européenne et internationale.
Avec près de 49 millions d’habitants, l’Espagne occupe aujourd’hui le quatrième rang économique de la zone euro. Sa capacité à tirer parti du marché unique, à renforcer ses alliances diplomatiques et à défendre des priorités stratégiques lui permet d’exercer une influence croissante au sein des institutions européennes.
Une gouvernance de coalition fragile et contraignante
La vie politique intérieure reste cependant marquée par des équilibres fragiles. Le gouvernement dirigé par Pedro Sánchez, secrétaire général du PSOE, a été constitué après les élections anticipées de juillet 2023. Il repose sur une coalition rassemblant le PSOE et Sumar, parti de la gauche alternative, et doit composer avec le soutien critique de partis régionaux nationalistes et indépendantistes, notamment catalans et basques.
L’exécutif compte 22 ministres, dont quatre vice‑présidentes positionnées dans l’ordre protocolaire gouvernemental, et dispose de 152 députés sur 350 au Congrès, soit 43,4 % des sièges. Cette configuration oblige à d’intenses négociations parlementaires et limite la marge de manœuvre du gouvernement sur les grandes réformes.
Les principaux engagements de la coalition incluent la réduction du temps de travail, l’accélération de la transition écologique et une fermeté affichée contre les dérives autoritaires, tout en tentant de préserver des équilibres entre intérêts nationaux et impératifs européens. Cette architecture politique explique en partie la prudence de Madrid sur les questions de réarmement et certaines prises de position parfois critiques en matière de diplomatie vis‑à‑vis de l’Union européenne et de grands partenaires.
Défense, budget et posture internationale
À l’approche du sommet de l’OTAN à La Haye, les 24 et 25 juin 2025, l’Espagne a provoqué des remous en rejetant publiquement la hausse automatique de la cible de dépenses de défense de l’alliance de 2 % à 5 % du PIB, telle que demandée par le président américain. Le gouvernement de Pedro Sánchez a justifié sa position par la volonté de préserver la souveraineté budgétaire et l’autonomie stratégique du pays.
Cette décision a mis en lumière la fragilité financière de Madrid en matière de défense : le budget de la défense reste limité à 1,28 % du PIB. Si l’Espagne n’a pas obtenu la dérogation souhaitée, sa posture a été saluée par certains observateurs et vivement critiquée par d’autres, révélant les tensions internes à la coalition soucieuse de protéger les investissements sociaux.
Migrations et régularisations : un défi public et géographique
Face à une forte pression migratoire — 57 700 arrivées enregistrées en 2024, principalement via l’archipel des Canaries — le gouvernement doit répondre au discours de la droite et de l’extrême droite qui dénoncent une prétendue « invasion », tout en tenant compte du rôle de la main‑d’œuvre immigrée dans l’économie.
Près de 19 % de la population résidant en Espagne est d’origine étrangère, avec des profils variés venant d’Amérique latine, du Maroc et d’Europe de l’Est. Madrid a adopté un règlement entré en vigueur le 20 mai 2025 pour régulariser 900 000 étrangers sur trois ans ; le délai pour obtenir un titre de séjour a été réduit et élargi à cinq formes d’« enracinement » : social, éducatif, professionnel, familial et une mesure dite de seconde chance.
Une économie robuste mais vigilante
Malgré un contexte international instable, l’économie espagnole affiche une vitalité notable. Selon la Banque d’Espagne et l’Institut national de statistique, la croissance du PIB a atteint 3,5 % en 2024 et devrait être de 2,7 % en 2025, un rythme supérieur à la moyenne de la zone euro.
Cette performance s’appuie sur la consommation intérieure, les investissements et un secteur exportateur dynamique, faiblement exposé aux turbulences transatlantiques. L’Espagne bénéficie d’un excédent courant pour la treizième année consécutive et d’une réduction progressive de la dette publique, qui reste toutefois élevée (101,8 % du PIB).
Les secteurs oléicole et viticole exigent une attention particulière, tandis que la relation avec Bruxelles conserve des points de friction. Récemment, la Commission européenne a réduit de 1,1 milliard d’euros un versement attendu dans le cadre du plan NextGenerationEU, en jugeant insuffisantes certaines réformes (statut des intérimaires, fiscalité écologique, numérisation des administrations locales). Madrid dispose de six mois pour se conformer et récupérer ces financements.
Diplomatie active et repositionnement stratégique
Sur la scène internationale, l’Espagne veut affirmer un rôle au‑delà de l’arène européenne. Lors d’une visite à Pékin, Pedro Sánchez a présenté la Chine comme « un partenaire de l’UE », alors que Bruxelles la qualifie de « rival systémique ». Madrid participe aussi aux débats sur la gouvernance européenne et appelle l’Union à « faire preuve de courage » sur les grands dossiers géopolitiques.
En 2025, l’Espagne s’est distinguée par des positions critiques à l’égard d’Israël, en conditionnant son engagement aux circonstances humanitaires à Gaza et en pressant l’UE de réexaminer certains accords. Parallèlement, Madrid pousse au renforcement des relations transatlantiques et sud‑américaines, et milite pour un positionnement européen plus autonome et équilibré.
En définitive, qu’il s’agisse de sécurité, d’économie ou de diplomatie, l’Espagne affiche une volonté d’affirmer son rôle européen tout en défendant ses priorités nationales, au prix d’équilibres politiques intérieurs délicats.