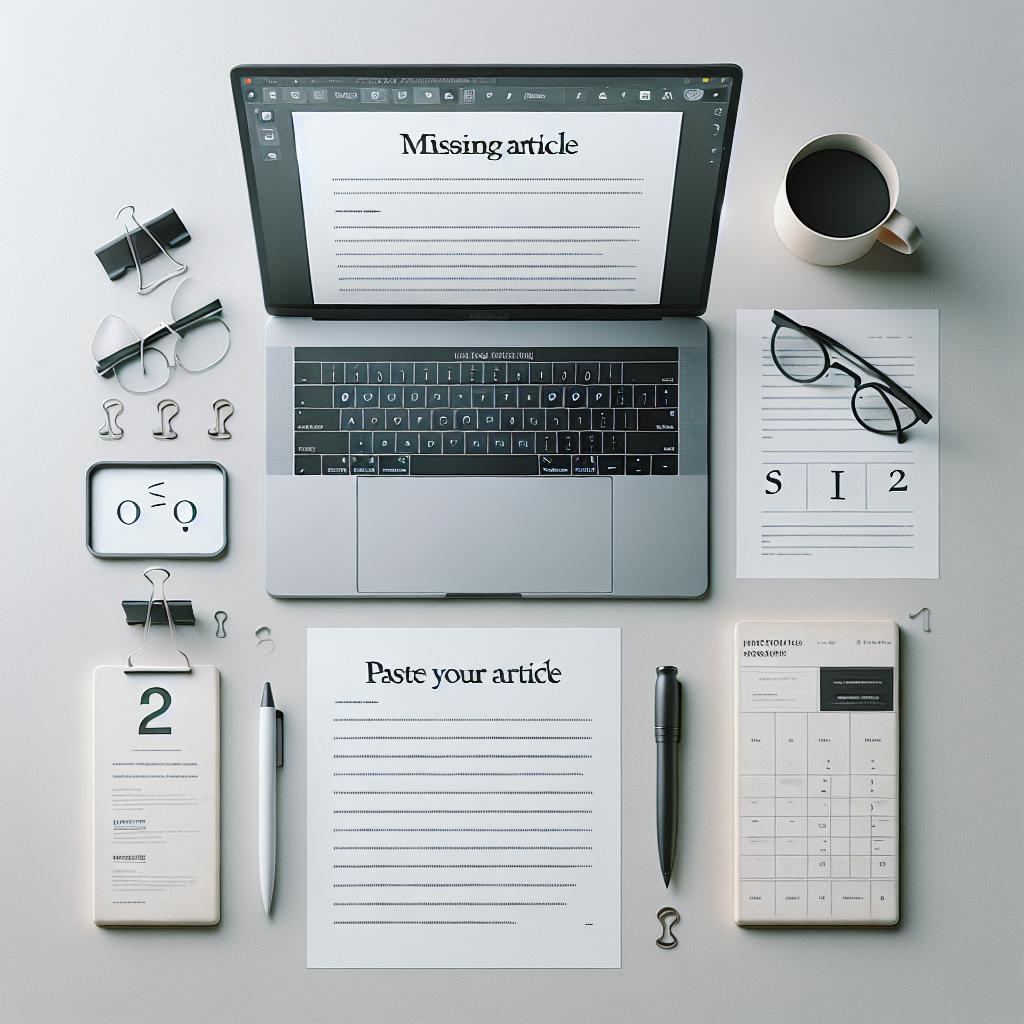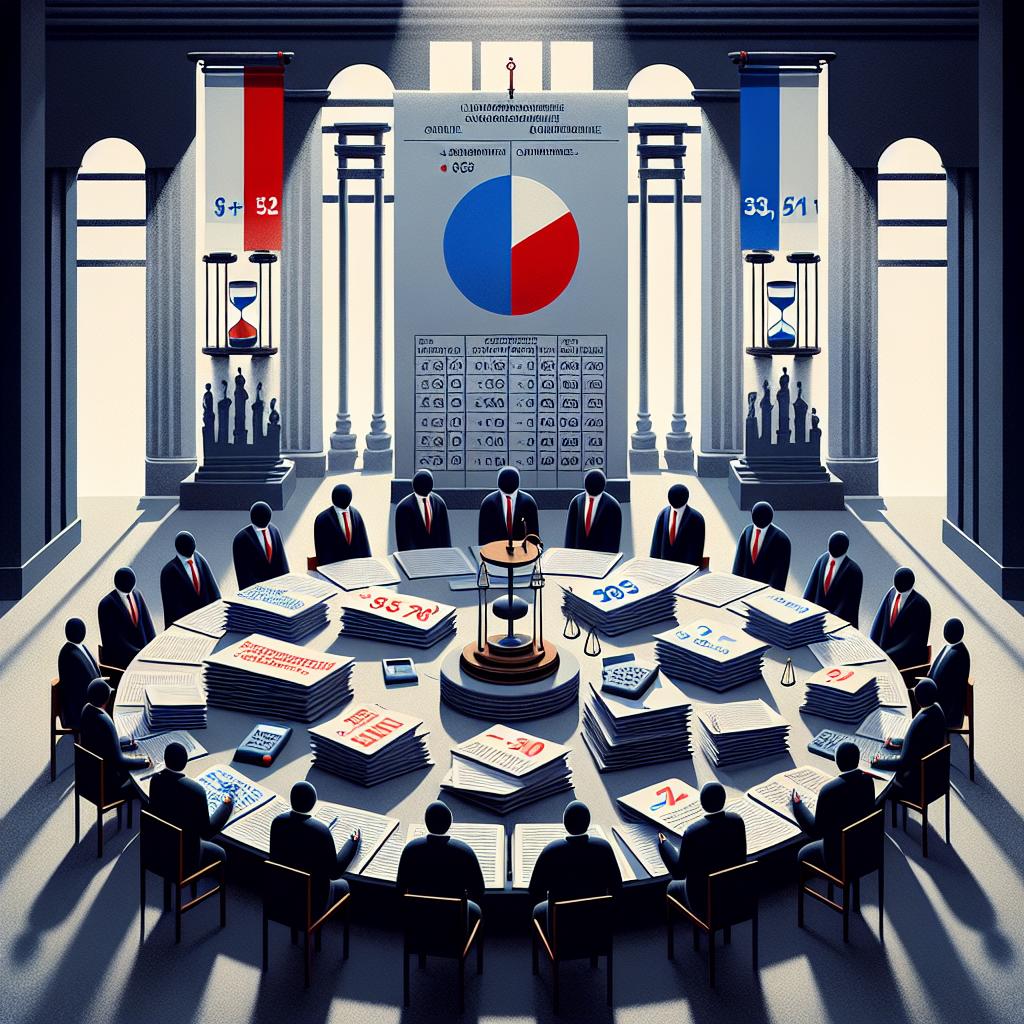Principe et ambition de la taxe Zucman
La « taxe Zucman » propose d’instaurer un impôt plancher visant les foyers disposant d’un patrimoine supérieur à 100 millions d’euros. Son principe est simple : garantir que ces très grandes fortunes contribuent chaque année au moins à hauteur de 2 % de leur patrimoine. Concrètement, un ménage qui paierait aujourd’hui 0,5 % de son patrimoine en impôts verrait s’ajouter une taxe de 1,5 % pour atteindre ce seuil.
L’objectif affirmé des promoteurs est double : rétablir ce qu’ils présentent comme davantage de justice fiscale et générer une nouvelle source de recettes dans un contexte budgétaire contraint. L’économiste Gabriel Zucman, à l’origine de la proposition, s’appuie sur des travaux montrant selon lui une baisse de l’imposition effective des très hauts patrimoines.
Les constats empiriques invoqués
Des chercheurs de l’IPP relèvent qu’au-delà du 0,1 % des ménages les plus riches, le taux effectif d’imposition recule. Ils estiment que si les 0,1 % les plus aisés paient en moyenne 46 % de leurs revenus, les 0,0002 % — les milliardaires — ne reverseraient que 26,2 %. Cette régressivité s’expliquerait en partie par le recours des très hauts patrimoines aux holdings et à des montages financiers échappant à l’impôt sur le revenu.
Les mêmes auteurs notent que leurs données initiales portaient sur 2016, mais qu’une révision de leurs calculs, publiée en septembre 2025, montre une nouvelle baisse d’environ un point du taux effectif d’imposition des milliardaires. Gabriel Zucman en déduit qu’un taux plancher à 2 % rétablirait une progressivité comparable à celle subie par les catégories sociales situées sous les ultrariches, « les milliardaires paieraient autant – mais pas plus – que les catégories sociales situées en dessous d’eux », a-t-il déclaré au Monde.
Différences avec l’ISF et l’IFI
La taxe Zucman se rattache à l’idée d’une imposition du patrimoine, mais elle diffère pour l’essentiel de l’ancien impôt sur la fortune (ISF) et de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). L’ISF prenait en compte l’immobilier, les liquidités et les placements financiers. Remplacé en 2018 par l’IFI, il a vu son assiette limitée à l’immobilier.
La taxe Zucman, elle, viserait l’ensemble du patrimoine, y compris les biens professionnels (par exemple les actions d’entreprise). Son taux proposé est unique : 2 %, sans mécanisme de plafonnement, et son seuil d’entrée est très élevé, fixé à 100 millions d’euros — bien au‑delà du seuil de l’IFI (1,3 million d’euros).
Le périmètre choisi limiterait l’assiette à quelques centaines, voire quelques milliers de foyers : Gabriel Zucman évoque environ 1 800 foyers concernés, contre près de 186 000 ménages soumis à l’IFI en 2024 et environ 358 000 ménages qui avaient été assujettis à l’ISF en 2017.
Rendement attendu et incertitudes
Estimer les recettes potentielles reste l’objet de fortes divergences. Certains partisans avancent un rendement annuel compris entre 20 et 25 milliards d’euros. D’autres économistes, sept d’entre eux signant une tribune dans Le Monde, anticipent plutôt un ordre de grandeur de 5 milliards, en invoquant les risques d’optimisation et d’exil fiscal.
Un rapport du Conseil d’analyse économique (CAE) cité dans le débat avance une hypothèse prudente : « 0,25 euro par euro espéré » de rendement, formule qui traduit des pertes liées aux comportements d’évitement. Le CAE estime aussi qu’un point supplémentaire d’imposition pourrait entraîner une expatriation à long terme comprise entre 0,02 % et 0,23 % des hauts patrimoines français, soit entre environ 90 et 900 foyers.
La commission des finances du Sénat note que l’impact d’un départ serait particulièrement sensible dans le cas d’un impôt ciblant si peu de foyers : « aucune autre imposition de ce genre n’existant aujourd’hui, il est possible que les personnes les plus aisées s’exilent pour éviter l’impôt », relève-t‑elle. Les défenseurs de la taxe proposent en réponse des mécanismes de « bouclier anti-exil » soumettant les partants potentiels à l’impôt jusqu’à cinq ans après leur départ.
Enjeux juridiques et calendrier politique
Sur le plan juridique, les opposants qualifient la mesure de « confiscatoire », une critique portée notamment par l’ancien Premier ministre François Bayrou, qui invoque la jurisprudence. Les partisans répliquent qu’un taux limité à 2 % et un seuil de 100 millions d’euros ne sauraient constituer une confiscation et que la proposition respecte, selon eux, l’exigence d’égalité devant l’impôt telle que formulée dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
La mesure a déjà franchi des étapes parlementaires : une proposition de loi portée par des écologistes a été adoptée par l’Assemblée nationale le 20 février 2025, puis rejetée par le Sénat le 12 juin 2025. L’Assemblée débat à nouveau de la taxe dans le cadre des discussions budgétaires ce vendredi 31 octobre 2025. Le sort définitif de la taxe dépendra aussi d’un éventuel examen par le Conseil constitutionnel si elle était inscrite dans le projet de loi de finances.