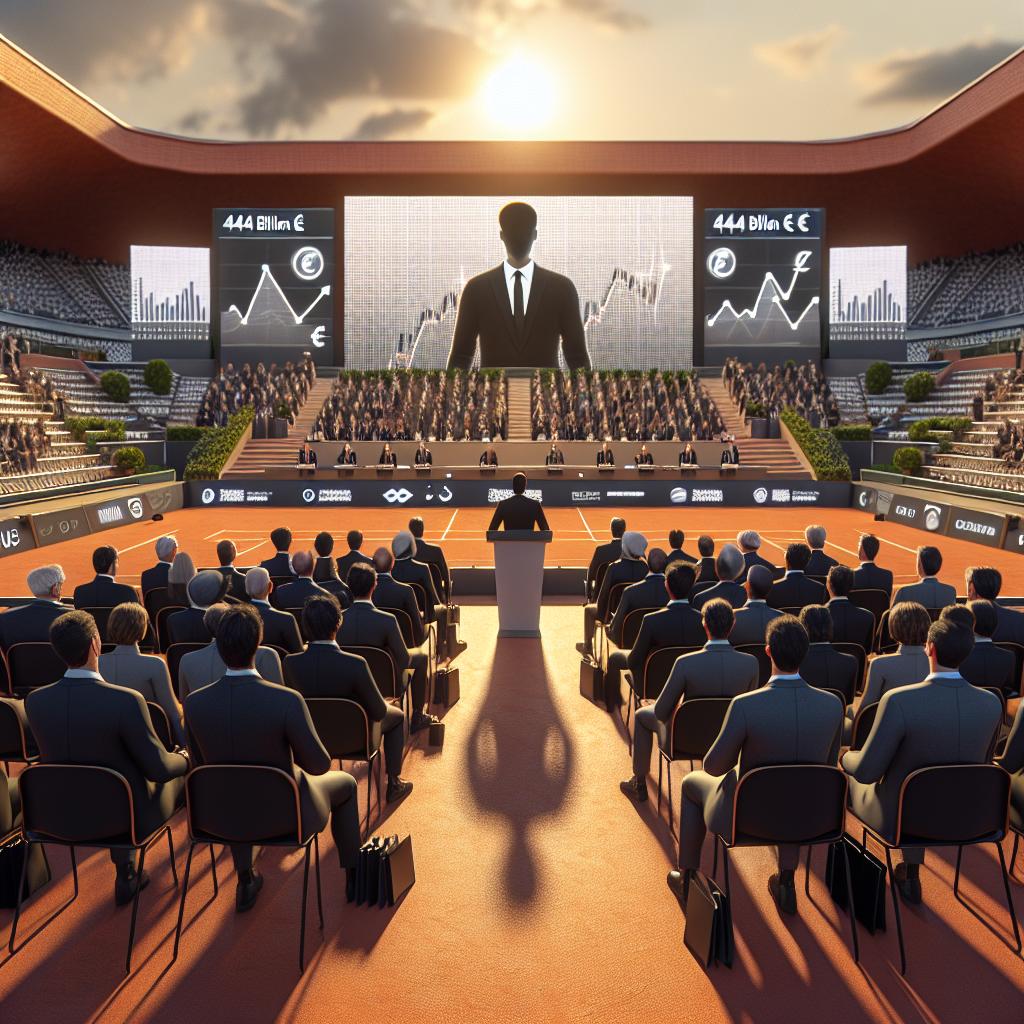Rejet à l’Assemblée nationale : le sort de la « taxe Zucman »
Au terme d’une journée particulièrement scrutée à l’Assemblée nationale, la proposition de taxe dite « Zucman » sur le patrimoine, mesure centrale du projet de loi de finances 2026, a été rejetée par les députés ce vendredi 31 octobre.
Le scrutin s’est soldé par 172 voix pour et 228 contre. Soutenue vigoureusement par la gauche, présentée comme un « minimum » fiscal, la mesure — initialement portée pour un taux de 2 % sur les personnes possédant au moins 100 millions d’euros de patrimoine (environ 1 800 personnes en France) — n’a pas recueilli l’adhésion de la majorité de l’hémicycle, le bloc central la qualifiant de « mirage ».
Contenu et variantes de la proposition
Conçue comme un impôt plancher ou minimum, la taxe visait à garantir qu’un contribuable très fortuné verse au moins un pourcentage minimum d’impôt sur l’ensemble de son patrimoine. Concrètement, si un contribuable payait déjà des impôts (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, prélèvements sociaux, etc.) représentant moins de 2 % de son patrimoine, il devait verser la différence pour atteindre ce seuil.
Face aux réticences du gouvernement et de la droite, le Parti socialiste avait envisagé une version remaniée de la taxe destinée à faciliter les négociations. Cette variante, qualifiée par certains de « taxe Zucman light », proposait un taux de 3 % pour les patrimoines supérieurs à 10 millions d’euros, tout en excluant les entreprises innovantes et familiales. Selon les éléments défendus par ses promoteurs, ce mécanisme pourrait mobiliser près de 20 milliards d’euros chaque année.
Arguments et portée budgétaire
Les partisans de la mesure, dont l’économiste Gabriel Zucman, ont expliqué que la taxe visait à corriger une inégalité fiscale souvent observée : les ultra-riches paieraient, de façon proportionnelle, moins d’impôts que le reste de la population en raison de mécanismes d’optimisation fiscale. Interrogé sur le rejet de la taxe qu’il avait conçue et défendue ces dernières semaines, Gabriel Zucman a annoncé qu’il gardait espoir que cette taxe « finisse par voir le jour ».
Du point de vue budgétaire, la portée annoncée de la taxe — près de 20 milliards d’euros annuels — a nourri les débats. Dans la copie proposée par le gouvernement, le déficit serait réduit à 4,7 % du PIB contre 4,6 % suite au retrait de la suppression de deux jours fériés, comme l’a indiqué Sébastien Lecornu lors de son discours de politique générale.
Le Premier ministre a toutefois laissé une marge de manœuvre pour la négociation parlementaire, précisant que, « dans tous les cas de figure, à la fin de la discussion budgétaire, ce déficit devra être à moins de 5 % du PIB ».
Contexte parlementaire et contraintes européennes
Les députés ont entamé, le 24 octobre 2025, l’examen du projet de budget 2026. Dans un hémicycle sans majorité, les discussions sont vives autour de plusieurs mesures envisagées : le gel de l’impôt sur le revenu, la suppression d’un abattement fiscal pour les retraités ou encore la taxe Zucman, qui ont toutes été repoussées par les députés.
Le rejet interroge la stratégie de la gauche et pose la question de la capacité du gouvernement à faire adopter un budget en dépit des divisions. Le Premier ministre et son gouvernement ont déjà fait l’objet de deux motions de censure, rejetées le 16 octobre dernier. Malgré ces tensions et les retards accumulés, le Parlement conserve la possibilité d’adopter un budget d’ici au 31 décembre.
Sur le plan européen, l’Union impose aux États membres le respect de deux critères rétablis dans les années 1990 : ne pas dépasser 3 % du PIB pour le déficit public et 60 % du PIB pour la dette publique. Inscrites dans le Pacte de stabilité et de croissance, ces règles ont été révisées en avril 2024. Les marges de manœuvre budgétaires seront donc scrutées, d’autant que la France annonce l’objectif de ne pas dépasser 3 % du PIB avant 2029, une trajectoire évoquée par des responsables gouvernementaux et reprise dans les discussions budgétaires.
En savoir plus sur l’économie dans l’UE 💶