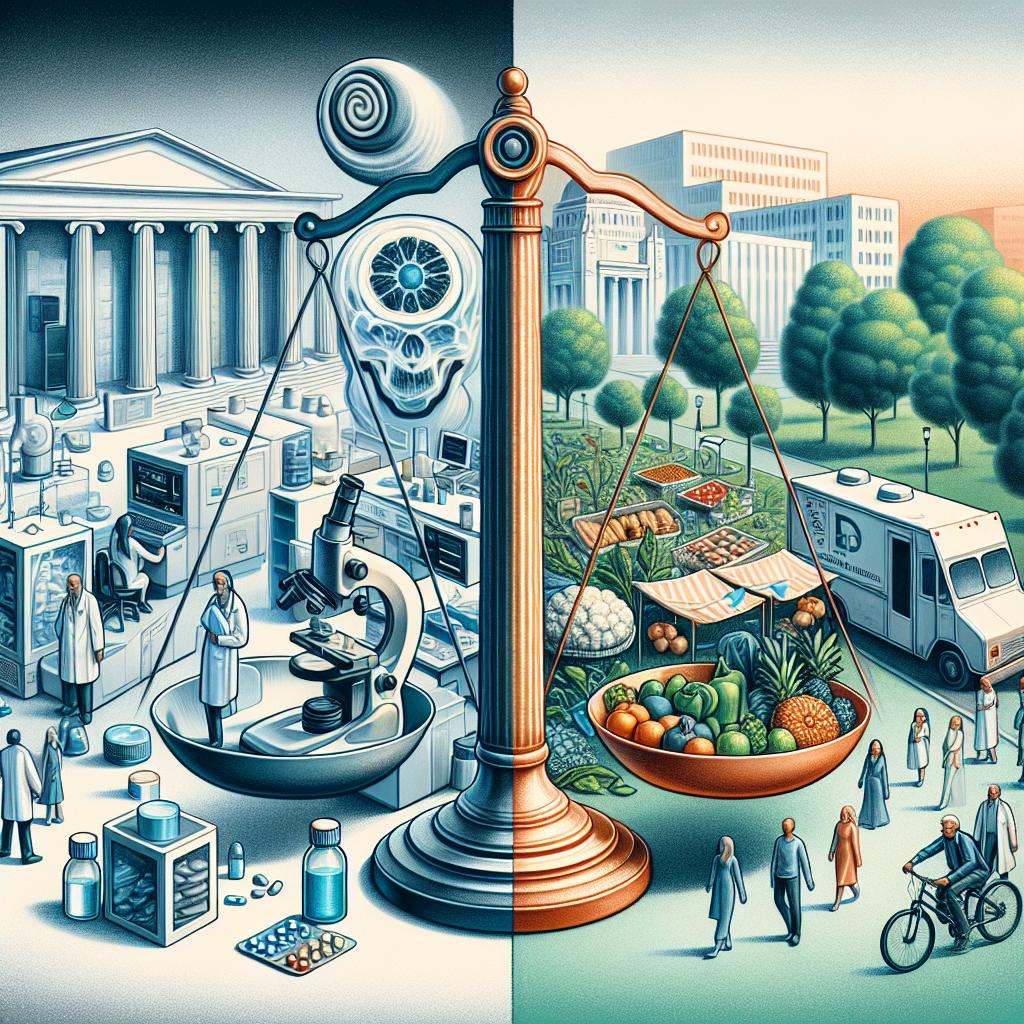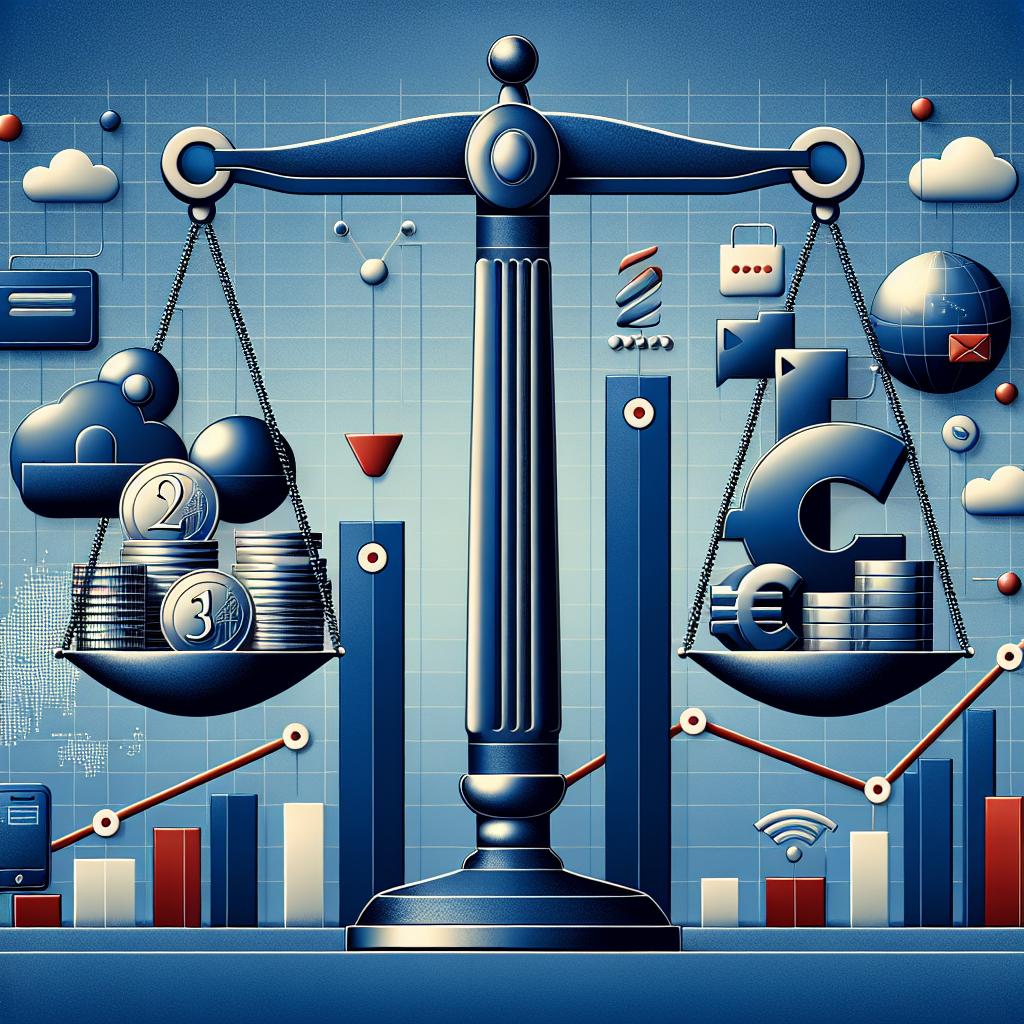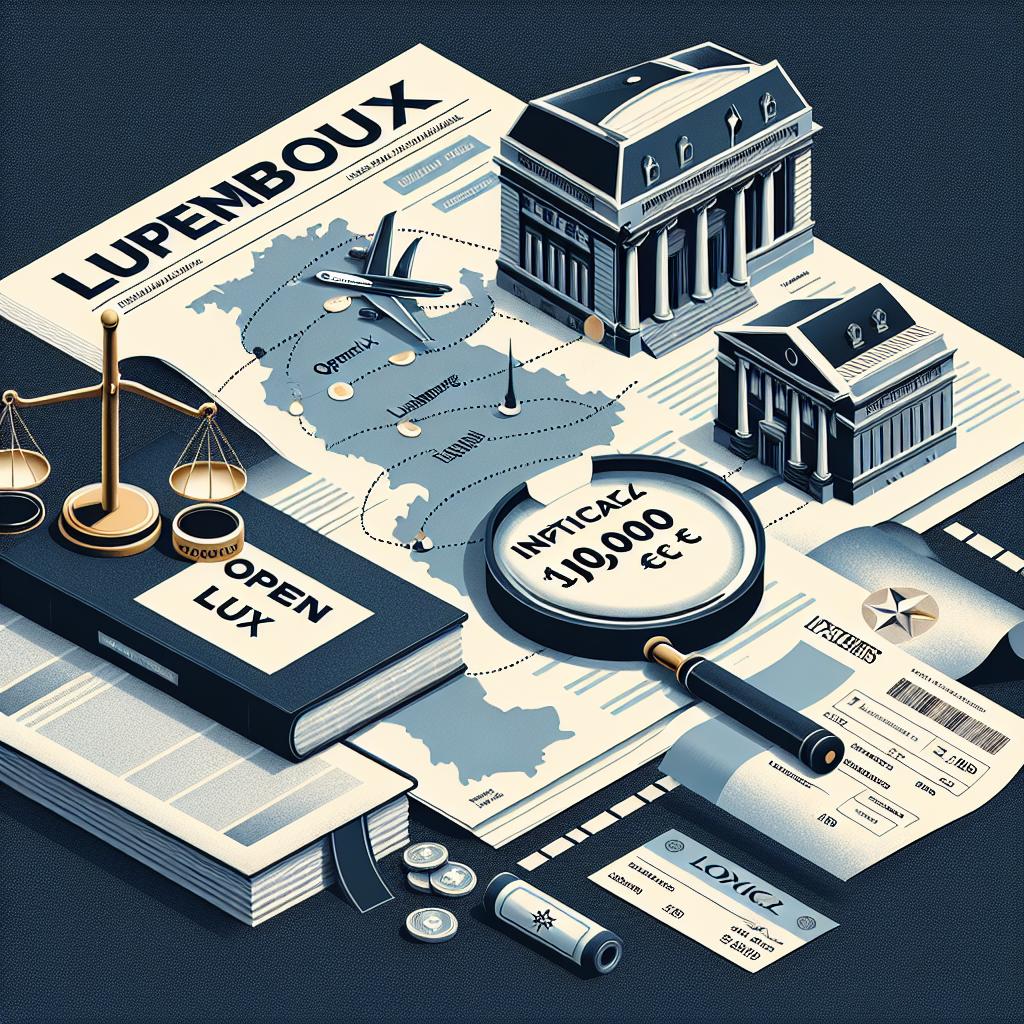Le succès électoral et la montée dans les sondages renforcent les attentes de cohérence et de sérieux pour tout mouvement susceptible d’accéder au pouvoir. Dans l’hémicycle, l’examen du projet de loi de finances met en lumière les fragilités du Rassemblement national (RN) : ses propositions fiscales et ses votes sont scrutés et contestés par l’ensemble des oppositions.
Un « contre‑budget » sous haute surveillance
En présentant un « contre‑budget » détaillé — un exercice que la droite républicaine ne parvient plus à produire selon le parti — le RN a cherché à donner des gages de sérieux et de transparence. Ce choix l’expose toutefois à des critiques accentuées : la gauche l’accuse de complicité avec une « oligarchie » ; une partie du « socle commun » et d’autres forces de droite s’inquiètent de son appétence pour de nouveaux impôts ; enfin, le prix Nobel d’économie Philippe Aghion qualifie ses dirigeants de « grands amateurs (…) pas capables de gérer la France ».
Les attaques viennent donc de plusieurs horizons et mettent en lumière des contradictions. D’un côté, l’extrême droite n’a pas totalement renoncé à des mesures visant à sanctionner certains excès du capitalisme financier. De l’autre, son document budgétaire comporte davantage de baisses d’impôts que de hausses, ce qui nourrit les interrogations sur la cohérence de son projet économique.
Tensions internes et ambitions électorales
Le RN se présente comme un parti visant à élargir sa base : le binôme Jordan Bardella–Marine Le Pen modèle un programme destiné à séduire à la fois les retraités, déjà largement acquis, et le patronat. Pour ne froisser aucune composante de cet électorat composite, le parti écarte l’idée de taxer plus fortement les plus riches, qu’il s’agisse d’actifs ou de retraités, et prône en même temps une accélération de la « politique de l’offre » initiée sous le mandat d’Emmanuel Macron, tout en en dénonçant certains effets.
Cette stratégie duale génère des tiraillements : des promesses de réduction fiscale destinées à rassurer une partie de son électorat populaire pourraient bénéficier en réalité aux ménages les plus aisés et aux héritiers, comme le notent ses détracteurs. À l’intérieur du RN, la coexistence de courants « populistes » et de factions plus « libérales » contribue à un programme aux contours parfois flous. L’identité du futur candidat porté par le parti à l’élection présidentielle pourrait, selon le RN lui‑même, préciser ses priorités économiques.
La question du financement et des conséquences économiques
Pour financer ses mesures, le RN affiche une volonté de réduire sensiblement les dépenses de l’État. Ce choix — présenté comme une preuve d’orthodoxie budgétaire — suscite des inquiétudes quant à ses effets récessifs potentiels et à ses conséquences sur la place de la France en Europe et sur l’attractivité du pays.
Parmi les mesures annoncées figure un coup de rabot sur le financement des associations. Le RN met en avant cet axe en visant, selon ses critiques, des structures qui accompagnent des populations précaires, notamment les immigrés. Les opposants soulignent que ces restrictions budgétaires pourraient fragiliser des dispositifs de solidarité et amplifier des tensions sociales.
Un débat politique aux enjeux larges
Le rôle accru du RN dans le débat budgétaire oblige à examiner plus largement son programme. Au‑delà des éléments de langage et des slogans, c’est la cohérence macroéconomique, la répartition des efforts fiscaux et l’impact social des coupes proposées qui retiennent l’attention des analystes et des partis adverses. La mise en évidence d’incohérences budgétaires alimente les accusations d’irresponsabilité et de démagogie, notamment lorsqu’un parti prétend concilier baisses d’impôts généralisées et fortes réductions de dépenses publiques sans préciser clairement les compensations.
Dans ce contexte, les critiques convergent sur un point : l’analyse du RN ne peut se limiter à ses postures politiques ou à sa capacité à rassembler. Elle doit porter sur la faisabilité et les effets concrets de ses propositions, en particulier sur les classes sociales et secteurs économiques les plus vulnérables. Sans prétendre trancher des débats qui relèvent d’évaluations techniques précises, le passage du RN au crible du débat budgétaire montre que la route vers l’exercice du pouvoir exige non seulement la capacité à séduire des électeurs, mais aussi la preuve d’un programme cohérent et chiffré.
Enfin, si la confrontation politique inclut naturellement des attaques partisanes, elle révèle aussi un besoin d’examen rigoureux et public des alternatives proposées au modèle économique actuel, afin de mesurer leurs coûts et leurs bénéfices réels.