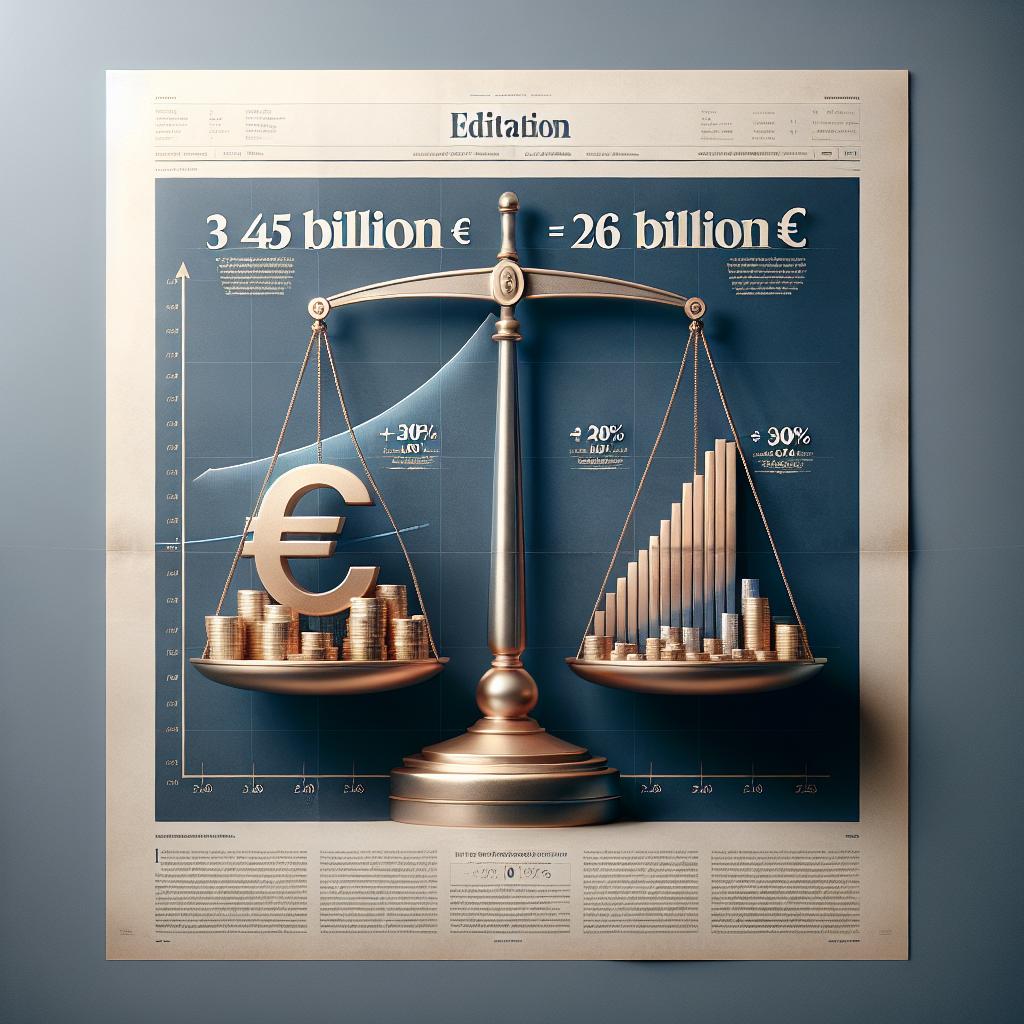La transposition explicite de la notion de consentement dans la définition pénale du viol a été publiée au Journal officiel vendredi 7 novembre 2025, dix jours après son adoption par le Parlement, au terme d’un long processus législatif transpartisan.
Un changement inscrit dans la loi après des débats intenses
Cette modification législative intervient quelques mois après le retentissant procès des viols de Mazan, durant lequel la notion de consentement a occupé une place centrale dans les débats judiciaires et médiatiques. Le texte a pour objectif de clarifier, « noir sur blanc », une notion déjà largement présente dans la jurisprudence mais dont la formulation explicite doit faciliter l’application du droit pénal.
Le projet a franchi plusieurs étapes parlementaires et techniques. Selon le texte publié, la promulgation au Journal officiel intervient dix jours après l’adoption en séance publique, ce qui marque l’aboutissement d’une mission d’information et d’un examen approfondi par les commissions concernées.
Définition légale du consentement et portée juridique
La loi définit désormais le consentement comme « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ». Le texte précise en outre que « il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ». Ces formulations reprennent et entérinent des principes déjà dégagés par la pratique judiciaire.
Le texte ajoute également que « il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ». Par cet énoncé, la loi conserve les critères qui structuraient jusque-là la qualification pénale des agressions sexuelles tout en plaçant le consentement au cœur de la construction juridique du viol.
Comparaisons internationales et calendrier
La France rejoint, avec cette réforme, une série de pays ayant déjà modifié leurs législations pour intégrer la notion explicite de consentement, parmi lesquels le Canada, la Suède, l’Espagne ou encore la Norvège. Le texte mentionne plus spécifiquement des réformes menées jusqu’au printemps 2025, situant la mesure dans un mouvement législatif européen et transatlantique.
Sur le calendrier interne, la décision a été consolidée au fil des travaux parlementaires, notamment après la publication d’un avis du Conseil d’État rendu au début de mars 2025, qui a fourni un cadre juridique et technique encourageant pour les auteurs de la réforme.
Inquiétudes et réponses lors des débats
Le dossier avait cependant suscité d’importantes réticences lors de son examen, y compris au sein de certaines associations féministes. Deux principales craintes ont été exprimées : d’une part le risque d’une inversion de la charge de la preuve, qui ferait peser sur les plaignantes l’obligation de prouver qu’elles n’étaient pas consentantes ; d’autre part la possible contractualisation des rapports sexuels, redoutée comme une réduction de la sexualité à une logique juridique.
Au fil des auditions et des amendements, la majorité des élus s’est dite rassurée. Les garanties juridiques apportées par l’avis du Conseil d’État et les précisions insérées dans le texte ont contribué à dissiper certaines inquiétudes en encadrant la manière dont le juge doit apprécier le consentement au regard des circonstances.
Le texte insiste sur le fait que le silence ou l’absence de réaction ne sauraient suffire à établir le consentement, ce qui vise à protéger les victimes de situations où la contrainte psychologique ou la sidération rendent toute manifestation explicite impossible.
Reste que la mise en œuvre pratique de ces dispositions dépendra des instructions données aux forces de l’ordre, des orientations de la magistrature et de la formation des acteurs judiciaires. Les débats parlementaires ont souligné la nécessité d’accompagner la loi de mesures pédagogiques afin d’assurer une application cohérente et protectrice des victimes.
En l’état, l’inscription légale du consentement modifie la grille d’analyse pénale et apporte une formulation explicite destinée à clarifier les qualifications et sécuriser la décision judiciaire, tout en conservant les éléments constitutifs que sont la violence, la contrainte, la menace ou la surprise.