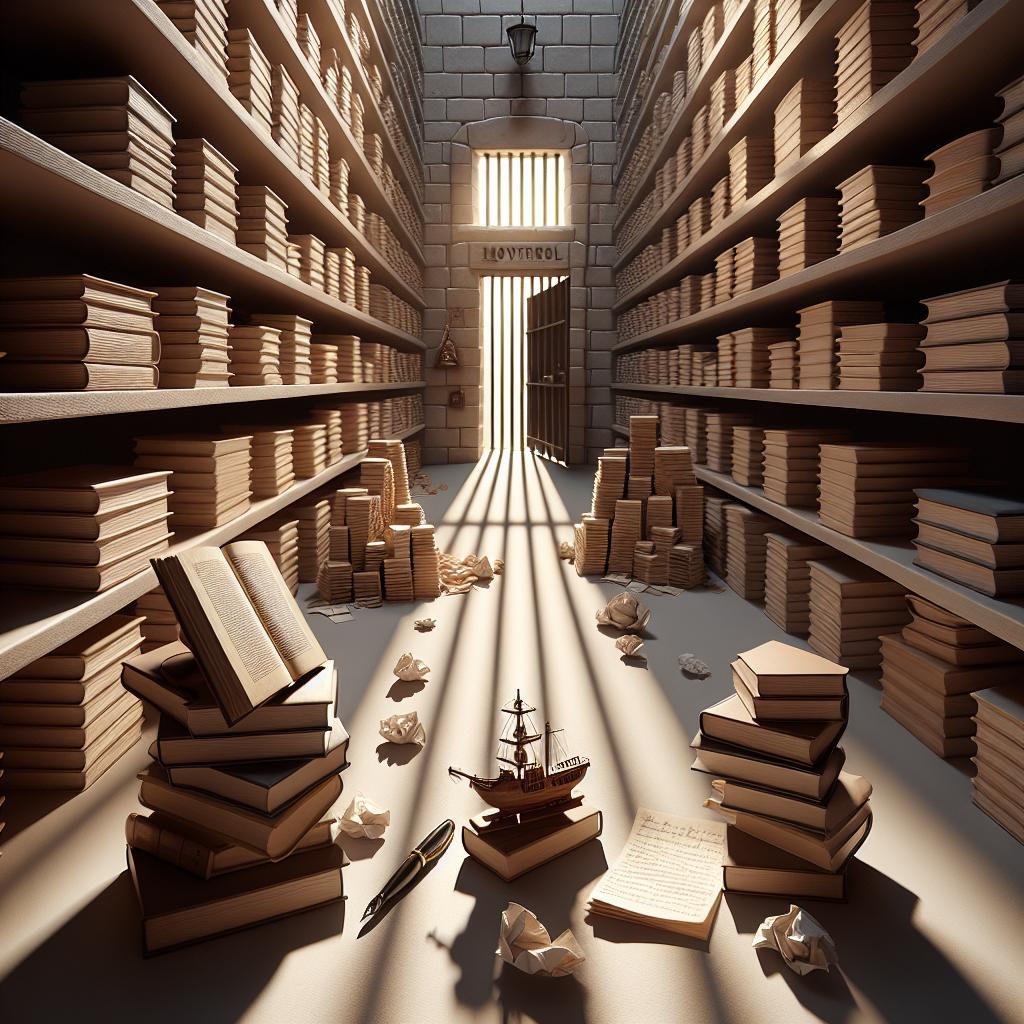Le Mois sans tabac, lancé le 1er novembre, revient cette année sur un paradoxe français fréquemment dénoncé : l’État encourage l’arrêt du tabac tout en maintenant des dispositifs de soutien aux buralistes, alors que l’industrie du tabac et des produits à base de nicotine continue d’exercer une forte présence commerciale et marketing, y compris à l’égard des jeunes.
Bilan récent : une baisse notable, mais des inégalités persistent
Selon Santé publique France, la consommation quotidienne de tabac a reculé de sept points au cours des trois dernières années, pour atteindre 17,4 % de la population qui fume quotidiennement. Ce recul traduit l’effet cumulatif de politiques publiques et d’actions citoyennes menées depuis des décennies.
Si ces chiffres constituent une avancée, ils ne gomment pas les disparités : le tabagisme reste plus fréquent dans certains groupes sociaux et territoires. Les progrès globaux coexistent avec des zones où la dépendance au tabac demeure élevée, ce qui complique les stratégies de prévention et de réduction des risques.
Chronologie des mesures : interdictions et régulations
La France a adopté, au fil des années, des mesures fortes visant à réduire l’usage du tabac. En 1976, la loi portée par Simone Veil a interdit la publicité pour le tabac. En 1991, la loi dite « Evin », conduite par Claude Evin, a renforcé la protection des mineurs et introduit des outils de régulation, dont l’augmentation des prix.
Les interdictions d’usage dans les lieux publics ont été durcies en 2006 sous l’impulsion de Xavier Bertrand. En 2016, le paquet neutre et les images-chocs ont été instaurés par Marisol Touraine. Plus récemment, en 2020, une mesure menée par Agnès Buzyn a fixé un prix plancher d’environ 10 euros pour certains paquets et a généralisé le remboursement des substituts nicotiniques.
Sur le plan international, la France a ratifié la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac en 2004, inscription qui a encadré de nombreuses politiques nationales, même si des observateurs relèvent des marges d’application et d’exécution à approfondir.
Décisions moins visibles mais cruciales
Outre les grands gestes réglementaires, des décisions plus ciblées ont joué un rôle important : interdiction de cigarettes aromatisées ou de produits présentés comme « bonbons », suppression des mentions commerciales jugées trompeuses (« light », « léger »), et encadrement des formats et de la présentation des paquets. Ces mesures ont visé à réduire l’attractivité du produit, notamment auprès des jeunes.
Ces décisions, parfois contestées au moment de leur adoption, sont aujourd’hui souvent présentées comme des leviers qui ont contribué à sauver des vies. Leur efficacité reste cependant liée à une application continue et à des contrôles adaptés face aux nouvelles formes de commercialisation.
Vers un nouveau narratif : dénormaliser le tabac
Les acteurs de la prévention défendent désormais une approche élargie, qualifiée de « dénormalisation » : il ne s’agit plus seulement d’alerter le fumeur sur son risque individuel, mais de positionner le tabac comme une menace collective. Trois dimensions sont systématiquement mises en avant.
Premièrement, la dimension sanitaire et sociale : le tabac affecte les non-fumeurs par le biais du tabagisme involontaire et pèse sur les systèmes de santé. Deuxièmement, la dimension environnementale : la culture du tabac est accusée d’avoir des effets destructeurs dans certains pays du Sud, avec des conséquences écologiques et sociales pour les populations locales. Troisièmement, la dimension économique : le coût global du tabagisme comporte des postes directs et indirects, évalués dans certaines estimations à environ 156 milliards d’euros par an pour l’économie – un chiffre souvent avancé pour mesurer l’ampleur du dommage économique.
Enfin, la question des droits de l’enfant est régulièrement mise en avant : des mineurs travaillent dans des champs de tabac dans plusieurs pays, et d’autres jeunes risquent une consommation précoce et une dépendance durable au sein de pays consommateurs.
Ce changement de perspective invite à combiner mesures de protection, politiques fiscales, actions éducatives et contrôles renforcés du marketing, afin de réduire l’attractivité et l’accessibilité du tabac pour les générations futures.
Dans ce paysage, le Mois sans tabac constitue un temps fort de sensibilisation et de mobilisation, mais il s’inscrit aussi dans une bataille de long terme. Les succès obtenus montrent l’effet des politiques publiques, tandis que les critiques et limites relevées rappellent la nécessité d’une stratégie cohérente et coordonnée sur le plan national et international.