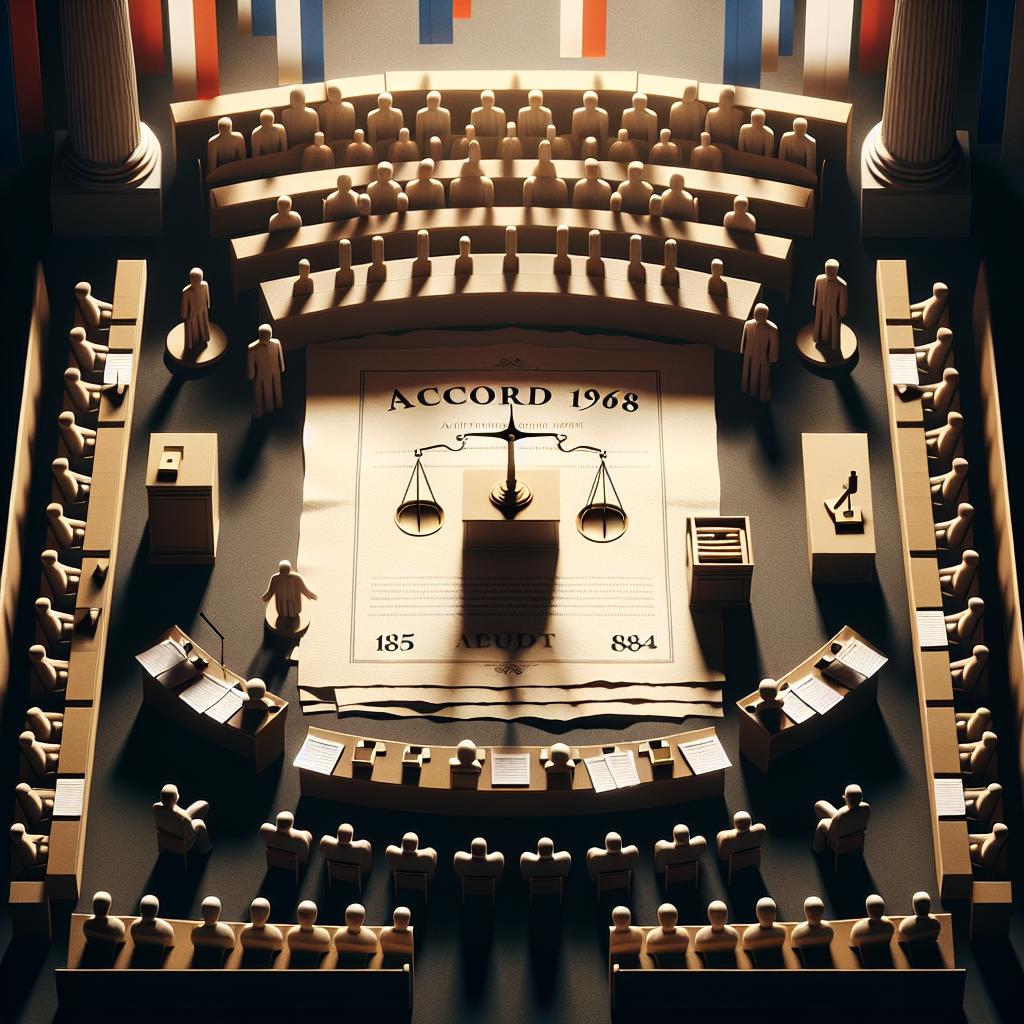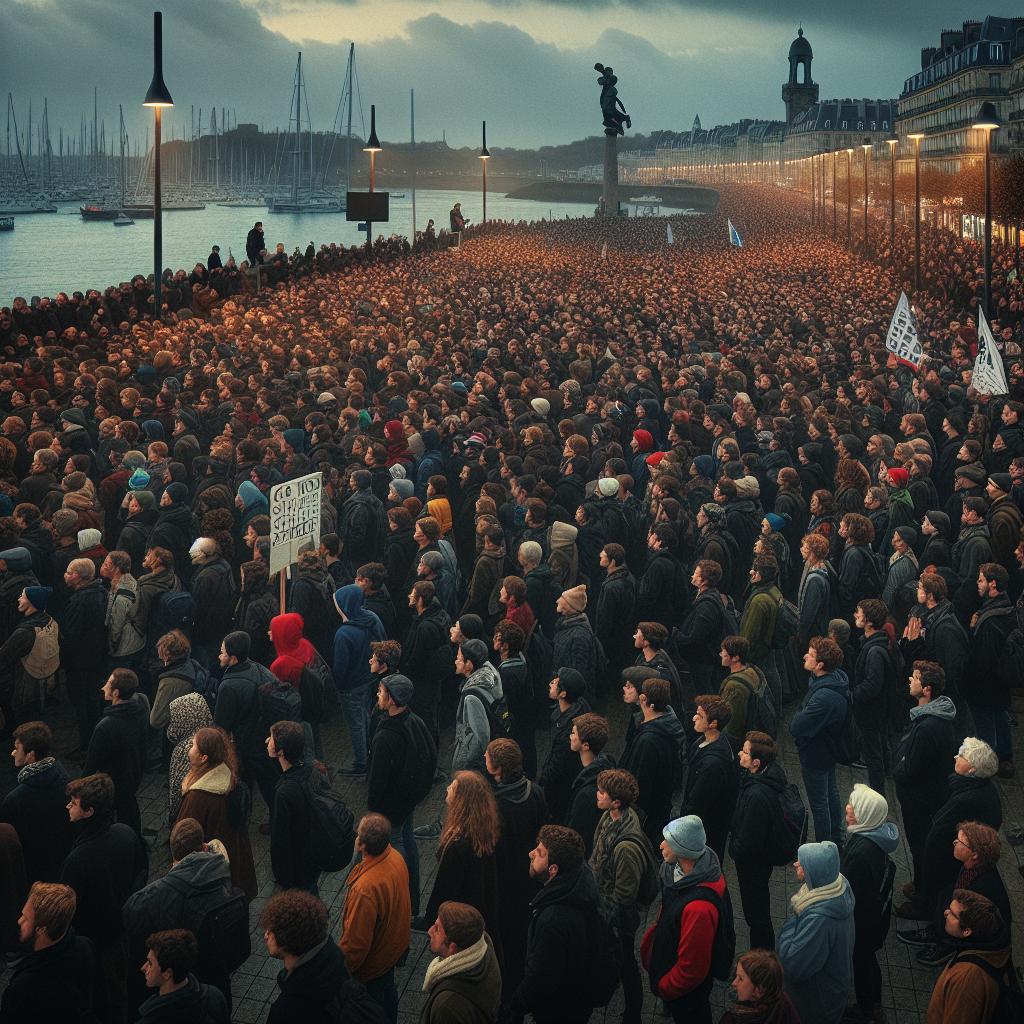La question de « qui gagnerait et qui perdrait » revient au centre du rapport que le Conseil d’orientation des retraites (COR) a récemment élaboré sur les droits conjugaux — autrement dit la pension de réversion — et sur les droits familiaux, conçus pour compenser les inégalités liées à la naissance et à l’éducation des enfants. Le document, encore non rendu public et dont une version quasi définitive a été consultée par Le Monde, propose plusieurs scénarios d’évolution de ces dispositifs. Les auteurs soulignent que l’exercice se situe « dans un domaine sensible qui concerne l’ensemble des Français » et qu’il vise à « nourrir la réflexion » plutôt qu’à livrer des « réformes clé en main ». Si certaines pistes paraissent techniques, leurs effets potentiels, s’ils étaient adoptés, risquent d’être immédiatement perçus comme favorisant certains assurés au détriment d’autres.
Un rapport consulté mais non publié
Le COR a travaillé sur ce sujet à la demande du gouvernement. En mai 2023, l’ancienne Première ministre Élisabeth Borne a demandé que la question des droits familiaux et conjugaux soit examinée de manière approfondie. Le motif invoqué était double : ces droits reposent sur des règles complexes — souvent qualifiées de « touffues » — et ils produisent des inégalités que certains jugent incompatibles avec les évolutions sociales récentes. La version du rapport dont Le Monde a pu prendre connaissance est présentée comme quasi définitive, mais elle n’a pas encore été rendue publique au moment de la consultation. Les auteurs du COR insistent sur le caractère exploratoire des scénarios envisagés.
Que recouvrent les droits conjugaux et familiaux ?
Les « droits conjugaux » renvoient principalement à la pension de réversion : il s’agit de la part de retraite versée au conjoint survivant après le décès d’un assuré. Les « droits familiaux » regroupent des mécanismes visant à compenser financièrement les coûts et les interruptions de carrière liés à la naissance et à l’éducation des enfants. Ces dispositifs cherchent à limiter l’impact des carrières heurtées, souvent plus fréquentes chez les personnes qui ont assumé la majeure partie des tâches d’éducation et de soins. Dans le débat public, ces deux catégories sont souvent opposées à l’exigence de neutralité contributive, tandis que les défenseurs des droits familiaux soulignent leur rôle correcteur en faveur de l’égalité réelle.
Pourquoi revoir ces dispositifs maintenant ?
Plusieurs éléments expliquent la demande d’une revue systématique. D’une part, la complexité des textes et la multiplicité des cas particuliers rendent difficile la lisibilité et la mise en œuvre uniforme des droits. D’autre part, les évolutions des modèles familiaux — hausse des familles monoparentales, diversification des parcours professionnels et changements dans la répartition des tâches domestiques — interrogent la pertinence des règles héritées du passé. Le COR rappelle également que les dispositifs peuvent produire des effets redistributifs importants, avec des conséquences durables sur les niveaux de vie des ayants droit. La commande faite en mai 2023 avait pour objectif d’apporter une évaluation actualisée de ces effets et d’ouvrir des pistes de réflexion, sans formuler de décisions politiques immédiates.
Qui pourrait gagner ou perdre ?
Le rapport souligne que toute modification des règles de reversion ou d’attribution des droits familiaux risque de créer des « gagnants » et des « perdants ». Sans entrer dans des simulations chiffrées non publiées, les auteurs rappellent que des ajustements peuvent améliorer la situation de certains conjoints survivants ou des parents ayant interrompu leur activité, tout en dégradant celle d’autres catégories d’assurés. L’inégalité intergénérationnelle, la situation des carrières longues ou courtes, ainsi que le cumul d’autres revenus ou prestations seront des paramètres déterminants pour apprécier l’impact des scénarios proposés. Les rédacteurs insistent sur la nécessité d’évaluer finement ces effets avant toute décision politique.
Enjeux politiques et techniques
Au-delà des considérations techniques, la révision des droits conjugaux et familiaux est porteuse d’enjeux symboliques et électoraux. Elle touche à des valeurs — solidarité, reconnaissance du travail non rémunéré, égalité homme-femme — et à des choix de redistribution. Les auteurs du rapport choisissent de rester prudents : ils fournissent des éléments d’analyse et des options de conception, mais la traduction de ces options en décisions publiques nécessitera des arbitrages politiques. Pour l’heure, le document du COR nourrit le débat en rappelant la complexité du sujet et l’importance d’une approche mesurée, basée sur une évaluation précise des conséquences pour l’ensemble des assurés.