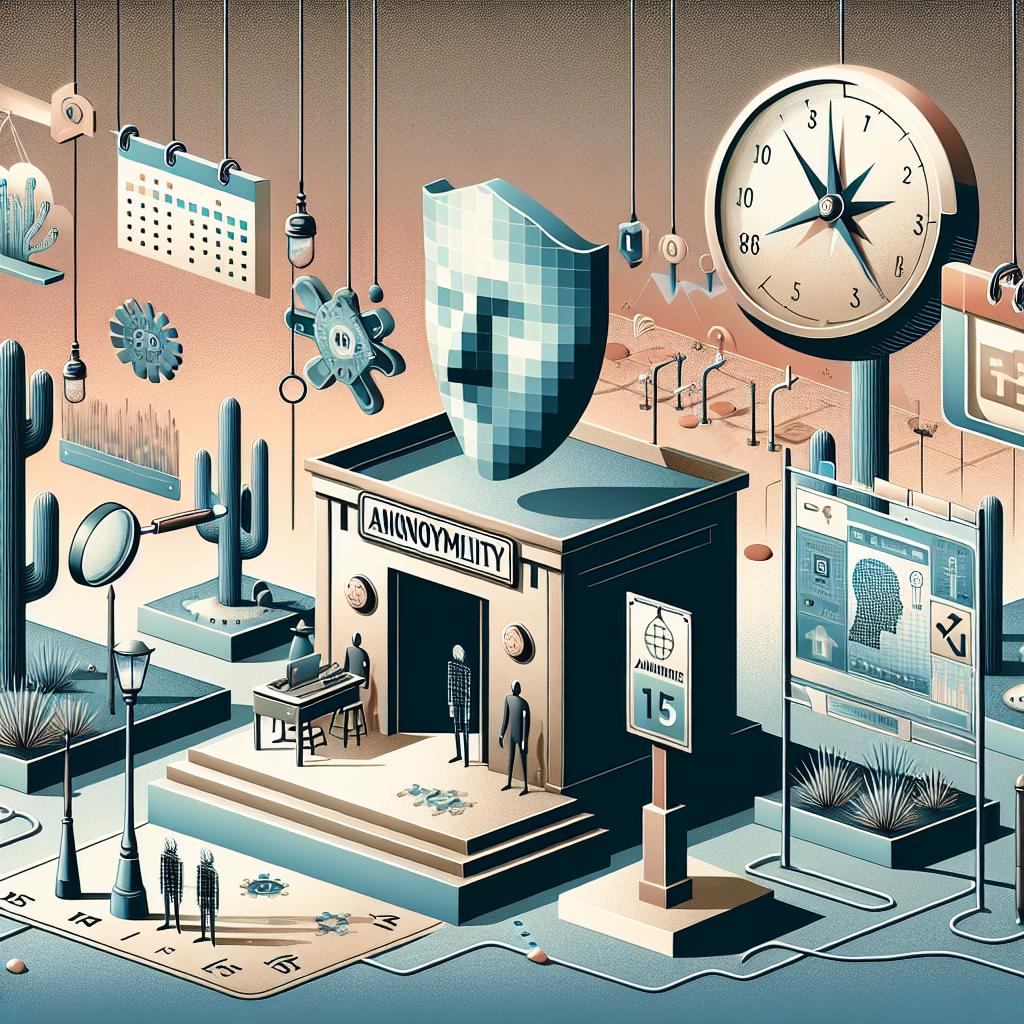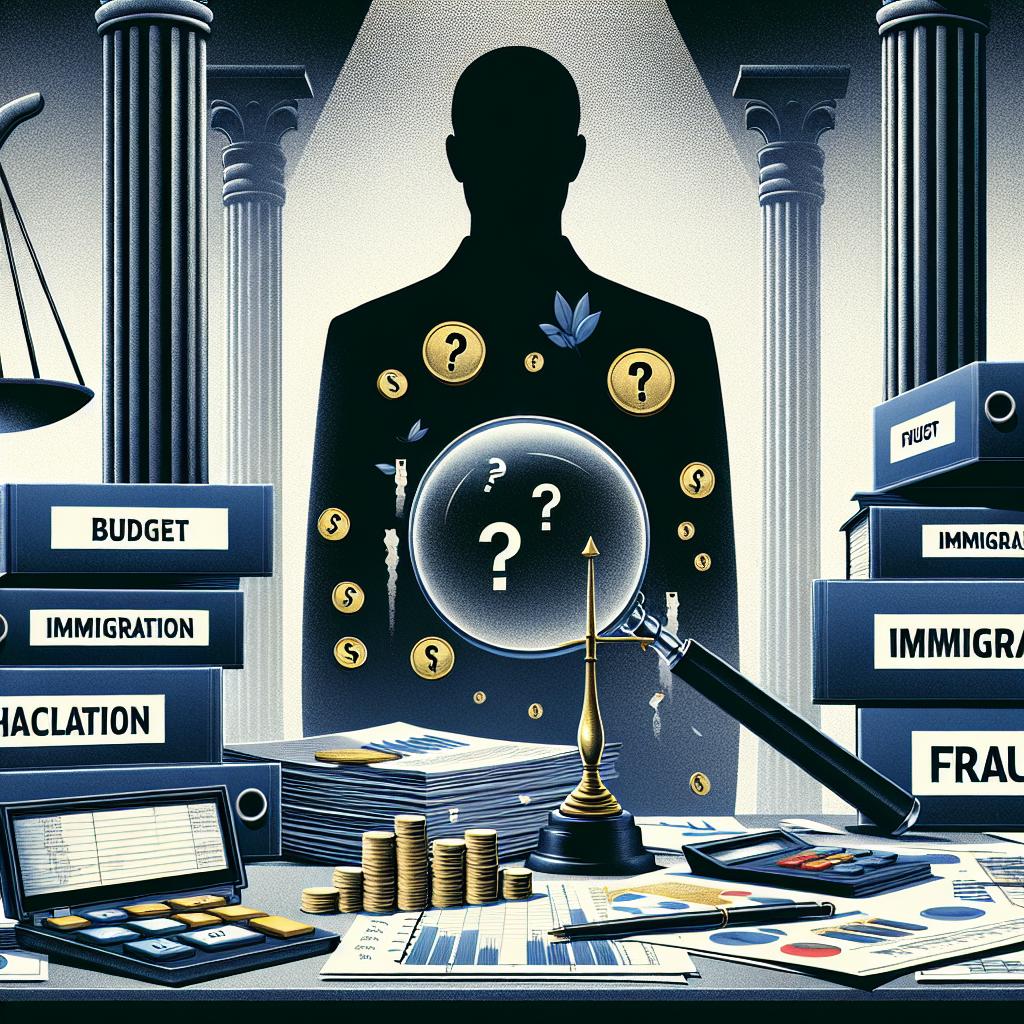Sur la quarantaine de temps proposés lors du Congrès des maires, qui s’est tenu du 18 au 20 novembre à Paris, seulement deux sessions étaient consacrées à l’école. À l’aube des élections municipales de mars 2026, cette présence limitée interroge, alors que les communes restent des lieux majeurs de l’action éducative quotidienne.
Des maires acteurs de la vie éducative
Le rôle des communes dépasse fréquemment la simple gestion technique des bâtiments et des services. Elles sont garantes de l’obligation scolaire, coordinatrices d’initiatives locales et porteuses de projets qui influent directement sur le quotidien des enfants et des familles. Là où l’exécutif national cherche parfois un cap, des équipes municipales expérimentent des réponses concrètes aux besoins éducatifs.
Dans plusieurs collectivités, la cantine est reconçue en espace pédagogique : les enfants participent au choix des menus et cultivent des légumes dans un jardin communal. D’autres villes associent enseignants et chercheurs à la conception de la cour de récréation pour en faire un lieu de vie et d’apprentissage. Des partenariats avec des artisans enrichissent l’offre périscolaire et permettent d’aborder concrètement des enjeux comme l’apprentissage des savoirs-faire ou la transition écologique.
Plusieurs maires soutiennent aussi le développement de l’« école dehors », qui organise des activités pédagogiques en plein air. Ces initiatives montrent que des compétences souvent perçues comme « techniques » — cantine, bâti scolaire, périscolaire — contribuent très directement à la réussite éducative.
Des implications budgétaires et juridiques
L’éducation demeure l’un des premiers postes de dépenses pour les communes. En moyenne, près de la moitié du budget de fonctionnement d’une collectivité est absorbée par le premier degré. Ce poids financier traduit l’ampleur des responsabilités locales : entretien des écoles, restauration, services périscolaires, activités éducatives.
Le principe de libre administration des collectivités, consacré par l’article 72 de la Constitution, leur ouvre aussi des marges d’expérimentation. Concrètement, les communes peuvent, pour un temps limité et un objet précis, déroger à des règles nationales afin de tester des solutions mieux adaptées à leur territoire. Cette faculté vise à tenir compte de la diversité des réalités locales tout en restant arrimée au cadre républicain.
Ces expérimentations, quand elles existent, cherchent à répondre à des problématiques diverses : réduction des inégalités territoriales, articulation entre temps scolaire et périscolaire, intégration des enjeux écologiques dans les pratiques scolaires, ou encore rapprochement entre monde de l’école et acteurs locaux (artisans, associations, universités).
Des exemples concrets et leur portée
Les expériences menées en commune ont des effets tangibles sur le terrain. Une cantine qui implique les élèves dans le choix des menus favorise l’éducation au goût et à la nutrition. Un potager communal aménagé pour les scolaires permet des apprentissages transversaux — sciences, autonomie, respect de l’environnement. La rénovation de cours de récréation pensée avec des enseignants peut transformer des espaces de pause en lieux d’exploration physique et cognitive.
Ces projets restent toutefois inégaux selon les ressources et les priorités locales. Certaines collectivités disposent d’un budget et d’équipes dédiés pour piloter des innovations. D’autres villes, plus contraintes financièrement, peinent à soutenir des initiatives semblables malgré la volonté politique.
À l’approche des municipales
La faible place accordée à l’école au Congrès des maires questionne dans un contexte électoral où les enjeux locaux seront au cœur des débats. Les élections municipales de mars 2026 rapprochent la prise de décision des citoyens et mettent en lumière l’impact des politiques communales sur la vie quotidienne des enfants et des familles.
Pour les candidats et les équipes en place, la manière dont ils abordent l’éducation locale traduit des choix de priorité budgétaire et de conception du rôle communal. Les expériences existantes montrent que l’innovation se joue souvent à l’échelle locale, quand la contrainte réglementaire et le cadre national laissent aux communes la possibilité d’adapter leurs réponses.
En l’absence d’un débat plus large sur ces sujets lors du Congrès, ce sont les terrains d’expérimentation municipaux qui continuent de forger, jour après jour, des réponses éducatives concrètes. Leur diversité illustre la capacité des collectivités à agir au plus près des besoins des enfants, tout en rappelant l’importance des ressources et des cadres juridiques pour généraliser les bonnes pratiques.