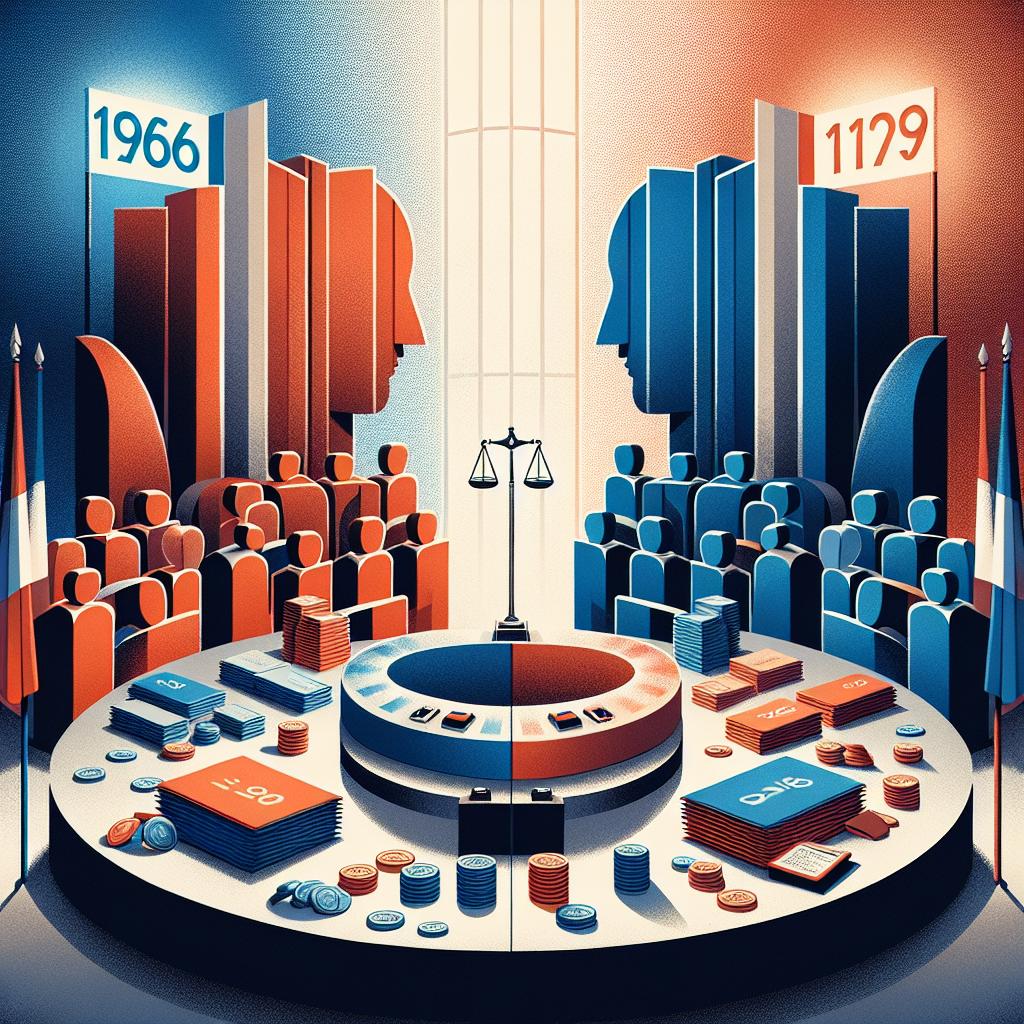Avec son air débonnaire et sa bonne humeur communicative, André Chandernagor est mort le 18 novembre à Aubusson (Creuse), à l’âge de 104 ans.
Il fut à la fois ancien ministre et ancien premier président de la Cour des comptes, figures qui le placent parmi les grandes personnalités de l’administration française du XXe siècle. Il aimait rappeler, avec une pointe d’humour, qu’enfant il priait « le Bon Dieu de vivre cent ans » — vœu qu’il disait avoir vu exaucé.
Origines familiales et héritage singulier
Né le 19 septembre 1921 à Civray (Vienne), André Chandernagor venait d’une famille modeste : son père dirigait une affaire de coutellerie. Surnommé familièrement « Chander », il se fit remarquer très tôt par son sérieux scolaire et sa soif d’excellence.
La famille portait en outre une histoire familiale peu commune, souvent évoquée par Chandernagor lui‑même. Un de ses ancêtres, recueilli en 1757 par le maréchal de Bussy — compagnon d’armes de Dupleix, alors gouverneur général des établissements français en Inde — avait été baptisé, affranchi et reçu le nom de Charles‑François Chandernagor‑Bengale, en référence à l’ancien comptoir français.
Cette origine, transmise oralement au fil des générations, faisait partie de l’identité et des récits familiaux qui ont structuré la mémoire d’André Chandernagor sans pour autant en faire un thème public constant de sa carrière.
Parcours scolaire et premières fonctions
Élève appliqué, il collectionna les prix d’excellence à l’école communale et obtint son baccalauréat avec mention bien. En octobre 1940, il intégra l’école coloniale du lycée Henri‑IV, à Paris, formation destinée à préparer des cadres pour l’administration outre‑mer.
Sa scolarité fut rendue possible par une bourse qui lui permit notamment de payer une chambre d’hôtel lors de ses études à Paris. Le 1er août 1943, il devint élève administrateur des services civils de l’Indochine, étape officielle de son entrée dans l’administration coloniale puis, plus tard, dans les services de l’État.
Ces éléments témoignent d’un parcours typique des cadres formés dans la première moitié du XXe siècle, marqué par l’accès à l’éducation via des bourses et par des affectations dans les colonies puis dans les administrations nationales.
Le style et la réputation d’un homme public
On retenait chez lui l’allure d’un gentilhomme campagnard et une bonne humeur communicative. Son comportement et son verbe modéré lui valaient une image de dignité et de proximité, loin des excès de la vie politique. Ceux qui l’ont connu se souvenaient d’un homme posé, attaché aux formes et à la courtoisie.
Sa longue vie lui aura permis d’observer de nombreuses mutations politiques et institutionnelles. Bien que ses fonctions — notamment comme ministre et comme premier président de la Cour des comptes — témoignent d’un rôle important au sein de l’État, les éléments biographiques fournis ici se concentrent sur son origine, sa formation et le souvenir qu’il laissait par son caractère et sa longévité.
Une mémoire familiale et nationale
Au‑delà des titres officiels, la figure d’André Chandernagor renvoie à des histoires croisées : celle d’une ascension sociale permise par l’école et les bourses, et celle d’un héritage familial qui raconte une présence française en Inde au XVIIIe siècle. Ces deux lignes narratives se mêlent dans le parcours d’un homme né en 1921 et décédé cent quatre ans plus tard.
Son décès, intervenu le 18 novembre à Aubusson (Creuse), clôt une trajectoire longue et discrète, marquée par des fonctions de premier plan et par un tempérament qui restera dans les mémoires comme celui d’un homme simple mais engagé.
Les informations reprises ici émanent du texte fourni et se limitent aux faits qui y figurent ; elles cherchent à restituer de manière claire et structurée la vie et les origines d’un haut responsable public sans extrapoler au‑delà des éléments consignés.