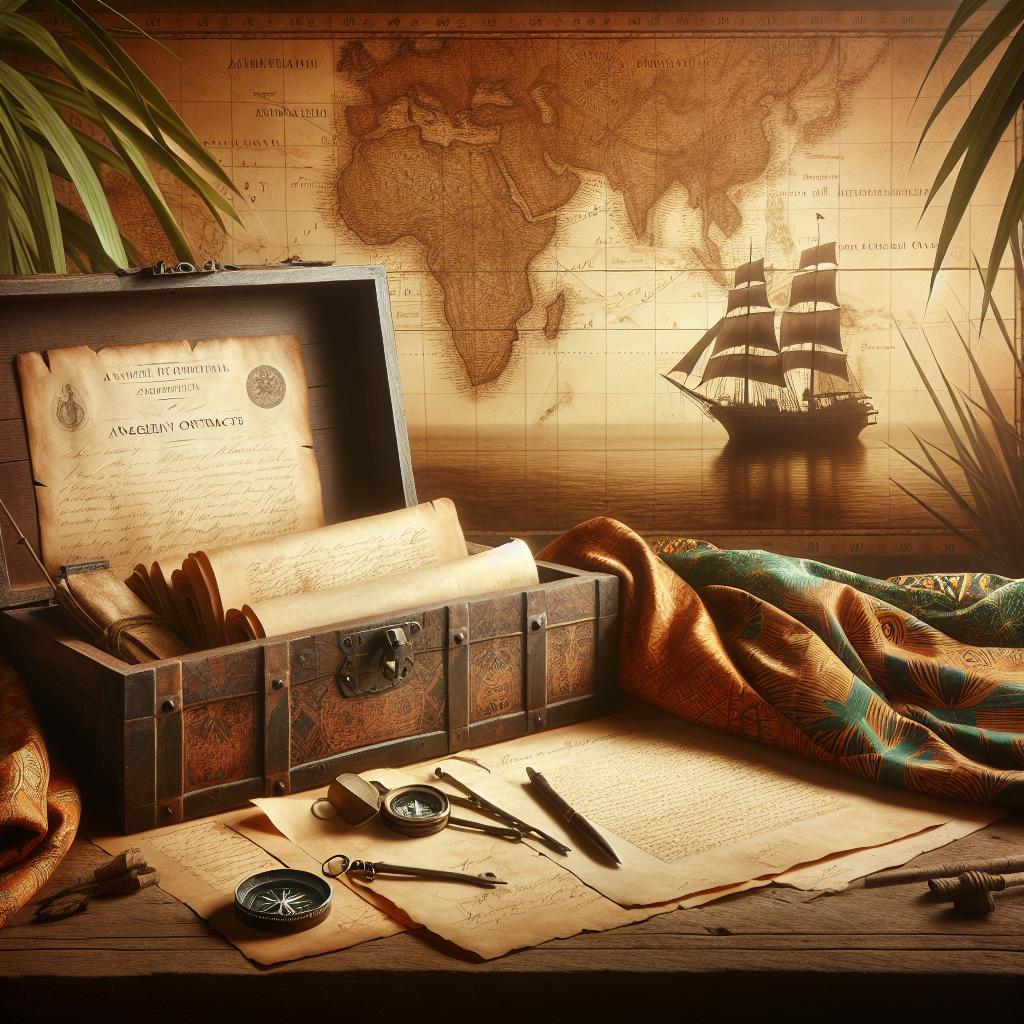Face à la montée des tensions et des inégalités, la question du collectif revient au cœur des débats : comment préserver des repères partagés et créer des expériences communes capables de recréer du lien social ? Le service civique est présenté comme l’un des leviers de cette réponse, en offrant un cadre d’engagement structuré pour les jeunes et en contribuant, selon ses promoteurs, à la cohésion nationale.
Cadre légal et finalités
Inscrit en 2010 dans le code du service national, le service civique est encadré par l’article L.120-1, qui précise : « Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général en France ou à l’étranger auprès d’une personne morale agréée. »
Quinze ans après son insertion en 2010 (en 2025), ce dispositif reste pensé comme une réponse publique à la question politique de la réaffirmation du bien commun dans une société fragmentée. Le texte légal vise explicitement la mixité sociale et l’engagement citoyen, en donnant un cadre formel aux missions d’intérêt général.
Conditions d’accès et modalités
Le service civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. La durée des missions varie de six à douze mois. Pendant cette période, les volontaires perçoivent une indemnisation et bénéficient d’un accompagnement destiné à faciliter leur insertion ou leur orientation future.
Le dispositif se veut simple et lisible : il offre une formule d’engagement courte et encadrée, accessible à un large public, et conçue pour se combiner avec des parcours éducatifs ou professionnels. Il est décrit comme inclusif par ses promoteurs, notamment en raison de l’élargissement de l’âge maximal pour certains profils.
Portée chiffrée et réseaux d’accueil
Le service civique a rencontré un succès important. Le texte d’origine indique qu’il a permis à « plus de 10 % d’une classe d’âge – soit 80 000 personnes – » de s’engager chaque année. Dans le même temps, le bilan quinquennal et les bilans cumulés rapportent qu’en quinze ans près de 900 000 volontaires ont participé au dispositif.
Par ailleurs, environ 80 000 organismes d’accueil ont eu recours à des volontaires : associations, établissements scolaires, préfectures, hôpitaux, collectivités territoriales, structures médico‑sociales ou acteurs de la protection de l’environnement. Ces structures bénéficient directement de la présence des volontaires pour mener des actions d’intérêt général.
Interventions et apprentissages sur le terrain
Sur le terrain, les missions sont diverses. Les volontaires interviennent auprès de personnes âgées isolées, soutiennent des élèves en difficulté, accompagnent des publics fragilisés ou participent à des actions liées à la transition écologique. Ces expériences permettent, selon le récit institutionnel, d’acquérir le sens de l’action collective et des compétences citoyennes.
Le dispositif met aussi l’accent sur des formations pratiques et des expériences concrètes, qui peuvent inclure des gestes de premiers secours ou des activités pédagogiques. Pour beaucoup de jeunes, le service civique devient une étape formative, parfois décrite comme un rite de passage vers l’âge adulte.
Bilan et portée politique
Au-delà des chiffres, le service civique est présenté comme un investissement dans la République : il vise à renforcer les solidarités locales et à offrir à chaque volontaire une expérience structurante. Les promoteurs soulignent son rôle dans la formation citoyenne et la mise en réseau d’acteurs du territoire.
Le bilan chiffré — plusieurs centaines de milliers de volontaires et des dizaines de milliers d’organismes d’accueil — témoigne d’une implantation notable du dispositif. Reste la question de l’évaluation fine de ses effets à long terme sur l’insertion professionnelle, la mixité sociale et la réduction des fractures territoriales, des enjeux qui exigent des évaluations régulières et comparatives.
En somme, le service civique, tel que décrit dans le cadre légal et dans les bilans disponibles, constitue une réponse publique structurée à la volonté de renforcer le collectif. Ses modalités, sa portée et ses impacts sur les trajectoires individuelles et sur la cohésion sociale restent au centre des discussions publiques.