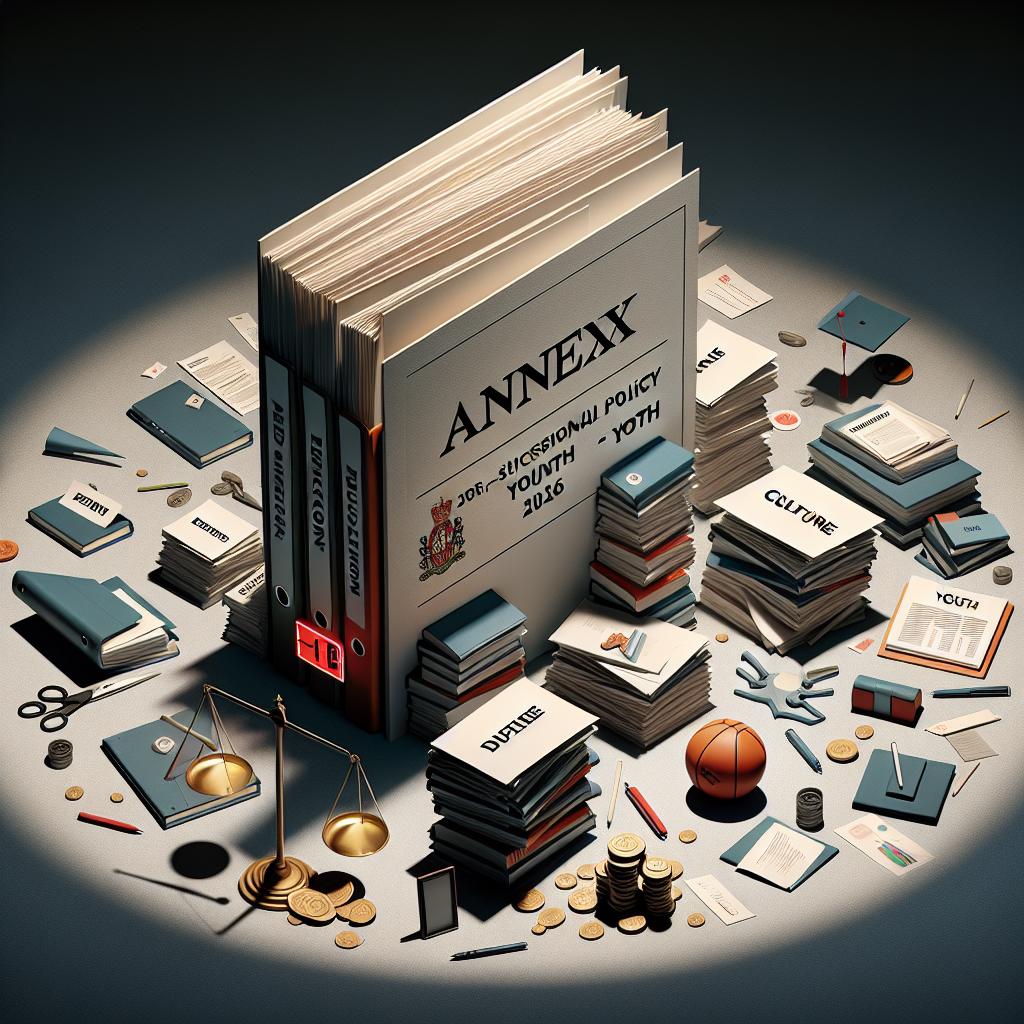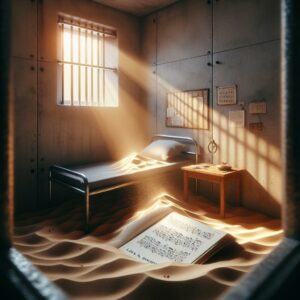Pour Hugo Huet, président du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse, organe consultatif placé auprès du Premier ministre, le constat est net : « Les jeunes sont les oubliés du projet de budget (…) . Cela envoie un signal assez déplorable. »
Cette critique est étayée par les documents joints au projet de loi de finances (PLF) 2026, examiné à l’Assemblée depuis le 14 octobre. Ces annexes détaillent des mouvements de crédits qui, selon les rapporteurs, pénaliseraient les politiques en faveur des jeunes.
Baisse des crédits et chiffres clés
Le PLF 2026 prévoit une hausse globale des dépenses de l’État de 10,5 milliards d’euros par rapport à 2025, hausse principalement portée par un renforcement des moyens de la défense.
En parallèle, la plupart des crédits destinés aux jeunes âgés de 3 à 30 ans sont rabotés. Le document intitulé politique transversale en faveur de la jeunesse 2026 — une annexe au PLF disponible sur le site Budget.gouv.fr — fait état d’une baisse globale d’environ 1 milliard d’euros pour cette tranche d’âge.
Cette politique « transversale » représente pourtant un volume significatif : 119,5 milliards d’euros de dépenses au total, montant qui comprend l’essentiel du budget de l’éducation nationale et ses pensions de retraite. La réduction d’environ 1 milliard reste toutefois notable au regard de l’ensemble des crédits.
Pour saisir l’ordre de grandeur, les auteurs du dossier soulignent que cette baisse dépasse les 700 millions d’euros récemment supprimés de l’aide publique au développement. Autrement dit, la contraction affecte des montants comparables à d’autres postes budgétaires importants.
Fragmentation, lisibilité et absence d’annonce
Plusieurs éléments compliquent la lecture de ces économies. D’abord, les diminutions ne sont pas concentrées sur un seul programme : elles sont réparties sur de nombreux programmes relevant de ministères différents, ce qui rend le mouvement moins visible et moins lisible pour le grand public et les acteurs associatifs.
Le caractère éclaté de la politique jeunesse n’est pas une nouveauté. La Cour des comptes notait dans son rapport annuel 2025 : « Aucune politique publique n’est aussi segmentée que celle destinée aux jeunes ». Cette fragmentation complique l’évaluation de l’impact réel des réductions de crédits et la compréhension des priorités gouvernementales.
Autre point souligné : la baisse d’environ 1 milliard n’a fait l’objet d’aucune annonce explicite de la part du gouvernement. Elle apparaît au fil des annexes budgétaires plutôt que dans des mesures présentées publiquement, ce qui alimente les critiques sur la visibilité et la transparence des choix budgétaires.
Conséquences et questions ouvertes
Les documents budgétaires détaillent les montants, mais la traduction concrète de ces coupes en politiques opérationnelles reste, pour l’heure, insuffisamment claire. Selon les lignes budgétaires affectées, les réductions peuvent toucher des dispositifs locaux, des aides directes aux jeunes ou des financements aux acteurs associatifs.
La modestie des annonces publiques et la dispersion des crédits posent des questions sur la capacité des services ministériels et des partenaires territoriaux à anticiper et compenser des baisses. Elles interrogent également la cohérence d’une stratégie jeunesse quand son financement est fractionné entre plusieurs portefeuilles ministériels.
Les débats à l’Assemblée engagés depuis le 14 octobre devraient permettre d’éclairer certains détails, mais les premiers éléments disponibles dans l’annexe « politique transversale en faveur de la jeunesse 2026 » constituent d’ores et déjà la base factuelle sur laquelle se fondent critiques et inquiétudes.
Sans informations supplémentaires annoncées par l’exécutif, il restera difficile d’évaluer pleinement l’impact des réductions et de mesurer les choix de priorisation entre dépenses nouvelles et économies.