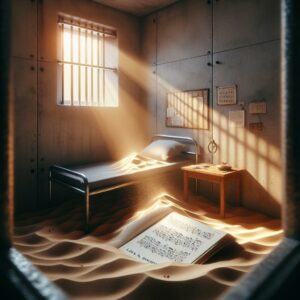En Guyane, l’eau devient un miroir des fragilités climatiques, sociales et territoriales. Ce basculement, décrit depuis plusieurs années par des observateurs locaux, se manifeste aujourd’hui de façon visible le long du fleuve Maroni et de ses affluents.
Une sécheresse inédite le long du Maroni
Depuis plusieurs semaines, les communes riveraines du Maroni connaissent une situation inédite : le niveau du fleuve a reculé à des valeurs que, selon les récits locaux, même les anciens n’avaient jamais observées. À Grand-Santi, commune enclavée comptant près de 9 000 habitants, l’eau du réseau n’est plus suffisante pour couvrir les besoins vitaux. Les habitants se voient contraints de puiser dans la rivière Lawa, aujourd’hui signalée comme polluée par le mercure et le cyanure issus d’activités illégales, pour boire, cuisiner et vivre.
Ce recul affecte aussi la circulation fluviale : des chenaux autrefois praticables s’assèchent, obligeant pirogues et embarcations à modifier leurs trajets. Ces pirogues, symboles de l’ingéniosité des peuples du fleuve et capables de transporter de lourdes charges, voient leur rôle bouleversé par l’érosion des voies navigables.
Conséquences sanitaires, sociales et éducatives
Les effets se lisent dans la vie quotidienne des villages du Haut-Maroni. À Taluen, en pays wayana, les écoles ferment parfois lorsque l’eau cesse de couler. Les centres de santé y comptent chaque litre d’eau disponible. Des enseignants quittent leurs postes, privés de conditions minimales pour exercer.
La pollution de la Lawa par le mercure et le cyanure, liée aux activités d’orpaillage illégal, aggrave la crise sanitaire. Les populations qui n’ont pas d’accès fiable à une eau protégée sont exposées à des risques immédiats et à long terme. Les opérations de l’État contre l’orpaillage se multiplient dans la région, et la tension est montée d’un cran après la perte d’un militaire au début du mois de novembre.
Parallèlement, l’isolement des communes riveraines rend plus difficiles la distribution d’eau alternative, la mise en place d’infrastructures temporaires et l’intervention des services publics, renforçant la vulnérabilité des communautés locales.
Un territoire d’expériences et d’alerte
Je connais ces rives pour y avoir grandi politiquement, techniquement et humainement. Elles m’ont appris que la République n’est jamais aussi forte que lorsqu’elle écoute ses marges, ces territoires lointains où l’État est à la fois nécessaire et fragile. De Awala-Yalimapo, commune amérindienne qui abrite, selon le texte, le plus grand site de ponte de tortues marines au monde, aux villages noirs-marrons du Haut-Maroni, où traditions africaines et amazoniennes coexistent depuis trois siècles, des populations résilientes font face aux inondations, à la sécheresse, à la pollution et à l’isolement.
Cette expérience de terrain a guidé mes interventions lors de forums internationaux : au Forum mondial de l’eau à Dakar en 2022, à l’Organisation des Nations unies à New York en 2023, plus récemment lors de la Conférence des Nations unies sur l’océan à Nice, et lors de la COP30 à Belém. À chacune de ces occasions, j’ai défendu l’idée que l’adaptation climatique ne se décrète pas depuis les capitales mais se construit sur place, là où les ruptures se produisent.
Le cas de la Guyane illustre ce point : la rupture est tangible et locale. Les réponses doivent donc prendre en compte les savoirs des populations, les pratiques de gestion de l’eau et les contraintes logistiques propres à ces territoires.
Enjeux et pistes d’action
Sur le terrain, les solutions exigent une approche combinant court et long terme. À court terme, garantir l’accès à une eau potable sécurisée pour les usages domestiques et sanitaires est prioritaire. À moyen et long terme, il faudra penser des infrastructures adaptées aux spécificités fluviales, renforcer la surveillance de la pollution liée à l’orpaillage et soutenir des programmes d’adaptation basés sur les connaissances locales.
La situation expose également une dimension constitutionnelle et républicaine : la capacité de l’État à assurer l’égalité d’accès aux services essentiels dans des territoires éloignés est mise à l’épreuve. Les habitants du Maroni, par leur quotidien et leur résilience, offrent un terrain d’alerte et d’enseignement sur la manière dont la France et d’autres pays devront penser l’adaptation aux changements climatiques.
Sans réponse soutenue et adaptée, la convergence des phénomènes — sécheresse, pollution, isolement — risque d’accentuer les fragilités déjà présentes dans ces territoires, avec des conséquences sociales et sanitaires durables.