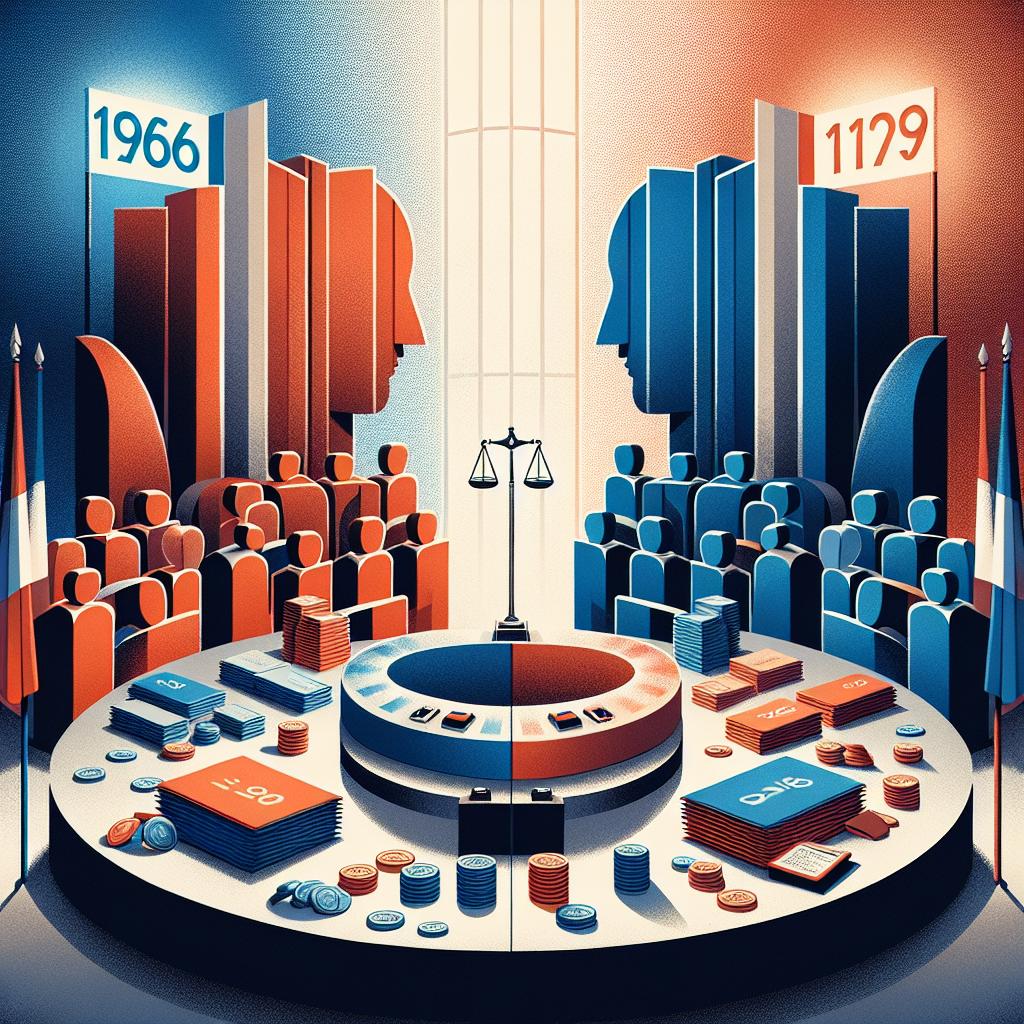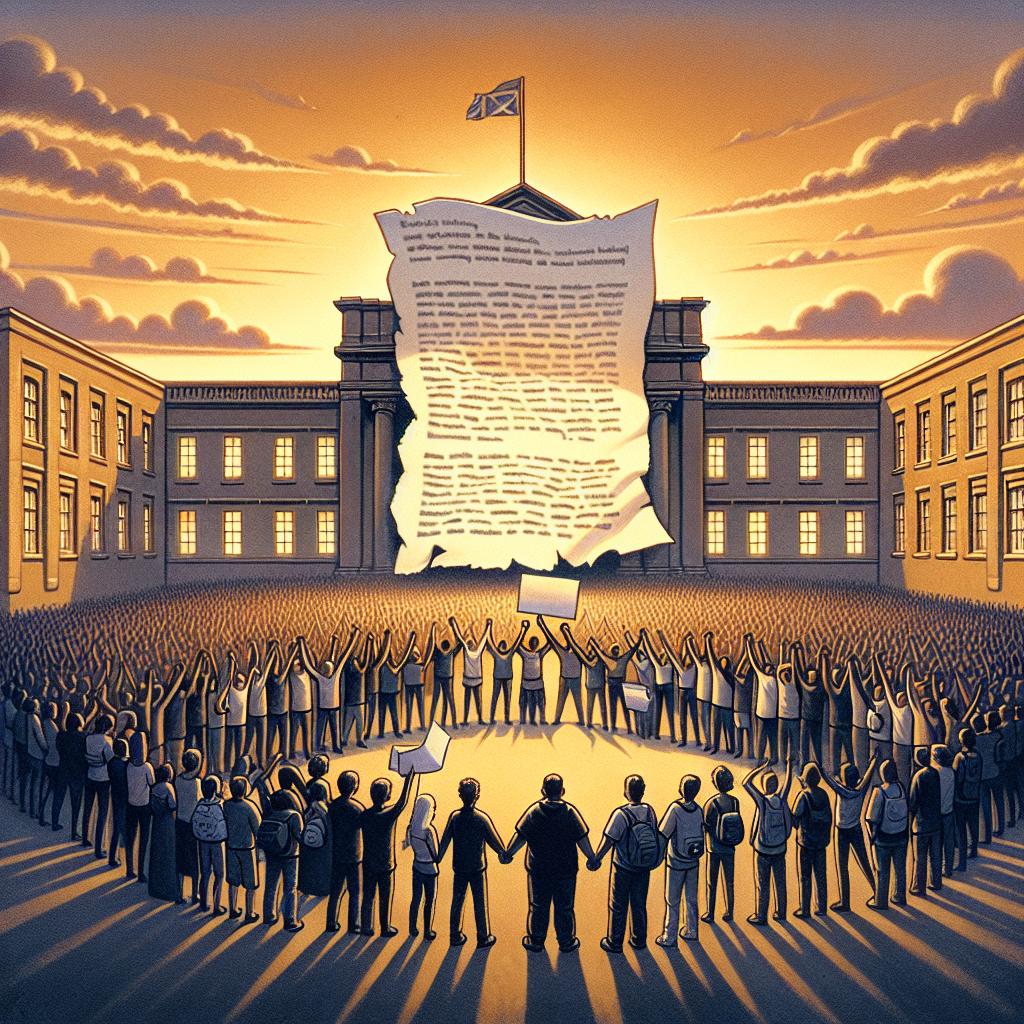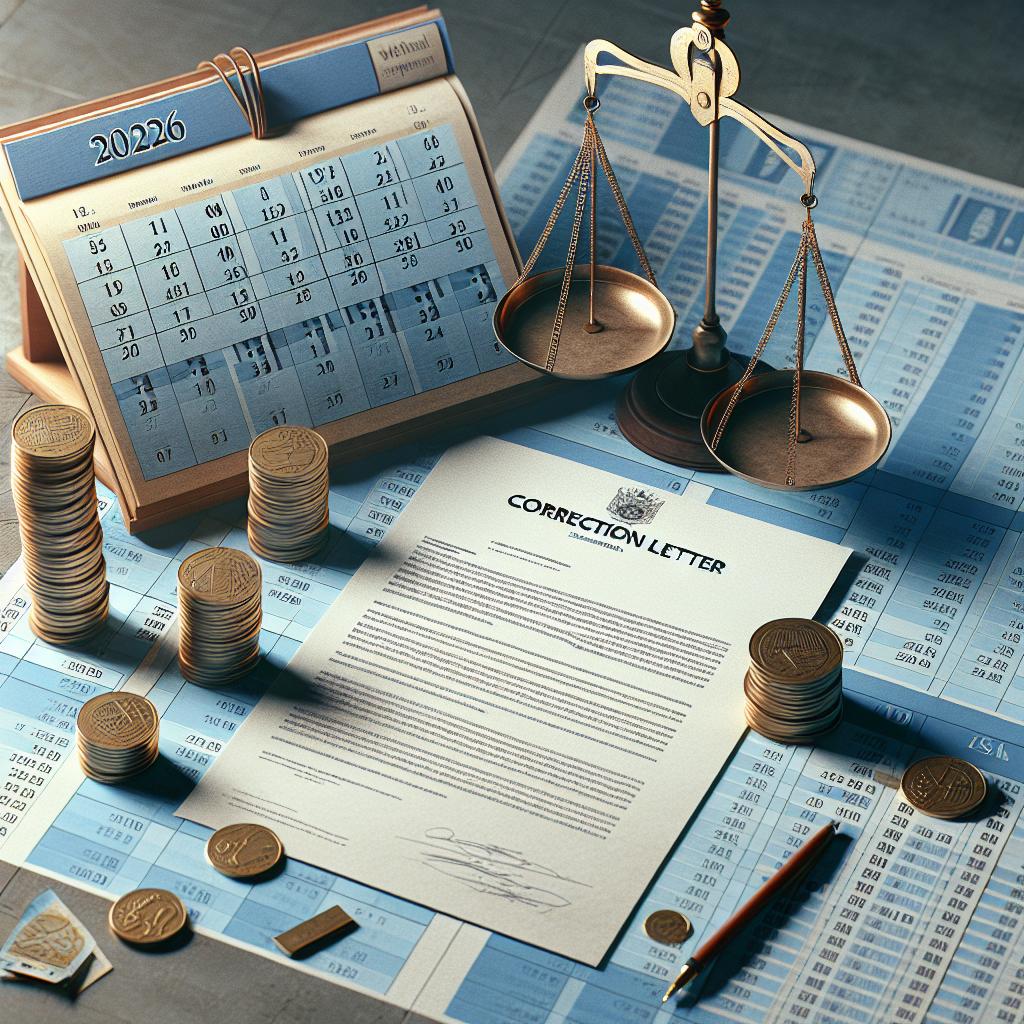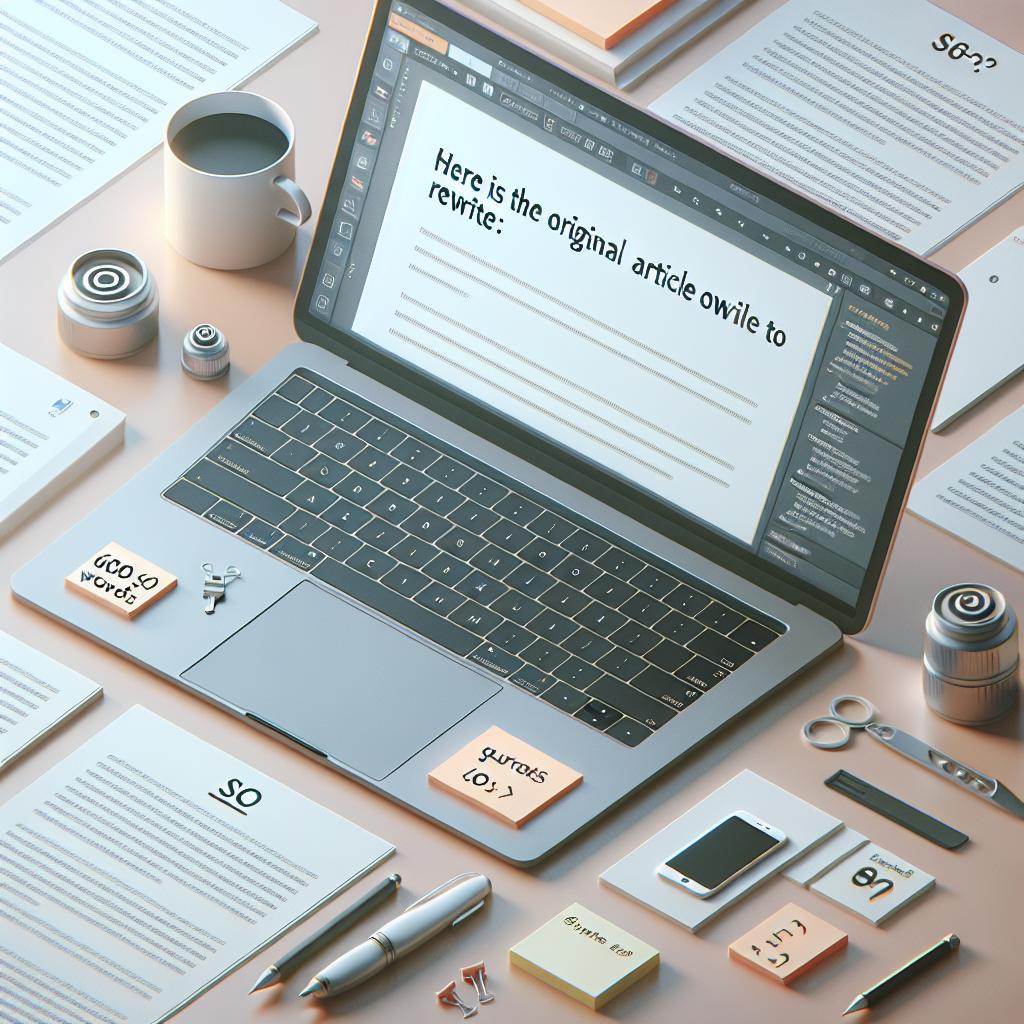Les propos d’Emmanuel Macron visant les consommateurs « bourgeois des centres-villes », accusés de financer le narcotrafic, ont déclenché depuis plusieurs jours une vive polémique. Plus qu’un simple débat sur le langage présidentiel, cette rhétorique interroge la façon dont la société identifie les causes du trafic de stupéfiants et oriente la réponse publique.
De la stigmatisation individuelle au détournement des enjeux structurels
Réduire le trafic à une responsabilité individuelle de la « clientèle » revient à enfermer la question dans une logique morale simple : faute, culpabilité, responsabilité personnelle. Certes, sans demande il n’y a pas de marché. Mais cantonner l’analyse à ce seul constat masque des déterminants sociaux, économiques et politiques qui façonnent à la fois l’offre et la demande.
Pointer les usagers implique aussi de déplacer le regard : au lieu d’examiner les conditions qui rendent la consommation possible ou tolérable, on concentre l’effort sur la répression et la culpabilisation. Ce choix rhétorique a pour effet de rendre invisibles des facteurs de long terme — fragilisation des liens sociaux, précarité économique, isolement, injonction à la performance — qui traversent l’ensemble des catégories sociales et contribuent à des usages parfois présentés comme des palliatifs face à un réel perçu comme trop lourd.
Consommation et contexte : une interdépendance systémique
La consommation ne peut être dissociée du contexte qui l’entoure. Quand la parole publique polarise sur la morale individuelle, elle omet la palette d’éléments qui influent sur les comportements : accessibilité des soins, conditions de travail, politiques publiques d’insertion, santé mentale, et la manière dont la société traite la souffrance et la dépendance.
Dire que « sans clientèle, il n’existe pas de marché » est une évidence économique. Mais l’usage de cette évidence comme argument central pour expliquer ou résoudre le trafic évince la responsabilité collective et politique. Il évite les questions difficiles : quelles politiques sociales réduisent la vulnérabilité ? Quels dispositifs de prévention et de prise en charge sont insuffisants ou mal financés ?
En focalisant l’attention sur la supposée culpabilité de certains groupes de consommateurs, on expose également les populations les plus fragiles à des effets pervers. La répression accrue tend à pousser des pratiques dans des zones moins visibles et plus dangereuses, à éloigner des personnes des dispositifs d’aide, et à accroître les risques sanitaires et sociaux.
Un précédent international et le bilan de la répression
L’histoire internationale offre un éclairage utile : la « guerre contre la drogue », lancée il y a plus de cinquante ans par Richard Nixon [aux Etats‑Unis], est souvent citée comme un cas d’école des limites de la seule répression. Des milliards ont été dépensés et de nombreuses vies ont été marquées sans que les trafics ni la disponibilité des produits ne diminuent de manière durable. Le constat, largement partagé par des experts et des bilans internationaux, est que la répression seule ne modifie ni les marchés ni les logiques d’usage.
Cette observation n’exonère personne, mais elle invite à relativiser l’efficacité des réponses fondées uniquement sur la sanction. La logique répressive peut fragiliser davantage les personnes vulnérables et aggraver les risques sanitaires, tout en échouant à tarir les circuits d’approvisionnement.
Le débat public gagnerait à distinguer deux niveaux d’analyse : d’une part, la responsabilité individuelle et, d’autre part, les mesures structurelles qui influent sur les comportements et sur l’organisation des marchés illicites. Mélanger ces registres conduit à des équations raccourcies qui ne rendent pas compte de la complexité du phénomène.
Vers une parole publique plus nuancée
La polarisation du discours sur la consommation et la stigmatisation de groupes sociaux rendent la discussion politique moins efficace. Au-delà de l’émotion suscitée par des formules choc, la société doit engager une réflexion sur les finalités et les effets des politiques menées : réduction des risques, prévention, accès aux soins, et dimensions socio‑économiques qui sous‑tendent les usages.
La façon dont s’exprime le pouvoir politique a une influence sur l’orientation des mesures et sur la perception publique. Un cadrage qui privilégie la compréhension des déterminants et la prévention plutôt que la seule culpabilisation individuelle semble, selon les constats récurrents dans le débat public, plus à même de limiter les dommages sociaux et sanitaires associés aux trafics et à la consommation.
Les réactions provoquées par les propos récents illustrent la difficulté à articuler langage politique, réalité sociale et efficacité des politiques publiques. Elles soulignent surtout l’enjeu principal : traiter un phénomène complexe par des approches elles‑mêmes complexes, plutôt que par des raccourcis moraux qui tendent à simplifier à l’excès un problème multiforme.