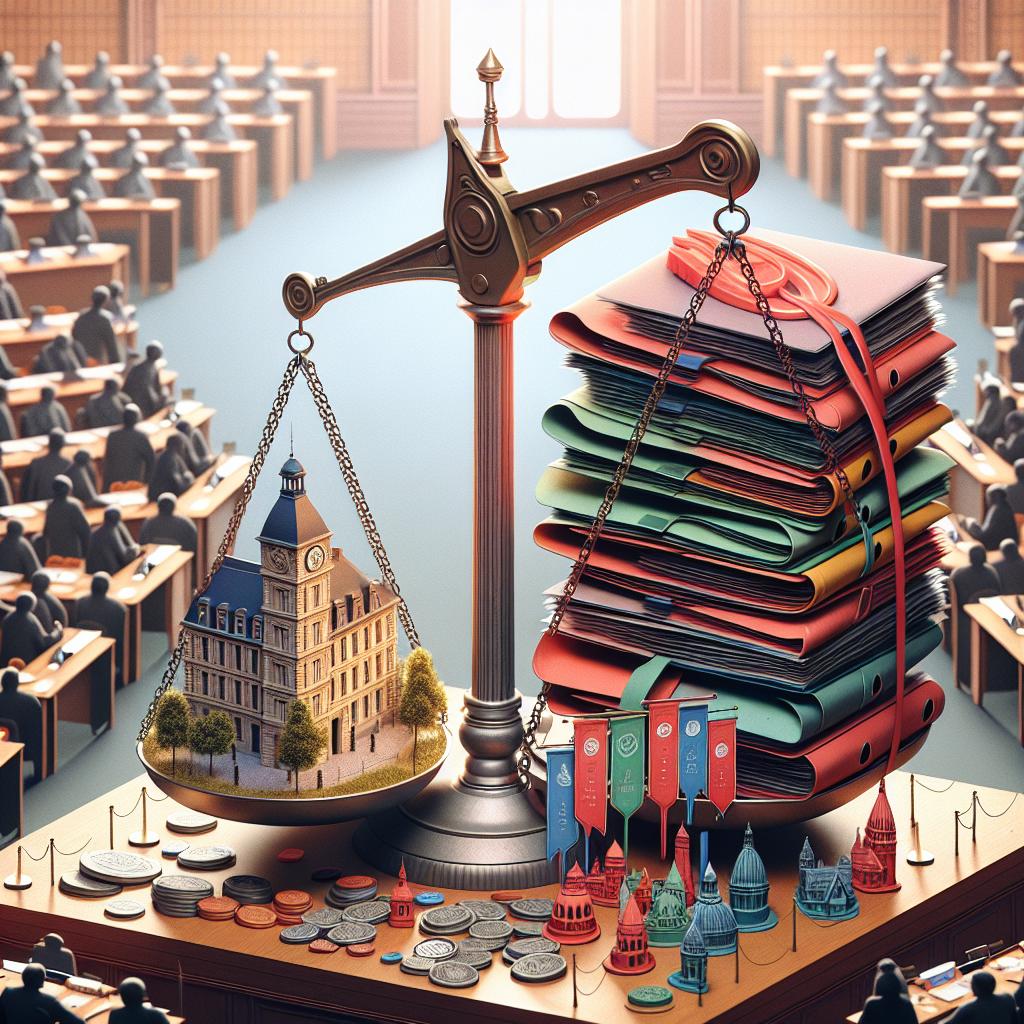La majorité de droite et du centre au Sénat a rejeté, vendredi 28 novembre, une proposition socialiste visant à instaurer un emprunt « forcé » auprès des contribuables les plus riches. Cette initiative, dernière en date des tentatives socialistes pour dégager des ressources supplémentaires au budget après l’échec d’autres pistes de justice fiscale, n’a pas recueilli l’adhésion de la chambre haute.
Le dispositif proposé
Le texte, soumis sous la forme d’un amendement par Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, prévoyait la mise en place d’un « emprunt obligatoire d’une durée de cinq ans » à taux zéro. Il visait environ 20 000 contribuables parmi les plus aisés, qui auraient dû avancer une somme remboursable par l’État sans percevoir d’intérêts pendant la période.
Selon la présentation faite par son auteur, ces ressources auraient permis de financer des politiques publiques jugées prioritaires. Le mécanisme s’appuyait sur l’idée d’un effort temporaire et ciblé des ménages les mieux dotés, en échange d’un remboursement intégral à l’issue des cinq années prévues.
Argumentaire et justification
Patrick Kanner a défendu l’amendement en insistant sur la contribution exceptionnelle demandée aux foyers concernés. « On demande aux plus fortunés de nos concitoyens, les 0,05 % de contribuables qui sont visés par ces amendements, de contribuer à ces politiques publiques dans un élan de patriotisme fiscal », a-t-il déclaré, soulignant le caractère symbolique et solidaire de la mesure.
L’argument repose sur une logique de redistribution exceptionnelle face à des besoins jugés urgents. Le dispositif se présentait comme une alternative à des mesures fiscales permanentes, en proposant une contribution temporaire sans rendement financier pour les contributeurs ciblés.
Critiques de la majorité et du rapporteur général
Du côté de la majorité sénatoriale, l’accueil a été froid. Jean-François Husson, rapporteur général du budget (Les Républicains), a qualifié l’amendement d’« objet qui arrive un peu comme une météorite » et l’a jugé « très amateur », moquant son caractère improvisé et son absence de préparation technique.
Plusieurs membres de la majorité ont pointé des difficultés pratiques : identification des contribuables visés, modalités juridiques d’un prélèvement obligatoire, risques de contentieux et impacts potentiels sur la confiance des investisseurs et des contribuables aisés. Ces réserves ont pesé dans le refus global du texte.
La position du gouvernement
La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a rappelé que la France ne connaissait pas les mêmes contraintes qu’en 1983, date d’un précédent emprunt forcé évoqué au cours des débats. « La France aujourd’hui n’a pas de difficultés pour lever de l’argent », a-t-elle affirmé, estimant que l’opération ne répondrait pas à un enjeu de liquidités pour l’État.
La ministre a toutefois reconnu un second angle de lecture : au-delà des questions de trésorerie, une telle mesure pourrait relever d’un enjeu de cohésion nationale et d’un partage de l’effort face à des défis comme la défense. Néanmoins, elle a exprimé deux objections majeures à l’amendement socialiste : faut‑il imposer cette contribution de manière contrainte, et faut‑il la prévoir sans aucune rémunération pour les participants ?
Amélie de Montchalin a suggéré qu’une rémunération, si elle devait être retenue, pourrait se rapprocher du taux du Livret A, cité à 1,7 % lors des débats, plutôt que d’un taux nul.
Retrait et conséquences politiques
Sous la pression des critiques et à l’issue des échanges, Patrick Kanner a finalement retiré son amendement. Il a salué le débat suscité par sa proposition, estimant avoir « ouvert une porte », expression qu’il a utilisée pour signifier l’importance, selon lui, d’engager la réflexion sur de nouvelles contributions pour financer les politiques publiques.
Ce retrait met fin, pour l’heure, à cette piste précise de mobilisation de recettes. Il illustre en tout cas la difficulté d’introduire par amendement des mécanismes fiscaux atypiques sans large consensus parlementaire et sans analyse technique approfondie.
La séance au Sénat montre que, même si des idées de justice fiscale continuent d’être débattues, leur faisabilité politique et juridique demeure un obstacle majeur lorsque la majorité n’y adhère pas.