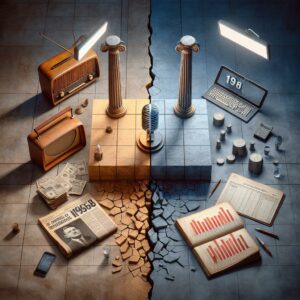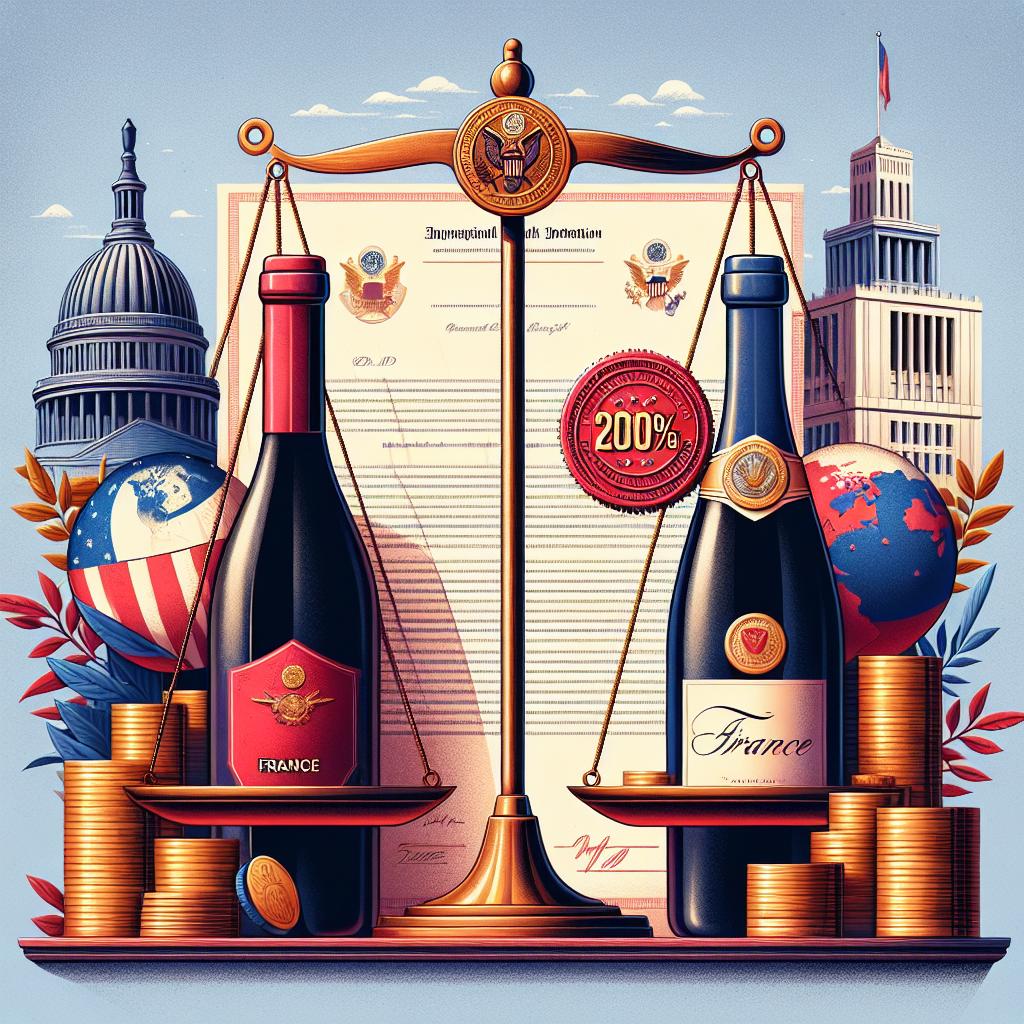Le 8 septembre s’annonce comme une réplique parlementaire du 9 juin 2024, date à laquelle Emmanuel Macron avait annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale. La perspective qu’une majorité — même relative — accorde sa confiance au gouvernement dirigé par François Bayrou paraît, selon le contexte politique actuel, peu probable. Ce scénario laisse entrevoir un nouveau séisme institutionnel piloté par l’exécutif, susceptible d’aggraver la période de tensions que traverse le pays.
Contexte institutionnel et usages constitutionnels
Jusqu’à présent, les institutions de la Ve République ont montré une certaine robustesse. Cette stabilité a toutefois reposé sur un usage intensif d’instruments constitutionnels conçus pour traiter des épisodes ponctuels de crise, et non des situations durables. L’exemple le plus cité est l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, dont le recours répété a marqué les dernières années de gouvernance.
Ces outils restent théoriquement mobilisables jusqu’en mai 2027, mais leur emploi répété a fini par les user et par alimenter un malaise démocratique latent. Plutôt que d’apaiser les tensions, certaines pratiques institutionnelles renforcent le sentiment d’un décalage entre les décisions prises et les attentes d’une partie de l’opinion publique.
Blocage politique et déficit de compromis
La configuration politique actuelle souffre d’un manque apparent de culture du compromis comparable à celle observée dans certains États européens. Faute d’un tel mécanisme de conciliation, les postures partisanes semblent figées, rendant la gouvernabilité du pays plus difficile. Dans ce contexte, une réforme constitutionnelle d’ampleur apparaît inenvisageable à court terme.
Parallèlement, et malgré des promesses reformistes tenues à plusieurs reprises au fil des gouvernements, le président de la République et le premier ministre n’ont pas réussi à instaurer la représentation proportionnelle pour l’élection à l’Assemblée nationale. Cette absence de mise en œuvre a contribué, pour certains observateurs, au discrédit de la parole publique lorsque discours et actes semblent en décalage.
Des leviers possibles pour « respirer » démocratiquement
La Constitution de 1958 conserve toutefois une certaine plasticité. Elle offre, sans en garantir l’efficacité, plusieurs leviers susceptibles d’apporter une respiration démocratique si l’exécutif et les forces politiques acceptent de les activer, partiellement ou simultanément.
Parmi les leviers évoqués dans le débat public figure le « retour aux urnes » : la dissolution de l’Assemblée et l’organisation d’élections anticipées peuvent permettre de redéfinir la majorité parlementaire. Ce choix comporte des bénéfices potentiels, comme la clarification de la situation politique, mais aussi des risques — notamment une nouvelle période d’instabilité et de polarisation.
Un autre axe consiste à réduire le recours aux dispositions d’exception, comme l’article 49.3, afin de restaurer un mode de décision parlementaire plus ouvert. Limiter l’emploi de ces dispositifs demanderait une volonté politique forte et, dans certains cas, des pratiques de gestion des majorités plus consensuelles.
Enfin, le renforcement du dialogue parlementaire — par des travaux de commission, des négociations multipartites ou des mécanismes de concertation élargis — peut constituer une troisième voie. Ces procédures n’imposent pas de modification constitutionnelle majeure, mais exigent du temps et un investissement politique pour produire des résultats tangibles.
Conséquences et équilibres à trouver
Chacune de ces options présente des avantages et des inconvénients. Le choix entre elles dépendra autant de calculs politiques immédiats que d’une réflexion sur la légitimité à long terme des institutions. À court terme, la priorité pour les acteurs publics semble être d’éviter que l’usage répété de moyens constitutionnels d’exception n’alimente davantage le sentiment d’une démocratie déconnectée.
La période à venir exigera des décisions mesurées. Qu’elles passent par des élections anticipées, par une réforme des pratiques parlementaires ou par un renforcement du dialogue, ces démarches requièrent l’adhésion d’acteurs politiques prêts à accepter des compromis. Sans cela, les tensions institutionnelles risquent de perdurer, au détriment de la capacité à gouverner de manière stable et lisible.