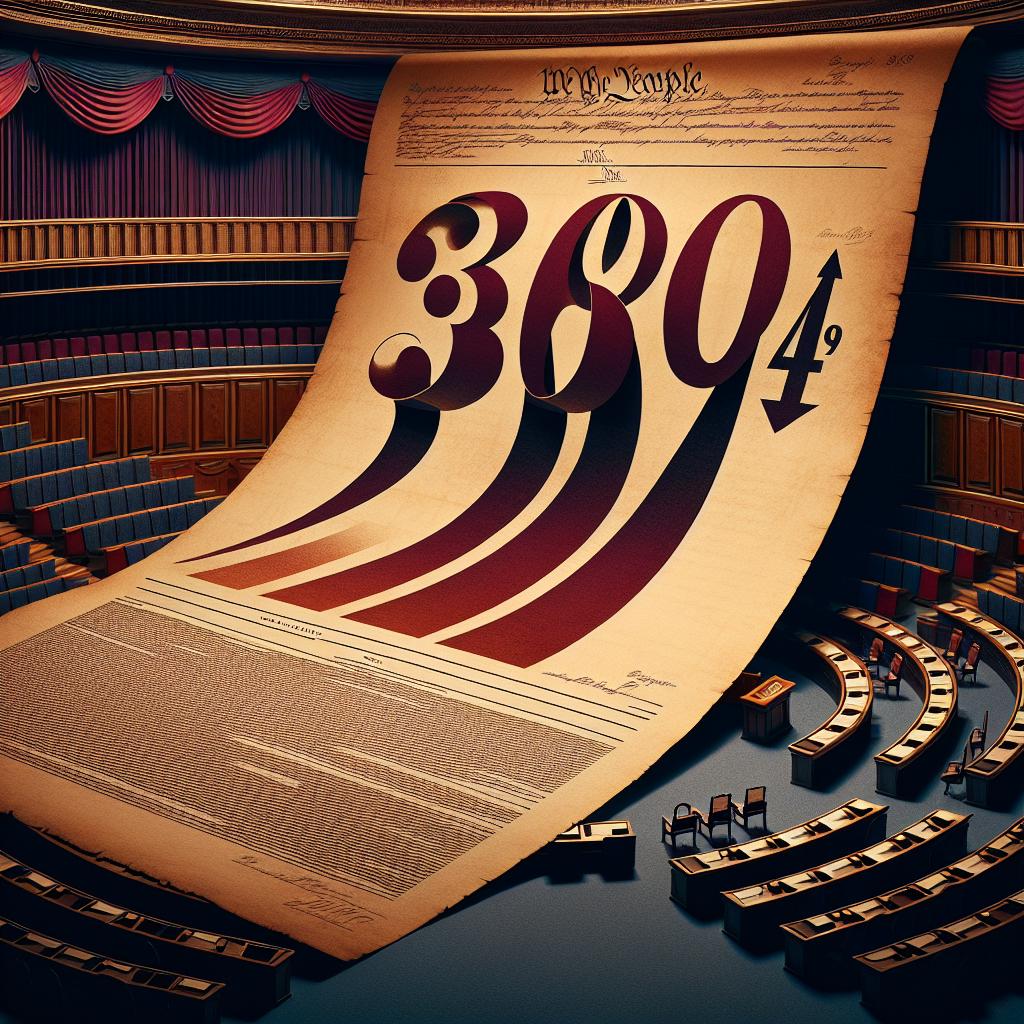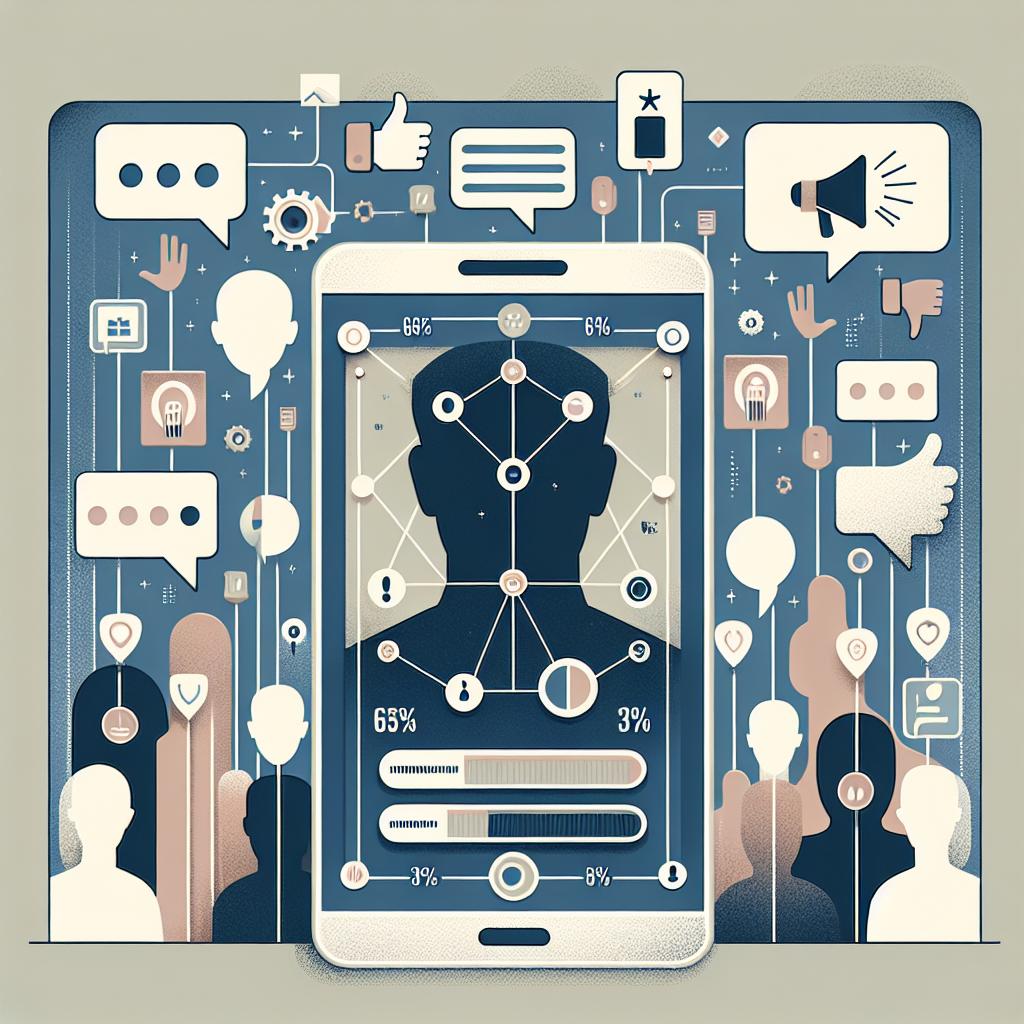Le 4 avril 1958, Le Monde relayait une bizarrerie arithmético-constitutionnelle : l’Assemblée nationale venait d’adopter, par 308 voix contre 206, un projet de révision de la Constitution, sans que la majorité requise des trois cinquièmes soit manifestement atteinte.
Un arrondi décisif en 1958
Le cœur du problème tenait à un détail numérique. Le calcul de la majorité des trois cinquièmes, appliqué au nombre des votants, donnait 308,4 voix. Or, les députés ne sont pas « fractionnables » : on ne peut pas comptabiliser 0,4 d’un vote. Il se posa alors la question d’un arrondi à l’entier supérieur (309) ou inférieur (308).
Pour trancher, la pratique retint l’arrondi au chiffre immédiatement supérieur afin de disposer d’une majorité indiscutable. Cette solution visait à lever toute contestation juridique possible sur la validité d’une révision constitutionnelle adoptée de justesse.
Le règlement de l’Assemblée et la règle de l’arrondi
Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale précise aujourd’hui le traitement des fractions dans plusieurs cas. S’agissant des motions de censure, il est prévu que « le dépôt des motions de censure est constaté par la remise au président de l’Assemblée d’un document portant l’intitulé “Motion de censure”, suivi de la liste des signatures du dixième au moins des membres de l’Assemblée. Ce dixième est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus avec, en cas de fraction, arrondissement au chiffre immédiatement supérieur ».
Autrement dit, lorsqu’un dixième des membres est requis pour déclencher une procédure, toute fraction conduit à arrondir au nombre entier suivant. La conséquence pratique est de rendre certaines procédures — comme la censure — légèrement plus difficiles à saisir, en exigeant une majorité nette plutôt qu’un simple seuil fractionnaire.
La même logique s’applique lorsque l’Assemblée décide de siéger en comité secret à la demande d’un dixième de ses membres : la règle de l’arrondi vise à garantir une assise numérique claire pour ces décisions sensibles.
Exemples récents : la révision constitutionnelle de 2008 et la loi organique de 2013
La curiosité des trois cinquièmes et de l’arrondi se retrouve lors de la révision constitutionnelle de 2008. Dans ce cas, le calcul retint 537,59 voix pour atteindre les trois cinquièmes, valeur qu’on arrondit mécaniquement à 538. Le texte fut finalement adopté par 539 voix, soit une marge de deux voix au‑dessus du seuil arrondi — ces voix étant, selon le compte rendu, celles de Bernard Accoyer et de Jack Lang.
Ce scénario illustre la manière dont un simple chiffre après la virgule peut influer sur l’issue d’un vote à haute portée institutionnelle : l’arrondi à l’entier supérieur augmente le niveau requis et impose une majorité clairement affirmée.
La loi organique du 6 décembre 2013, relative à l’application de l’article 11 de la Constitution, reprend le même principe de calcul. Elle dispose : « Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de loi, que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus (…) arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction. »
Ainsi, tant pour le déclenchement de procédures parlementaires que pour la validation préalable par le Conseil constitutionnel, l’arrondi au supérieur fait office de garde‑fou numérique.
Au final, la question de l’arrondi n’est pas une simple curiosité mathématique : elle structure la manière dont sont arrêtés les seuils de légitimité parlementaire. En imposant l’arrondi à l’entier supérieur, les textes privilégient la clarté et la robustesse des majorités, au prix d’un seuil formellement plus exigeant lorsqu’une fraction apparaît.