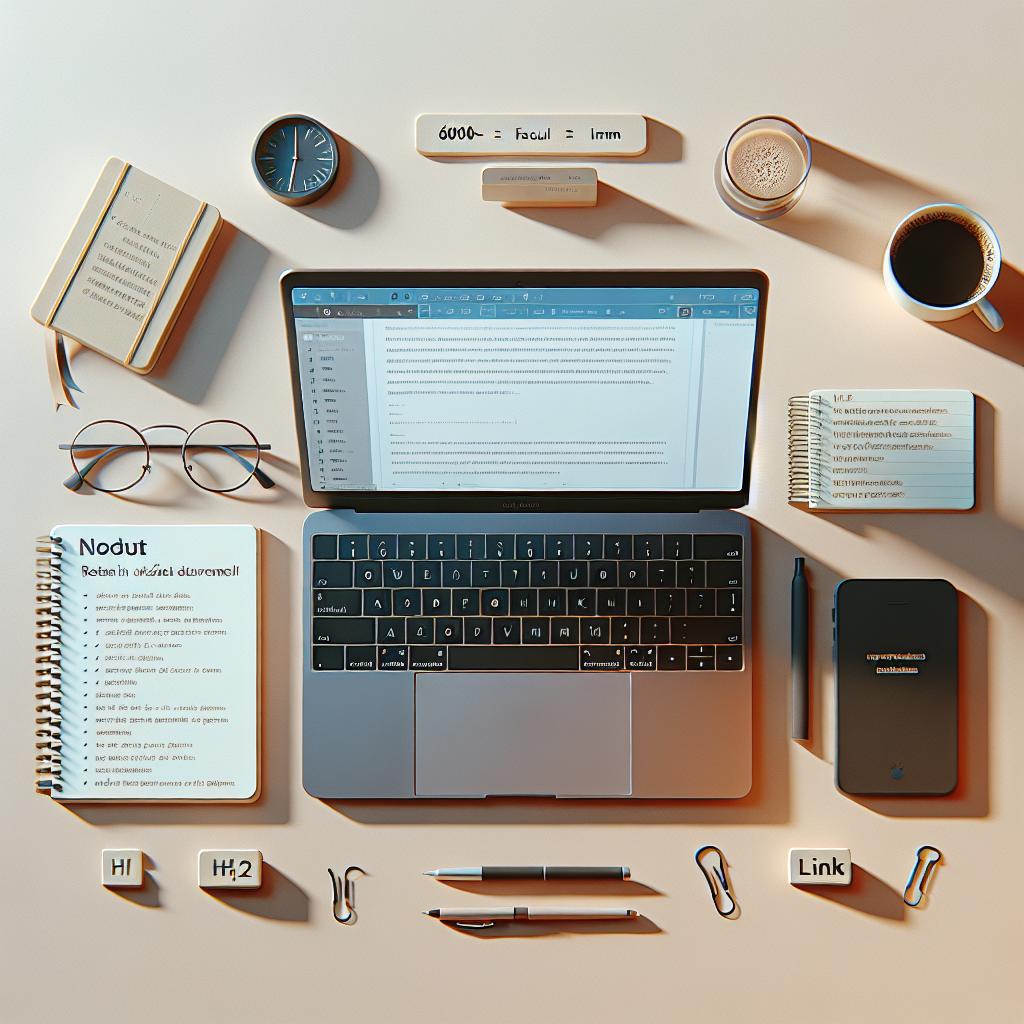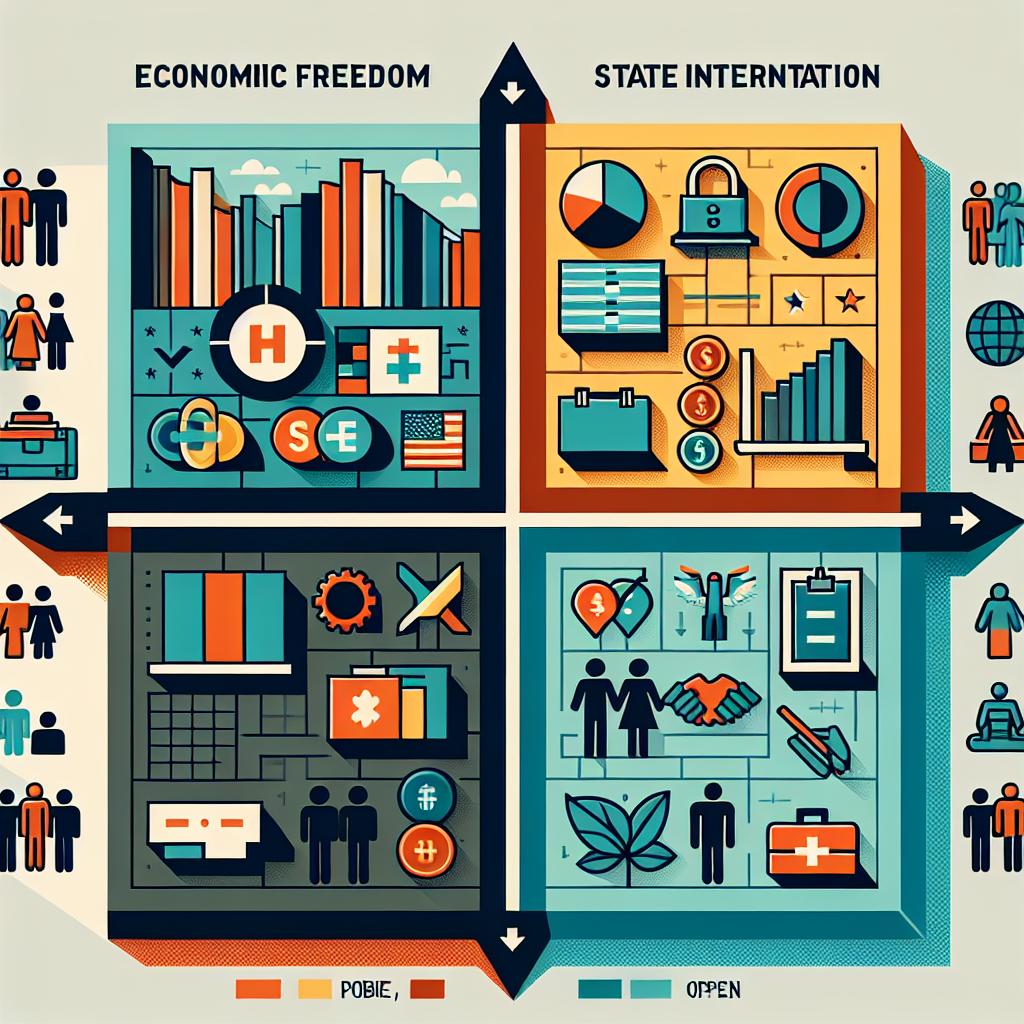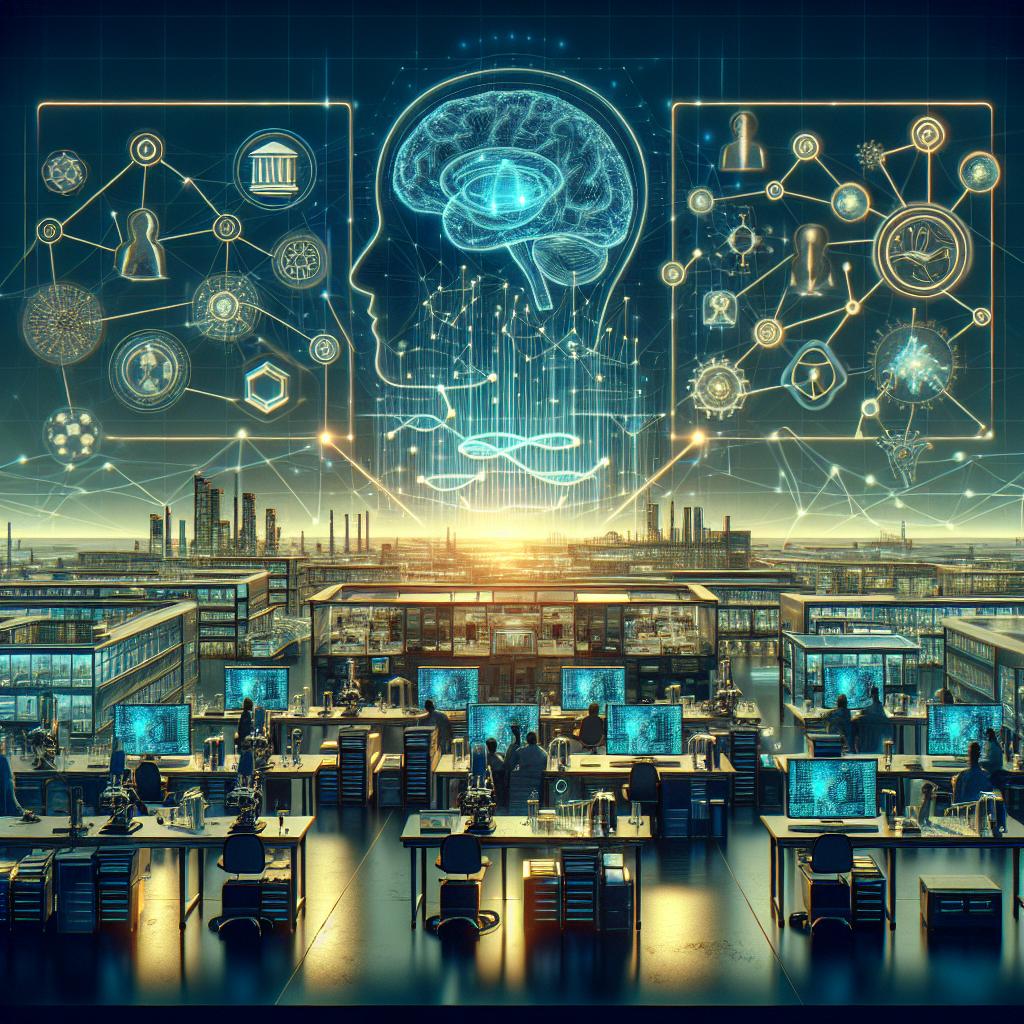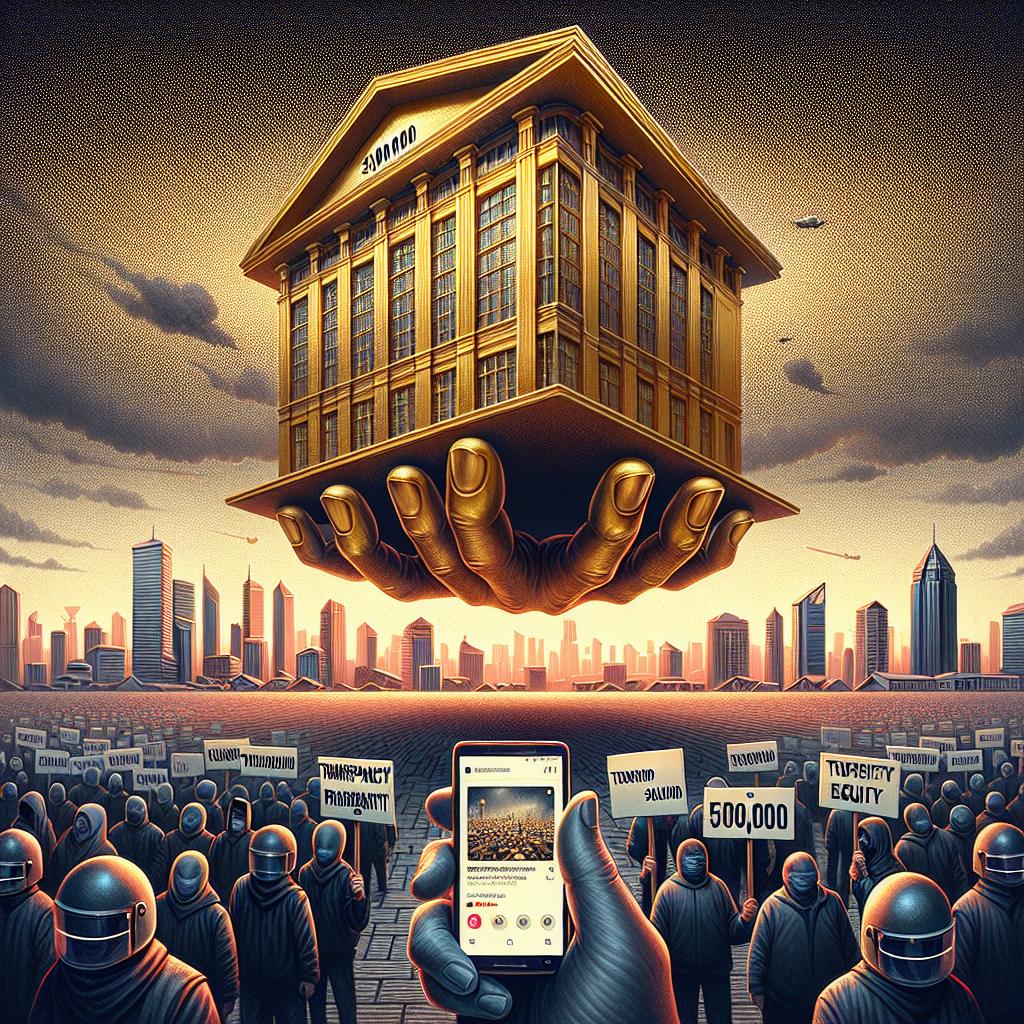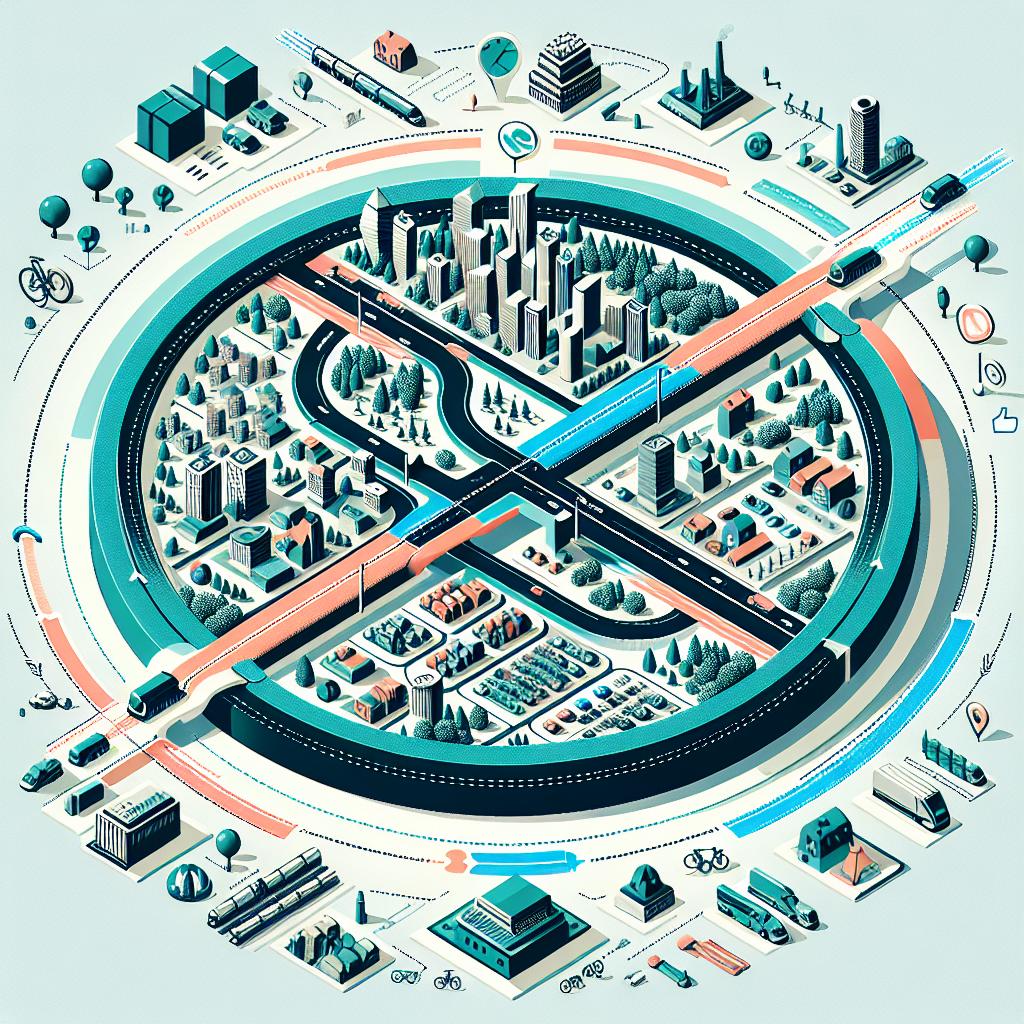Le perchoir : pouvoirs et mode d’élection
C’est la rentrée pour l’Assemblée nationale : une nouvelle session ordinaire s’est ouverte le mercredi 1er octobre après onze semaines de pause. Conformément au règlement, cette ouverture est l’occasion de renouveler certains postes-clés qui conditionnent le fonctionnement de la chambre basse du Parlement.
Le président de l’Assemblée nationale, traditionnellement appelé « le président du perchoir », est le quatrième personnage de l’État et pilote l’organisation du travail parlementaire. L’article 52 du règlement de l’Assemblée lui attribue notamment le pouvoir d’« ouvrir la séance, diriger les délibérations, faire observer le règlement, maintenir l’ordre et [de] pouvoir à tout moment suspendre ou lever la séance ». En séance publique, il peut être remplacé par l’un des six vice-présidents.
Le président est également consulté par le président de la République en cas de dissolution ou de mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution. Il peut saisir le Conseil constitutionnel — il nomme trois des neuf membres — avant la promulgation d’une loi ou d’un traité susceptible d’être contraire à la Constitution. Il préside aussi le congrès du Parlement à Versailles en cas de révision constitutionnelle ; c’est ce rôle qui a été exercé par Yaël Braun‑Pivet lors du vote sur la constitutionnalisation de l’interruption volontaire de grossesse en 2024.
L’élection du président a lieu au début de la législature, « à scrutin secret à la tribune ». Chaque député dépose un bulletin dans une urne placée face à l’hémicycle. Le scrutin peut comprendre un, deux ou trois tours : la majorité absolue des députés votants est requise aux deux premiers tours ; au troisième tour, le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu (en cas d’égalité, l’ancienneté d’âge départage).
Réélue en juillet 2024 après la dissolution et les législatives anticipées, Yaël Braun‑Pivet ne voit pas son mandat remis en jeu à cette rentrée, contrairement aux autres membres du bureau.
Le bureau : composition, répartition et mode de nomination
Le bureau de l’Assemblée constitue la plus haute autorité collégiale de la chambre. Chargé de l’organisation et du fonctionnement interne, il peut, entre autres, soumettre des sanctions à l’encontre de députés ou proposer la levée d’une immunité parlementaire.
Le bureau compte 22 membres : le président, six vice‑présidents, trois questeurs et douze secrétaires. Le règlement précise que ces postes doivent, autant que possible, reproduire la configuration politique de l’Assemblée et respecter la parité femmes‑hommes, sans caractère strictement contraignant.
Pour répartir les fonctions, un système de points est utilisé : les postes se voient attribuer des points qui totalisent 35,5. Les groupes politiques se partagent ces 35,5 points proportionnellement à leurs effectifs. À titre d’exemple, un groupe comptant 123 députés (comme le Rassemblement national, dans la configuration évoquée) obtiendrait 8 points ; Ensemble pour la République 6 points ; La France insoumise et le Parti socialiste 5 points chacun. Ces points permettent aux présidents de groupe de réserver des postes à leur formation, selon un ordre de choix dépendant de leur effectif.
Si les présidents de groupe s’accordent à l’unanimité sur une liste, les candidats proposés sont nommés. En l’absence d’accord — cas survenu en 2022 et 2024 et mentionné pour la présente rentrée —, un scrutin plurinominal majoritaire est organisé dans l’hémicycle.
L’an dernier, le RN avait perdu deux postes de vice‑président à la suite d’un accord entre d’autres forces politiques ; cette année, il devrait les récupérer en raison de l’abandon du cordon sanitaire qui pesait jusque‑là contre lui.
Rôles des vice‑présidents, questeurs, secrétaires et conférence des présidents
Les six vice‑présidents suppléent le président lors des séances lorsque le titulaire du perchoir est indisponible. Le premier vice‑président appartient traditionnellement à un groupe s’étant déclaré d’opposition.
Les trois questeurs gèrent les aspects administratifs, matériels et financiers de l’Assemblée : personnel, bâtiments, restauration, régimes sociaux et pensions. Ils élaborent et exécutent le budget et décident des dépenses nouvelles. L’un des trois postes de questeur est réservé à un groupe d’opposition.
Les douze secrétaires, également membres du bureau, veillent aux opérations de vote et au bon déroulement matériel des scrutins.
La conférence des présidents fixe le calendrier des travaux (ordre du jour, dates de discussion des motions de censure, séances de questions, etc.). Elle rassemble le président de l’Assemblée, les six vice‑présidents, les présidents des commissions permanentes, les présidents de groupe, le rapporteur général de la commission des finances et le président de la commission des affaires européennes. Le gouvernement y est représenté par le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Groupes parlementaires et commissions permanentes
Les groupes politiques, formés d’au moins quinze députés, sont le porte‑voix des sensibilités au Palais‑Bourbon. Un groupe peut se déclarer d’opposition ou minoritaire ; sauf exception, le groupe le plus nombreux n’est pas obligé de se déclarer opposition. Les groupes peuvent modifier leur statut d’un jour à l’autre, ce qui rend les équilibres instables en l’absence d’une majorité nette. Les députés sans appartenance sont dits non‑inscrits.
Les groupes disposent d’un temps de parole proportionnel à leur effectif et d’une journée annuelle — de 9 heures à minuit — pour défendre leurs propositions de loi, la « niche parlementaire ». Les présidents de groupe, choisis par leurs pairs, jouent un rôle stratégique : ils siègent à la conférence des présidents et contribuent à l’établissement de l’ordre du jour.
L’Assemblée compte huit commissions permanentes : affaires culturelles et éducation, affaires économiques, affaires étrangères, affaires sociales, défense nationale et forces armées, développement durable et aménagement du territoire, finances, lois. Ces commissions examinent les textes relevant de leur compétence. Une commission spéciale peut être créée pour l’examen d’un texte à la demande du gouvernement, d’un président de commission, d’un président de groupe ou de quinze députés.
Les membres des commissions sont répartis proportionnellement entre les groupes et élisent leur propre bureau. La présidence de la commission des finances revient de droit à un membre d’un groupe s’étant déclaré d’opposition ; depuis 2022, elle est occupée par Éric Coquerel.