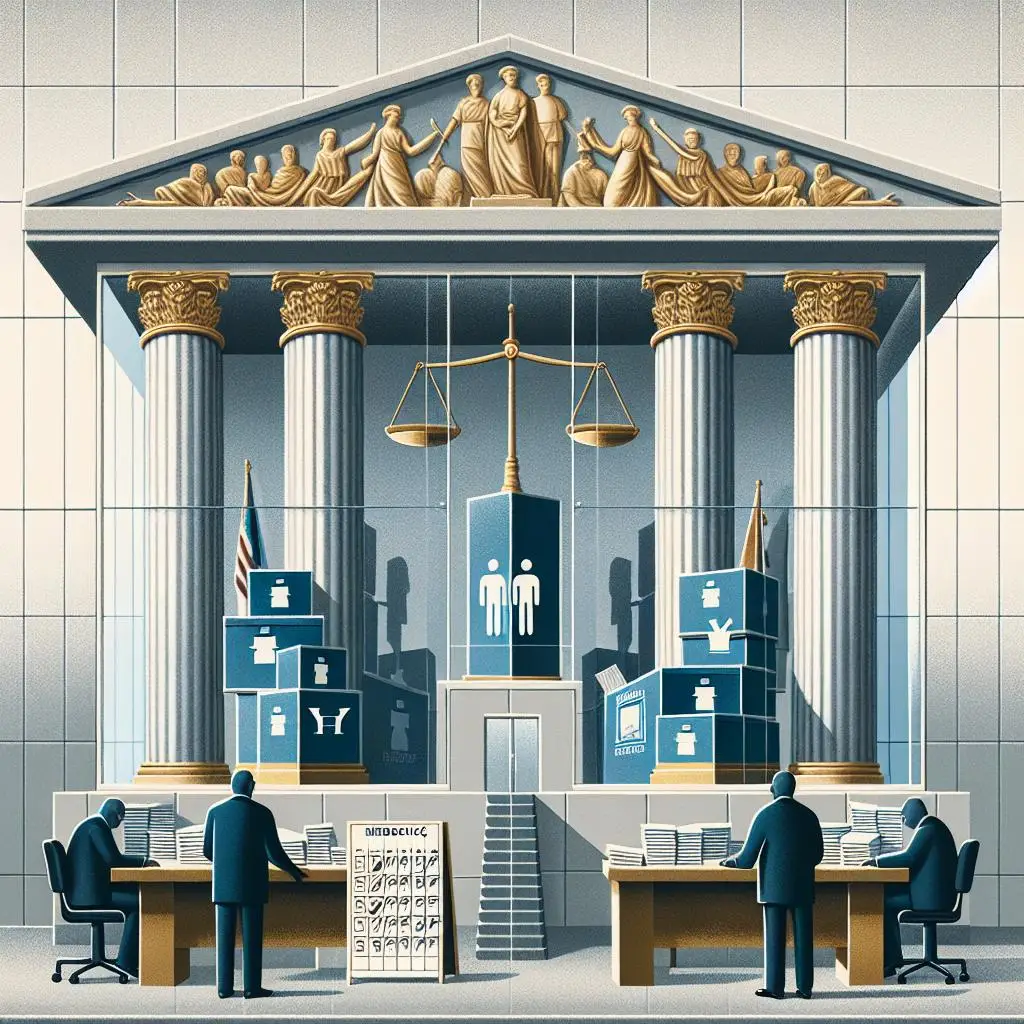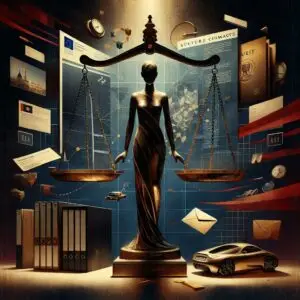Sur le plateau de LCI le 10 juillet, François Bayrou a réaffirmé sa volonté de créer ce qu’il appelle une « banque de la démocratie » : « Je suis déterminé à proposer la ‘banque de la démocratie’ », a-t-il déclaré, soulignant que « ce qui est choquant, c’est que les financements de politiques sont décidés par des banques privées. » Le Premier ministre a confirmé que ce projet, déjà inscrit dans la déclaration de politique générale du 14 janvier, pourrait être rediscuté d’ici la fin de l’année, « non sans difficulté ».
Cette proposition vise à résoudre deux problèmes récurrents du financement politique en France : les obstacles à l’ouverture d’un compte de campagne, exigé par la loi, et les refus de prêts bancaires qui touchent certains candidats et formations politiques. Le texte rappelle que, face à ces difficultés, le Rassemblement national (RN) a eu recours à des financements étrangers dans le passé, empruntant en 2014 à une « banque tchéco-russe » et en 2022 à un « établissement hongrois », illustrant ainsi les lacunes du système actuel.
Contexte et genèse du projet
L’idée de créer une « banque de la démocratie » n’est pas nouvelle dans le parcours politique de François Bayrou. L’ancien garde des Sceaux la défendait dès les premières semaines de la présidence d’Emmanuel Macron, et elle a été intégrée à son projet de loi pour la confiance dans la vie politique lorsqu’il était au ministère de la Justice en 2017.
La loi portée à cette époque, votée après la démission de Bayrou, a habilité le gouvernement à prendre des mesures en faveur de la transparence et de la régulation du financement politique. Parmi les dispositions mentionnées figure la possibilité, pour l’exécutif, de créer une structure destinée à faciliter l’accès aux financements conformes aux règles électorales. En attendant la mise en place éventuelle d’une telle banque, le texte avait prévu la désignation d’un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques pour faciliter les échanges avec les établissements financiers.
Objectifs proclamés et problèmes ciblés
Le principal objectif affiché de la « banque de la démocratie » est d’offrir une réponse institutionnelle aux situations où des acteurs politiques se trouvent exclus du circuit bancaire traditionnel pour le financement de leurs campagnes. La loi impose l’existence d’un compte de campagne ; lorsqu’un candidat ne parvient pas à en ouvrir un, cela complique la conformité légale de sa campagne et peut remettre en cause sa participation électorale.
De plus, les refus de prêts bancaires, parfois motivés par des critères commerciaux ou de réputation, peuvent contraindre certains partis à se tourner vers des solutions alternatives, y compris des financements étrangers. Les exemples cités — emprunts en 2014 et en 2022 — servent à illustrer le risque de contournement du cadre national lorsque l’accès au crédit est bloqué.
Les partisans du projet estiment qu’une structure publique ou adossée à l’État pourrait garantir l’égalité d’accès au financement pour l’ensemble des formations et des candidats, tout en respectant les exigences légales et de transparence imposées aux campagnes électorales. Les opposants, quant à eux, craignent des difficultés pratiques et juridiques ainsi que des polémiques sur l’indépendance d’un tel organisme par rapport au pouvoir politique. Le Premier ministre a d’ailleurs évoqué la possibilité de rediscuter le dossier, en reconnaissant implicitement que sa mise en œuvre rencontrerait des obstacles.
Parmi les défis attendus figurent des questions de nature juridique (cadre de création, statut exact de la structure), opérationnelle (mise en place de mécanismes de prêts et de garanties) et politique (acceptabilité par les acteurs concernés et perception d’impartialité). Le texte initial de 2017 avait tenté de prévoir une étape transitoire avec la médiation du crédit, sans pour autant aboutir à la création immédiate d’une banque dédiée.
La réactivation du sujet par François Bayrou et sa confirmation par le Premier ministre relancent donc un débat ancien sur la meilleure manière d’articuler souveraineté démocratique et pratiques bancaires dans le financement des campagnes. Le calendrier évoqué — une rediscussion possible d’ici à la fin de l’année — laissera le temps aux autorités et aux parties prenantes d’examiner les implications concrètes du projet, mais aussi d’identifier les obstacles juridiques et politiques à surmonter.
En l’état, la proposition reste un engagement politique inscrit dans des déclarations publiques et dans une précédente habilitation législative ; sa traduction en réalité opérationnelle dépendra des arbitrages à venir et des modalités précises qui seront retenues, si elles sont formellement proposées et adoptées.