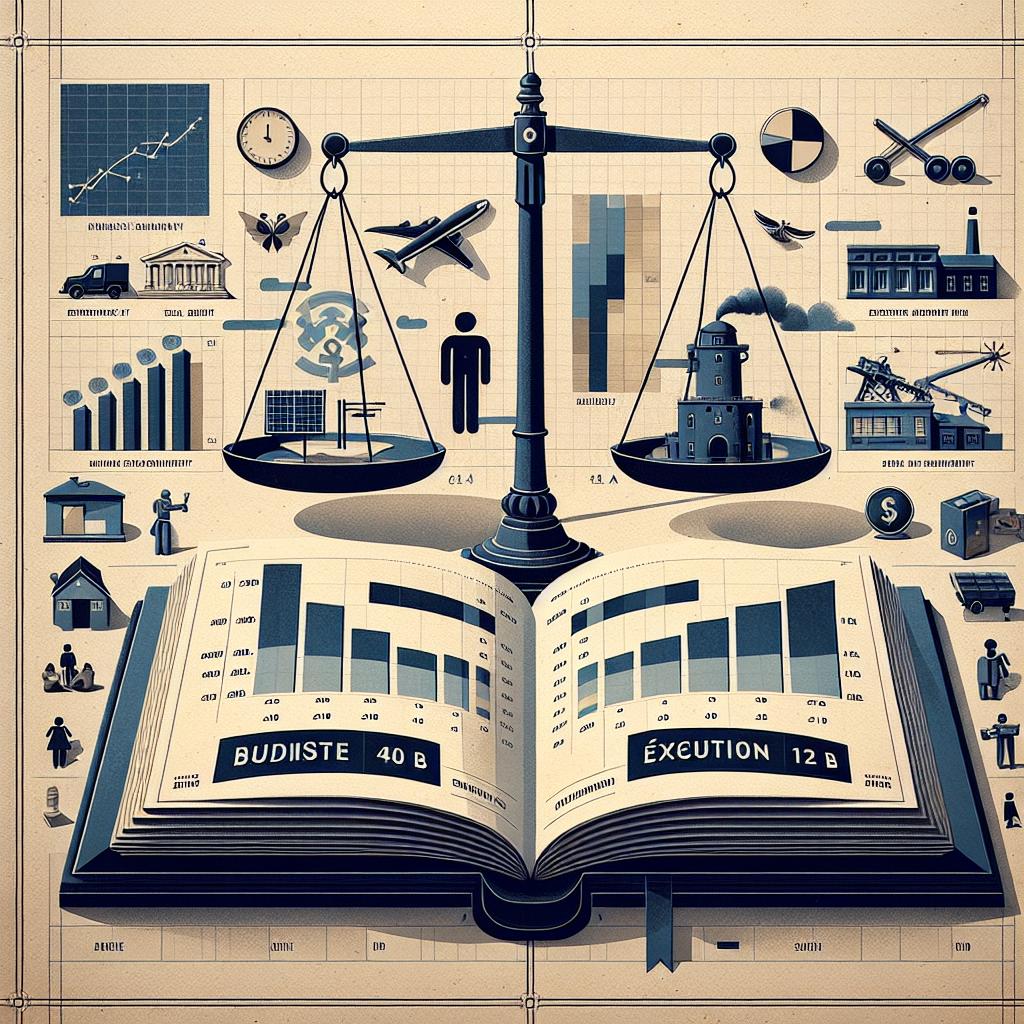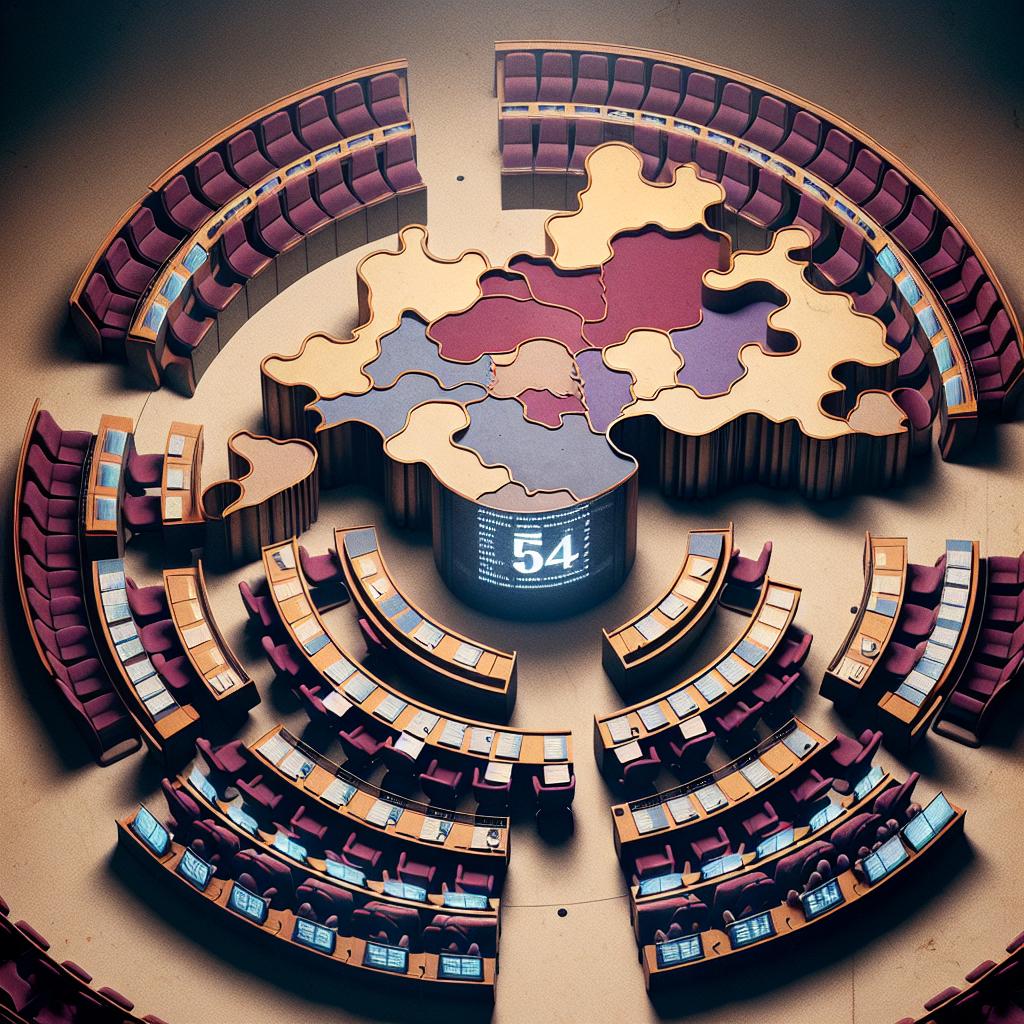À l’approche probable de la chute du gouvernement Bayrou, l’enjeu dépasse la simple désignation d’un nouveau locataire à Matignon : il s’agit d’éviter la répétition d’erreurs de pilotage économique. Depuis un an, la stratégie officielle repose sur la promesse d’un effort massif de réduction des dépenses publiques — « plus de 40 milliards par an » — destiné à ramener les comptes à l’équilibre d’ici 2030.
Or, les documents adressés à la Commission européenne pour 2025 racontent une autre réalité : les économies effectivement prévues sont beaucoup plus modestes, autour de 12 milliards. Le budget voté en février n’a pas intégré les coupes annoncées, ce qui modifie substantiellement l’ampleur de l’ajustement budgétaire.
Écart entre promesse et exécution
Cette divergence a des conséquences concrètes. Sur le plan de l’activité, le report — ou l’abandon — du plan initial peut limiter un choc négatif sur l’emploi. L’Observatoire français des conjonctures économiques estime qu’une application stricte du dispositif originel aurait entraîné une hausse importante du chômage, approximativement 500 000 personnes en deux ans.
Autrement dit, la retenue observée dans l’exécution budgétaire a, au moins à court terme, atténué un risque de dégradation rapide du marché du travail. Mais elle pose aussi une question politique et technique : jusqu’à quel point les annonces publiques correspondent-elles à un scénario réellement mis en œuvre ?
Une stratégie axée sur la politique de l’offre
Le choix de concentrer l’effort sur la réduction des dépenses découle d’une volonté politique claire : préserver la politique de l’offre. Cette doctrine mise sur la baisse des prélèvements obligatoires pour stimuler l’activité privée et la création d’emplois.
Dans la pratique, cependant, la combinaison de réductions de recettes via des baisses d’impôts et d’efforts sur les dépenses a contribué à un affaiblissement des marges budgétaires. Selon le raisonnement exposé par les responsables, il s’agissait d’accepter une contraction temporaire des ressources publiques pour relancer la croissance par l’offre.
Les résultats observés jusqu’ici soulèvent des interrogations : la stratégie a vidé des marges de manœuvre sans générer, pour l’heure, la dynamique d’emplois de qualité attendue. Elle a aussi, selon les constats évoqués, contribué à une aggravation de la pauvreté, signe que les effets redistributifs et sociaux n’ont pas été compensés.
Trois défis structurels pour l’économie française
La discussion budgétaire ne peut être détachée des fragilités structurelles que traverse l’économie nationale. Trois enjeux principaux émergent clairement.
Le premier est budgétaire : à la différence de plusieurs voisins européens, la France n’a pas réduit son déficit depuis la pandémie de Covid‑19 ; au contraire, le déficit s’est creusé. Ce constat pèse sur la crédibilité des trajectoires annoncées et sur la soutenabilité de la dette à moyen terme.
Le second enjeu est macroéconomique : la productivité stagne et la croissance n’a pas trouvé de relais durables. Sans gains de productivité significatifs, les marges pour financer la protection sociale, les services publics et les investissements se réduisent.
Le troisième défi concerne la prospérité future : l’école et l’hôpital montrent des signes de dégradation et les investissements en faveur de la transition écologique restent insuffisants. Ces éléments conditionnent la capacité du pays à assurer sa compétitivité et à répondre aux enjeux climatiques et sociaux.
Penser le budget 2026 comme première étape d’une stratégie
Au-delà des querelles partisanes, une voie crédible consisterait à concevoir le budget 2026 comme la première étape d’une stratégie de long terme. Le budget ne se réduit pas à un simple exercice arithmétique annuel : il articule la politique économique, définit les contours de la protection sociale et détermine la capacité des services publics à répondre aux besoins.
Un cadrage pluriannuel clarifié permettrait de mieux répartir l’effort entre maîtrise des dépenses, priorité aux investissements et mesures de soutien ciblées. Il offrirait aussi une visibilité accrue aux acteurs économiques et sociaux, condition essentielle pour les décisions d’investissement et d’embauche.
La question posée au lendemain d’un éventuel changement de gouvernement ne sera donc pas seulement : qui gouverne ? Elle sera aussi : quelle trajectoire la France choisira‑t‑elle pour concilier soutenabilité budgétaire, relance de la croissance et protection des plus vulnérables ?
Cette décision déterminera si le pays poursuit la voie actuelle ou opte pour une réorientation plus équilibrée entre réduction des déficits, investissements et politiques sociales.