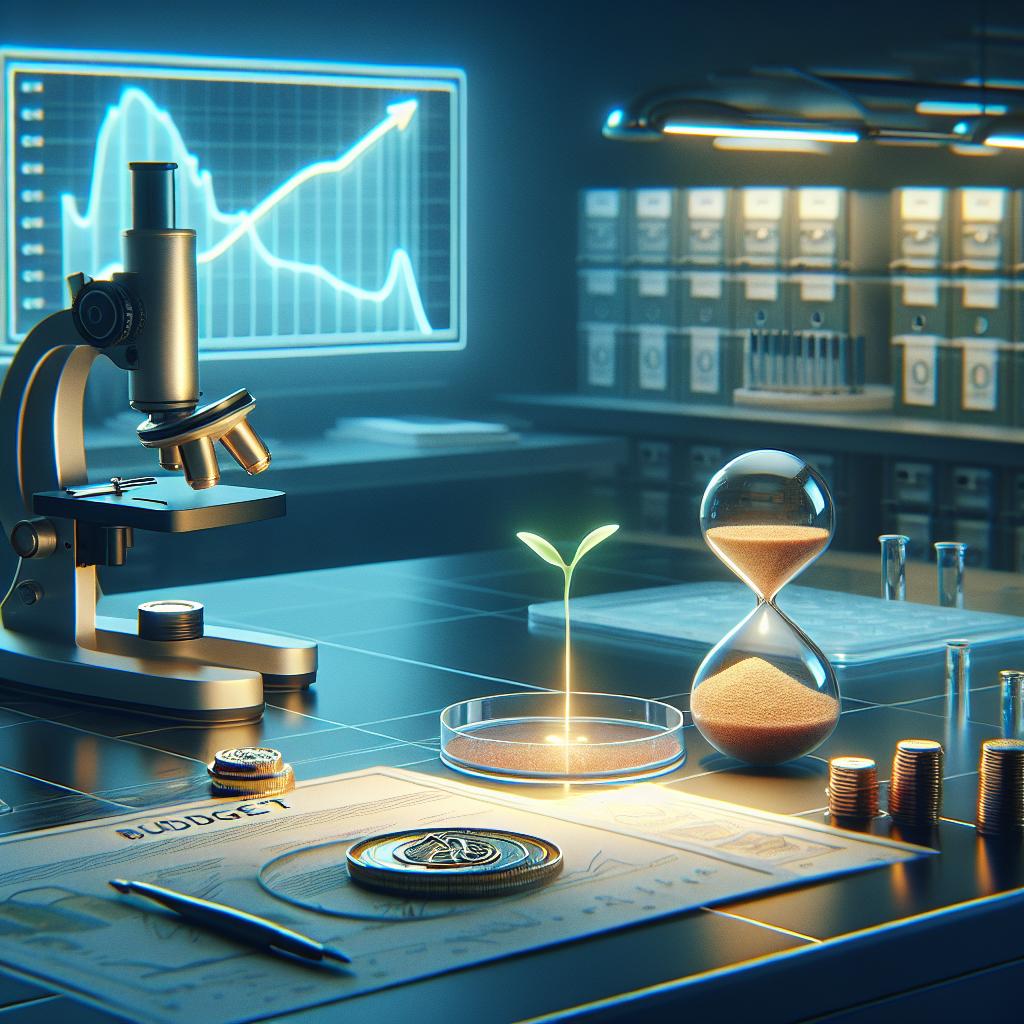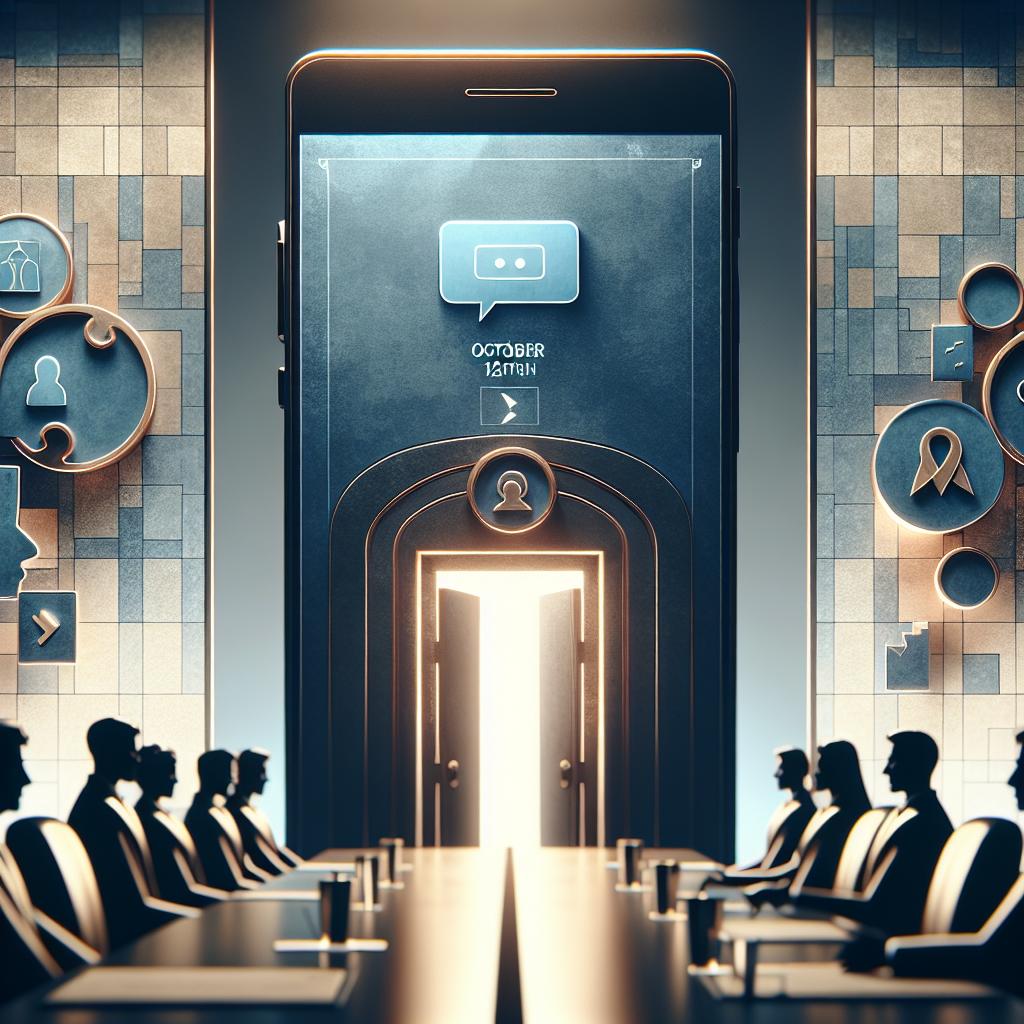Investir dans la recherche publique est présenté comme une condition essentielle pour comprendre et anticiper les évolutions sociétales. Pourtant, le financement de cette recherche stagne depuis deux décennies : selon les constats rapportés, les gouvernements successifs n’ont pas tenu leurs engagements pour porter le budget à un niveau comparable à celui d’autres pays développés ni conforme aux engagements européens de la France.
La trajectoire financière inscrite dans la loi de programmation de la recherche de 2020 n’a pas été respectée : près de 2 milliards d’euros cumulés manquent déjà à la recherche publique, et le projet de budget 2026 laisserait, selon les observations, un déficit accru.
Des indicateurs en recul sur le terrain
Sur le terrain, ce désinvestissement se traduit par des signes tangibles. Une enquête en ligne récente conduite par le Collège des sociétés savantes académiques de France sur le financement de la recherche publique met en évidence une stagnation, voire une dégradation, de trois indicateurs-clés de la qualité scientifique : le temps consacré à la recherche, les moyens financiers disponibles et la stabilité des dispositifs dans la durée.
L’enquête souligne aussi un écart croissant entre la manière dont les chercheurs donnent du sens à leur activité et la perception qu’ils ont des priorités affichées par le gouvernement. Cette fracture traduit, selon les personnes interrogées, une sous-évaluation par les décideurs publics de l’ampleur et de la vitesse d’action que la recherche peut avoir sur la société.
Un exemple historique : la recherche sur les micro-organismes
L’étude des micro-organismes présents dans les plantes, les animaux ou les écosystèmes illustre ce basculement. Au début des années 1980, la très grande majorité de ces organismes étaient difficilement cultivables en laboratoire et restaient mal connus. Cette ignorance avait des conséquences concrètes sur la santé publique et les coûts associés.
On attribuait alors au stress des affections comme les ulcères gastriques ou duodénaux. Ces pathologies entraînaient en France près de 50 000 hospitalisations par an et des coûts directs et indirects évalués à plus de 1 milliard d’euros en valeur actualisée.
La recherche publique a modifié ce diagnostic : l’identification de la cause bactérienne de ces ulcères, la bactérie Helicobacter pylori, a permis de développer un traitement antibiotique simple et efficace reposant sur des médicaments déjà connus. En l’espace d’une décennie, la prise en charge a ainsi réduit les coûts sociétaux liés à cette pathologie d’un facteur estimé entre 4 et 10.
Cet exemple montre comment un investissement scientifique ciblé peut se traduire rapidement par des gains de santé publique et des économies substantielles pour la collectivité.
Perspectives et enjeux
La comparaison entre la promesse budgétaire et la réalité des crédits disponibles interroge la capacité des politiques publiques à soutenir une recherche stable et ambitieuse. La stagnation des ressources, la précarité des dispositifs et la contrainte temporelle pesant sur les équipes fragilisent la continuité des programmes et la montée en maturité des résultats scientifiques.
Les professionnels interrogés dans l’enquête mettent en garde contre les effets cumulatifs d’un financement insuffisant : perte de temps consacré à la recherche, moindre attractivité des carrières scientifiques et difficulté à traduire des découvertes en applications bénéfiques pour la société.
Sans prétendre apporter de solution, l’analyse factuelle des constats évoqués — trajectoire budgétaire non tenue, indicateurs en recul et exemples concrets d’impacts positifs de la recherche — invite à considérer le financement public comme un levier déterminant. L’expérience sur Helicobacter pylori rappelle que des avancées scientifiques, parfois inattendues au départ, peuvent produire des effets tangibles et rapides lorsque les conditions de recherche sont présentes.
En l’état, la situation décrite laisse planer le risque que des opportunités similaires ne puissent être saisies si la tendance au désinvestissement se poursuit.