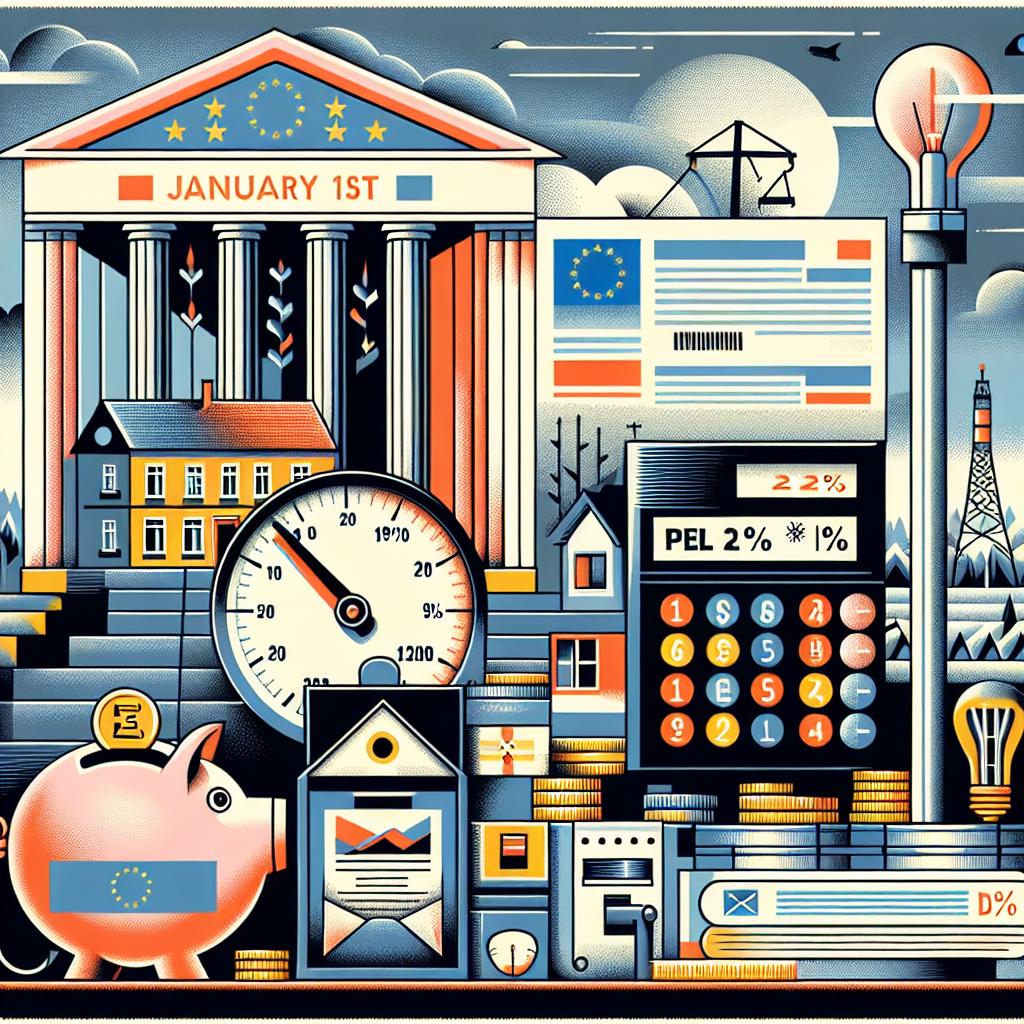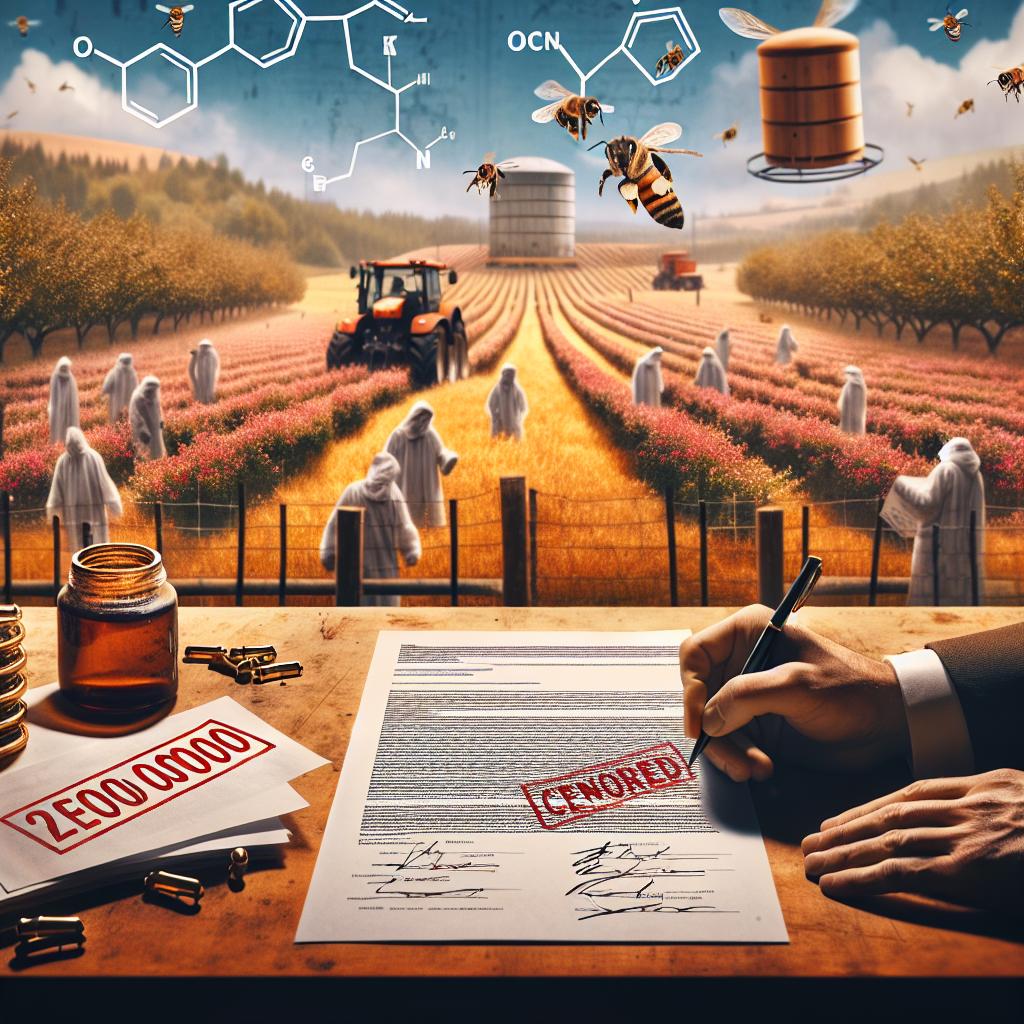La proposition dite « taxe Zucman », une imposition sur le patrimoine des ultrariches pensée par l’économiste Gabriel Zucman, est revenue au centre du débat politique français. Votée largement à l’Assemblée nationale en février et rejetée au Sénat en juin, elle nourrit aujourd’hui une bataille sur son éventuelle intégration au prochain budget de l’État, alors que les clivages politiques restent très marqués.
Un parcours parlementaire contrasté
Au Parlement, la trajectoire de la mesure a été tranchée : adoption majoritaire à l’Assemblée en février, puis rejet par le Sénat en juin. Ces étapes définissent le cadre institutionnel du débat et expliquent pourquoi la question se pose à nouveau au moment des arbitrages budgétaires.
Le contraste entre les deux chambres illustre aussi la difficulté à faire émerger un consensus sur une réforme fiscale portant sur les plus hauts patrimoines. La relance du dossier survient à mesure que s’approchent les discussions sur le budget, période où les mesures de recettes et de redistribution sont examinées de près.
Un enjeu central pour la gauche
La gauche a choisi d’en faire un étendard. Le Parti socialiste a inscrit la taxe Zucman comme la mesure principale de son « contre-budget » présenté le 30 août, la qualifiant d’incontournable dans la perspective d’un accord de gouvernement. Dans cette logique, la fiscalité des très hauts patrimoines devient un critère de négociation politique : « Faire peser l’effort d’abord sur ceux qui ont le plus, c’est la base de tout compromis possible », affirme Raphaël Glucksmann (Place publique) dans un entretien à Libération publié mercredi 3 septembre.
Les écologistes partagent cet axe et le mentionnent directement dans la « lettre aux Français » qu’ils s’apprêtent à diffuser. Ils rappellent également que la proposition a été portée, au moins à l’origine, par des députés issus de leurs rangs, ce qui explique leur attachement au dossier.
La droite, entre refus et reconnaissance d’un problème
Sur la droite, le refus de la taxe Zucman est explicite, mais il s’accompagne d’une reconnaissance partielle de l’existence d’un problème lié aux inégalités de patrimoine. Plutôt que d’embrasser la proposition telle quelle, des responsables de droite évoquent la recherche d’alternatives, sans que celles-ci ne soient détaillées dans le débat public cité.
Ce positionnement montre qu’au-delà de l’opposition de principe, il existe une préoccupation commune sur la question de la justice fiscale, mais des désaccords importants sur les instruments à privilégier pour y répondre.
Un dossier indifférent aux soubresauts gouvernementaux
La réouverture du dossier intervient dans un contexte politique instable : selon le texte d’origine, la tenue ou la chute du gouvernement Bayrou, programmée pour lundi 8 septembre, ne devrait pas faire disparaître la question. Qu’elle que soit l’issue politique immédiate, la taxe Zucman demeure une ligne de tension entre forces politiques et un repère dans les négociations budgétaires à venir.
L’éventuelle intégration de la taxe dans le budget dépendra de compromis politiques, mais aussi des arbitrages techniques et juridiques qu’il faudra préciser si le sujet franchit les étapes législatives. Pour l’heure, l’enjeu est avant tout politique : affirmer des priorités de redistribution et tester la capacité des différents camps à trouver un terrain d’entente.
La circulation de la mesure entre Assemblée, Sénat et agora politique montre que la taxe Zucman est devenue plus qu’une proposition fiscale : elle fonctionne comme un marqueur des choix de société sur l’impôt et la répartition des efforts. Les prochains rounds budgétaires préciseront si elle se traduit en texte concret ou reste un instrument de débat politique.